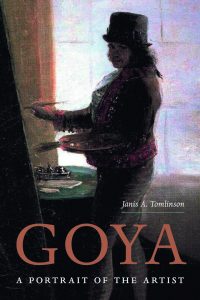Un regard noir au service des rois
Publié dans le magazine Books n° 113, mai 2021. Par Michel André.
Contrairement à une légende tenace, Goya était tout sauf un artiste maudit. Il est resté jusqu’à ses vieux jours le peintre officiel de la cour. Il aimait la chasse, la corrida, la bonne chère et la compagnie des femmes. Mais la surdité qui l’atteint en 1792 libère le regard cruel qu’il portait déjà sur la société espagnole. Et l’invasion de l’Espagne par les troupes de Napoléon, en 1807, porte à son paroxysme les visions cauchemardesques d’un génie.

La position de Goya à la cour et ses contacts avec la haute société lui permirent de s’illustrer dans l’art du portrait. Ici, celui du matador Pedro Romero, peint entre 1795 et 1798.
Dans un petit livre sur Goya par endroits assez condescendant à son égard, le philosophe José Ortega y Gasset accuse les premiers biographes de l’artiste d’avoir bâti autour de sa personne une véritable mythologie. Le caractère apparemment romanesque de sa vie, le fait qu’elle coïncide avec une période mouvementée de l’histoire de l’Espagne, la puissance des images qu’il nous a léguées ont conduit à attribuer à Goya des traits de caractère, des aventures amoureuses, des idées politiques que rien n’atteste. Les romantiques, notamment, ont contribué à donner de lui l’image d’un homme solitaire en révolte contre son époque. Comme le met en lumière Janis Tomlinson dans la biographie érudite et minutieuse qu’elle vient de lui consacrer, Goya était en réalité un homme extrêmement sociable et très bien introduit dans la plus haute société de son temps. Durant la majeure partie de son existence, il a travaillé au service de la cour d’Espagne et pour la grande bourgeoisie madrilène. Attentif à se faire rétribuer à la hauteur de son immense talent, il a presque toujours vécu dans une relative opulence. Sa vie n’a pas été exempte de malheurs, à commencer par la surdité qui l’a frappé en pleine force de l’âge et, en l’enfermant dans un monde intérieur caractérisé par une imagination portée sur le fantastique et le morbide, a contribué à infléchir le contenu et la manière de ses œuvres. Mais il n’avait rien d’un artiste maudit.
Francisco de Goya y Lucientes, ainsi qu’il aimait se présenter1, est né en 1746 à Fuendetodos, petit bourg de la province de Saragosse, la capitale de l’Aragon, où il a passé son enfance, son adolescence et sa jeunesse. Son père était doreur et Goya a grandi dans un milieu d’artisans et d’artistes. À l’école, il fit la connaissance de Martín Zapater, qui, devenu un riche commerçant, demeura son ami jusqu’à sa mort. Ils entretinrent une correspondance assidue qui constitue l’une des meilleures sources d’information sur sa vie. Cette amitié était d’une rare intensité. Le ton quasiment amoureux de certaines lettres de Goya, combiné avec la présence de références assez crues à leur vie sexuelle, a fait supposer l’existence d’une liaison entre les deux hommes. À tort, selon Janis Tomlinson et plusieurs autres biographes.
Son talent pour le dessin et la peinture ayant été rapidement détecté, Goya entreprit des études artistiques sous la direction de José Luzán et de son élève Francisco Bayeu. Ce dernier était, avec Anton Raphaël Mengs et Giambattista Tiepolo, un des peintres attachés à la cour du roi Charles III, « monarque éclairé » acquis aux idéaux des Lumières comme le sera son fils Charles IV. Refusé à deux reprises au concours de l’Académie royale de Madrid, dont il deviendra plus tard membre et qu’il finira même par présider, Goya, après un voyage en Italie dont on ne sait pas grand-chose, se vit attribuer ses premières commandes : des fresques pour des églises. Ces œuvres de jeunesse n’ont rien de personnel et contrastent avec d’autres œuvres religieuses qu’il réalisera plus tard, produit du travail d’un homme certes imprégné de culture chrétienne mais, sans doute, irréligieux : ainsi le Saint François de Borgia et le Moribond impénitent, où apparaissent les inquiétants démons qui peupleront bientôt ses dessins, les fresques de San Antonio de la Florida, d’une étonnante modernité dans leur économie de moyens, ou encore le tragique Christ au jardin des Oliviers de la fin de sa vie.
À l’âge de 29 ans, il épousa la sœur de Francisco Bayeu, Josefa, dont on sait très peu de choses. Goya ne la mentionne que rarement dans sa correspondance et n’a réalisé qu’un seul portrait d’elle, lorsqu’elle avait presque 60 ans. Quels étaient ses sentiments à son égard ? Les biographes sont partagés. Après plusieurs fausses couches, Josefa mit au monde sept enfants, dont un seul, Javier, atteint l’âge adulte. Dans deux de ses tableaux, des sorcières sont représentées en compagnie de fœtus et de cadavres de nourrissons : reflet d’une croyance répandue à leur sujet, mais aussi, à l’évidence, de ces morts tragiques.
Par l’intermédiaire de Bayeu, Goya obtint des commandes de la cour. Elles portaient sur des « cartons pour tapisserie », les modèles utilisés pour tisser celles qui ornaient les pièces des palais royaux. Rapidement, il témoigna dans ce domaine d’une supériorité et d’une originalité qui lui permirent de gravir les échelons : d’abord peintre du roi, il devint vite peintre de la Chambre du roi, puis premier peintre de la Chambre du roi. Durant dix-sept ans, Goya peignit une soixantaine de ces cartons, dont beaucoup ont été conservés. Dans un esprit proche de celui des fêtes galantes de Watteau, la plupart représentent des scènes de la vie populaire madrilène telle que l’élite de la bourgeoise cultivée aimait se l’imaginer. Un des plus réussis est La Prairie de Saint-Isidore, vue d’ensemble d’une foule joyeuse, colorée et insouciante, rassemblée à proximité de Madrid à l’occasion de ce qui était à l’origine un pèlerinage. Dans certaines de ces images enchantées s’introduisent toutefois déjà la souffrance et la détresse (L’Hiver), voire une sorte d’inquiétante étrangeté (Le Pantin).
La position de Goya à la cour et ses contacts avec la haute société lui donnèrent l’occasion de s’illustrer dans l’art du portrait, qu’il pratiqua jusqu’à la fin de sa vie. En raison de son impressionnante maîtrise de l’usage des couleurs, souvent dans la gamme des coloris tendres (gris, bleu ciel, tabac), de la qualité du rendu des matières, notamment textiles, et de sa stupéfiante capacité à capturer la personnalité des modèles, les portraits qu’il a réalisés de ses amis ilustrados (ces hommes lettrés acquis aux idéaux des Lumières tels que Leandro Fernández de Moratín, Sebastián Martínez y Pérez et Gaspar Melchor de Jovellanos), de la marquise de la Solana, de la comtesse de Chinchón, des comédiennes Antonia Zárate et La Tirana ou du matador Pedro Romero comptent au nombre des plus remarquables de l’histoire de la peinture.
Parmi les plus célèbres figurent deux portraits qu’il a faits de la duchesse d’Albe, également représentée à plusieurs reprises dans ses dessins. On a dit qu’il en avait été l’amant : une légende, affirme Janis Tomlinson, rejoignant sur ce point le critique d’art australien Robert Hughes2. (Que Goya en ait été amoureux ne fait cependant guère de doute). Une autre légende au sujet de la duchesse est qu’elle aurait posé pour La Maja nue et La Maja habillée, deux tableaux peints par Goya à quelques années d’intervalle. On sait à présent que le modèle était selon toute vraisemblance Pepita Tudó, la maîtresse préférée de Manuel Godoy, secrétaire d’État du roi Charles IV – dont il était par ailleurs l’amant de la femme, la reine Marie-Louise. La Maja nue était le premier nu féminin sans prétexte mythologique, et les deux tableaux, le deuxième dissimulant sans doute le premier, ne quittèrent jamais le cabinet de peinture privé de Godoy. Lors de leur découverte après le retour sur le trône du réactionnaire Ferdinand VII (fils de Charles IV) à l’issue de l’occupation de l’Espagne par les troupes françaises, Goya fut convoqué par l’Inquisition, rétablie par le souverain après avoir été supprimée par Napoléon. Une convocation restée sans suite.
On a souvent noté la cruauté de ses portraits des membres de la famille royale, notamment dans le célèbre tableau où ils sont tous rassemblés, La Famille de Charles IV. Les Bourbons n’étaient pas gâtés par la nature et le peintre n’a rien fait pour embellir leurs traits ingrats. Ces tableaux réalistes n’ont suscité aucune protestation de la part des intéressés. En Espagne, contrairement à d’autres pays, il existait une tradition de représentation sans complaisance des puissants. Du reste, les modèles étaient tellement imbus d’eux-mêmes qu’ils ne se voyaient pas tels qu’ils étaient.
En 1792, lors d’un voyage en Andalousie, Goya fut atteint d’une maladie grave aux effets dévastateurs. A posteriori, les diagnostics les plus variés ont été établis, dont un accident vasculaire cérébral et la syphilis. Janis Tomlinson privilégie l’intoxication au plomb. La vérité est que rien n’est certain, aucune des hypothèses ne concordant parfaitement avec le tableau clinique, ni avec le fait que Goya vécut jusqu’à un âge avancé. La paralysie partielle et les vertiges des premiers jours disparurent progressivement. Mais l’épisode fut suivi d’une période de profonde dépression, et, tout le reste de sa vie, le peintre souffrit de pénibles acouphènes et d’une totale surdité l’obligeant à communiquer par écrit ou à l’aide du langage des signes. Des années plus tard, une autre maladie, tout aussi mystérieuse, le frappera, l’affectant à nouveau psychologiquement. Un extraordinaire tableau où il se représente dans la compagnie attentionnée de son médecin en constitue la trace.
Le moment où il devient sourd marque un tournant dans son œuvre. À partir de cet instant, tout en continuant à livrer des travaux de commande, il libère son imagination dans des œuvres « de [sa] propre invention », en grande partie réalisées pour lui-même. Tout en conservant sa grande virtuosité (Goya peignait vite, avec une sidérante maîtrise du geste et ne retouchait que rarement son premier jet), son style s’éloigne davantage encore des canons académiques. La première manifestation de cette nouvelle approche consiste en une série de « peintures de cabinet » dans lesquelles s’exprime ce qui allait devenir son univers caractéristique : catastrophes (naufrage, incendie), actes de brigandage, intérieurs de prisons et d’asiles de fous. Cette veine ne disparaîtra jamais de son œuvre, ainsi qu’en témoignent les scènes d’attaques de bandits avec viols, de sorcellerie, de cannibalisme et de tribunaux de l’Inquisition qu’il peindra plus tard.
Parallèlement, Goya se lance dans la réalisation d’une première série de gravures, Les Caprices. Il maîtrisait tous les procédés de la gravure. S’il lui arrivait de recourir à la pointe sèche et au burin, son moyen d’expression préféré dans ce domaine était la combinaison de l’eau-forte et de l’aquatinte, qui permet de réaliser des à-plats de différentes nuances de gris. Organisés en plusieurs séries, Les Caprices contiennent une cruelle satire du clergé, de la superstition et de la sorcellerie, ainsi que des vices présents dans la société : ignorance, bêtise, ivrognerie, inconstance et perfidie des femmes, avidité, naïveté et brutalité des hommes. La gravure la plus célèbre des Caprices, qui en exprime bien l’esprit, est celle intitulée Le sommeil [ou le songe] de la raison engendre des monstres. On y voit un homme endormi autour de la tête duquel volent des créatures nocturnes ailées. Goya entendait largement diffuser cette série de gravures, qui ne fut toutefois vendue qu’à quelques dizaines d’exemplaires.
L’invasion de l’Espagne par les troupes de Napoléon en 1807 et la lutte pour l’indépendance nationale qui s’ensuivit lui offrirent l’occasion de réaliser une deuxième série de gravures, plus frappantes encore que les premières. Avec une crudité inédite dans l’histoire de l’art, sans prendre ostensiblement parti, elles montrent les actes affreux commis par les deux camps tels que Paul Morand, un siècle plus tard, les décrira dans Le Flagellant de Séville : « Assassinats immondes, paysans assis sur leurs victimes et les saignant comme des porcs, hussards traînant les femmes par les cheveux, soldatesque patibulaire tirant les pendus par les pieds, […] blessés jetés des fenêtres comme des sacs. » Ces images épouvantables sont légendées à l’aide de formules lapidaires (« La même chose », « Cela aussi », « Cela s’est passé ainsi », « Je l’ai vu ») qui ont conduit certains à faire de Goya, à tort, un reporter-photographe avant la lettre. Sans doute a-t-il assisté à certaines des scènes illustrées, mais, pour l’essentiel, c’est à son imagination qu’il faisait appel pour évoquer les horreurs de la guerre3. La même remarque s’applique à deux tableaux liés à ces événements : Dos de Mayo, saisissante représentation, dans son effrayante confusion, d’une attaque des cavaliers mamelouks de l’armée napoléonienne par des partisans espagnols ; Tres de Mayo, image emblématique de l’exécution d’insurgés par un peloton de hussards, largement considérée, en raison de son sujet et de la manière dont il est traité, comme une des œuvres les plus novatrices de la peinture occidentale.
Goya produira encore plus tard deux séries de gravures : Les Disparates, dont les images étranges, fantastiques et oniriques, sur lesquelles plane souvent l’aile de la folie, défient l’interprétation, et La Tauromachie. Il y évoque la corrida, une de ses grandes passions, dans toute sa violence dramatique et avec un puissant réalisme.
En 1819, il fit l’acquisition, dans la campagne madrilène, d’une maison surnommée « Le domaine du sourd », un de ses précédents propriétaires ayant été affligé de la même infirmité que lui. Il décora les murs de deux pièces à l’aide de quatorze peintures connues aujourd’hui sous le nom de « peintures noires » en raison de leur teinte sombre et de leur caractère sinistre : un géant halluciné dévorant une femme, souvent décrit comme le Saturne de la mythologie mangeant ses propres enfants, mais dans lequel le grand critique espagnol Eugenio d’Ors voyait plutôt un « anthropophage en colère » ; deux hommes armés d’un bâton, les pieds apparemment pris dans le sol, se frappant mutuellement ; une tête de chien émergeant pathétiquement de ce qui semble être des sables mouvants. Pour la plupart de ceux qui se sont exprimés à leur sujet, ces peintures constituent le fruit le plus accompli de l’imagination visionnaire de Goya et l’expression achevée de son art. Janis Tomlinson, qui récuse l’appellation « peintures noires » et ne leur consacre, de façon surprenante, que quelques paragraphes, y voit le produit de la volonté du peintre d’amuser ses visiteurs à l’aide d’images comparables à celles des musées d’horreur et des lanternes magiques. Telles que nous les voyons aujourd’hui, ces peintures, en partie mutilées à l’occasion de leur transport sur les cimaises du musée du Prado et possiblement retouchées par des mains inconnues, sont vraisemblablement très différentes de ce qu’elles étaient à l’origine. Leur signification nous échappe, comme elle échappait peut-être en partie à leur auteur. Mais elles sont solidement inscrites dans notre imaginaire.
Goya, que l’évolution de la situation politique poussait à s’éloigner de Madrid, finit ses jours à Bordeaux en compagnie de Leocadia Zorrilla, la jeune femme qui partagea les dernières années de sa vie, ainsi que de la fille de celle-ci, Rosario, à laquelle il était très attaché et dont il fit son élève. Il n’arrêta jamais de travailler, expérimentant même une nouvelle technique, la miniature sur ivoire. On a dit d’un de ses derniers tableaux, La Laitière de Bordeaux, qu’il était un portrait de Rosario. Mais son attribution à Goya a été contestée. Janis Tomlinson suggère qu’il s’agirait d’une œuvre réalisée en collaboration avec Rosario à des fins didactiques.
Un des portraits les plus connus de Goya est celui qu’a fait son ami Vicente López y Portaña. Il s’agit d’un portrait officiel et le modèle est à l’évidence flatté. Cette représentation, différente de celles de ses autoportraits, reflète toutefois un aspect central de la personnalité de Goya. Déjà très âgé (le tableau a été peint deux ans avant sa mort), l’artiste y apparaît comme un homme au physique robuste et puissant. De son corps trapu et de son large visage aux traits affichant un air déterminé émane une impression d’indomptable énergie ; celle qui lui faisait écrire trois ans avant sa mort, à l’âge de 82 ans : « Je n’ai ni la vue ni la force […], tout me manque, sauf la volonté. » On ne peut s’empêcher de songer à Beethoven, auquel il a souvent été comparé.
L’image de Goya qui ressort de sa correspondance est celle d’un homme sensuel aimant les plaisirs de la vie, la chasse, le chocolat, la beauté des femmes et les délices de l’amitié. Cette sensualité s’exprime dans toute son œuvre immense (environ 700 peintures, 280 gravures et des milliers de dessins), même là où on ne l’attendrait pas. Épris de justice, mais sans illusion sur l’humanité, il n’était pas un révolutionnaire. « Goya, fait remarquer Janis Tomlinson, était avant tout un artiste […] au service des rois et de leur cour plutôt que des idéologies. »
Il affirmait n’avoir de dettes qu’envers un nombre limité de ses prédécesseurs. Mes seuls maîtres, disait-il, ont été Vélasquez, Rembrandt et la Nature, par quoi il entendait la réalité : s’il savait les peindre avec virtuosité, il y a relativement peu d’arbres et de paysages dans ses œuvres. Aux yeux des artistes français, anglais et allemands qui l’ont découvert au tournant du xixe et du xxe siècle (jusque-là, il n’était guère connu en dehors de l’Espagne), Francisco de Goya, écrit Robert Hughes, était « le dernier des vieux maîtres et le premier des modernes ». De ces deux dimensions, c’est la seconde que nous mettons en avant aujourd’hui. Par leurs sujets et la façon dont ceux-ci sont traités, beaucoup de ses œuvres annoncent le romantisme, l’impressionnisme et l’expressionnisme. En regardant ses tableaux et ses gravures, on pense souvent à Monet, Turner, Courbet, Ensor ou Munch. En même temps, Goya, qui n’avait aucune considération pour l’enseignement académique de la peinture, appartient encore au monde de l’art classique. À la charnière des xviiie et xixe siècles, il demeure à la fois l’héritier et le représentant d’une tradition qu’il a contribué à transformer. Si elle contient en germe de nombreux développements ultérieurs, son œuvre, souligne Tzvetan Todorov, ne quitte jamais le domaine du figuratif et « s’arrête au seuil de l’abstraction »4.
Homme de son temps, Goya était aussi celui de son pays, l’Espagne, dont l’art et la culture populaire ont toujours fait place à la sauvagerie, la violence et l’irrationnel. Ce qui fait sa modernité se situe essentiellement sur le plan artistique : une nouvelle forme de sensibilité et une nouvelle manière de représenter le monde. Dans la nature, disait-il, on ne trouve ni lignes ni couleurs, mais « des corps éclairés et des corps qui ne le sont pas, des plans qui avancent et des plans qui reculent, des reliefs et des enfoncements ». Cette modernité n’exclut pas la présence, au cœur de son œuvre, de ce qui depuis toujours définit l’art et sans quoi celui-ci n’existe pas : un grand savoir-faire, la recherche de la vérité et le sens de la beauté, qui éclaire souvent même ses images les plus terribles.
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Cet article a été écrit pour Books.
Notes
1. Pour justifier la particule de son nom, il invoquait la présence d’hidalgos (personnes de petite noblesse) dans son ascendance maternelle.
2. Goya (Random House, 2003).
3. Goya renonça par prudence à diffuser Les Désastres de la guerre, ses dernières gravures dénonçant, non les violences du conflit, mais la politique réactionnaire mise en œuvre par Ferdinand VII par la suite.
4. Goya. À l’ombre des Lumières (Flammarion, 2011).