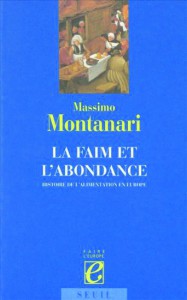Quand la cuisine est devenue gastronomie
Publié le 1 février 2016. Par La rédaction de Books.
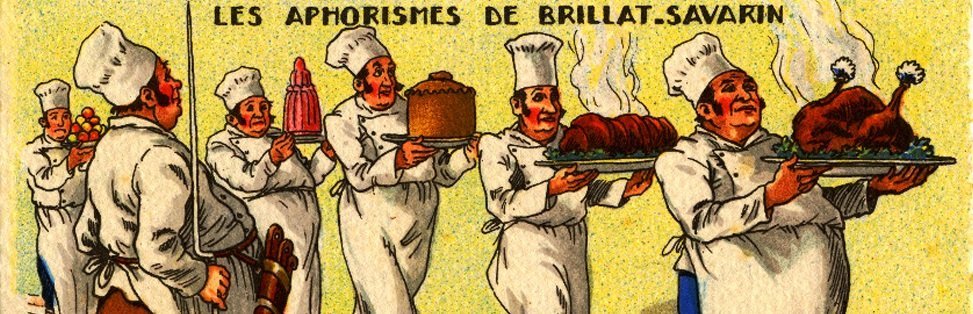
Les « étoilés » du guide Michelin, dont la liste a été dévoilée ce lundi, ne préparent pas « à manger ». Ils inventent, ils créent, ils développent un art et un discours, ceux de la gastronomie. Et ils ne sont ni les premiers, ni les seuls, rappelle l’historien Massimo Montanari dans cet entretien publié par Books à l’été 2015. Du fin fond des âges, du prince au paysan, des chefs reconnus au marmiton du dimanche, tous les cuisiniers partagent la recherche du sain et du gourmand. Retour sur une étonnante histoire pleine de goût, où l’on apprend notamment qu’il faut marier le haricot et l’origan.
À quand remonte l’apparition de la gastronomie ? À l’invention du feu ? Au premier livre de cuisine ?
Ni l’une ni l’autre. Le feu est utilisé pour cuire et marque la naissance de la cuisine. Les livres de recettes représentent une codification de cette activité, souvent à un niveau professionnel. La gastronomie, c’est autre chose. C’est la « réflexion », le « discours » sur la nourriture, la pensée théorique sur les pratiques de cuisson et sur les « règles » à suivre pour bien alimenter le corps. On dit souvent que la gastronomie est née au XIXe siècle. Mais nous pouvons en parler dès l’Antiquité, puis à propos du Moyen Âge et de la Renaissance. La littérature diététique de ces époques n’a parfois rien à envier à nos livres de cuisine quand elle multiplie les suggestions pratiques sur la meilleure manière d’accommoder les aliments, de les cuire et de les accompagner. Elle produit une véritable réflexion gastronomique en insistant sur la relation centrale entre plaisir et santé. L’idée est profondément ancrée dans la diététique prémoderne que les aliments, pour être bien assimilés par l’organisme, doivent réveiller les sucs digestifs par l’intermédiaire du plaisir de manger. En témoigne le traité de l’humaniste Platina au milieu du XVe siècle, intitulé « Du plaisir honnête et de la santé ». Il écrit par exemple que le haricot est chaud et humide, mais que sa nocivité peut être tempérée « en le saupoudrant d’origan, de poivre et de moutarde » et en buvant ensuite un vin pur.
Le haricot chaud et humide, qu’est-ce à dire ?
Ces considérations diététiques sont héritées de la médecine prémoderne, celle d’Hippocrate transmise par le médecin romain Galien. Elle était fondée sur un principe fondamental : tout être vivant possède une « nature » particulière due à la combinaison de quatre qualités, le chaud, le froid, le sec et l’humide. L’homme est en parfaite santé lorsque ces éléments se combinent de manière équilibrée. C’est ici qu’entre en scène la cuisine entendue comme art de la manipulation et de la combinaison, puisqu’il n’existe pas d’aliment parfaitement équilibré dans la nature. D’où les indications que l’on trouve dans les textes diététiques sur la cuisson. Si les viandes sont « sèches », il vaudra mieux y adjoindre de l’eau, donc les bouillir ; dans le cas inverse, mieux vaut les rôtir. Des critères analogues orientent les associations qui ont déterminé de nombreux choix gastronomiques, dont l’usage persiste parfois encore : pourquoi mange-t-on le melon avec du jambon ? Parce que le premier, jugé excessivement humide et dangereux pour la santé, devait être « asséché » par le jambon. Et il n’est pas seulement humide, il est aussi dangereusement froid. Le problème est brillamment résolu en accompagnant le melon d’un vin fort et doux, souvent du porto en France. C’est aussi à ce raisonnement que nous devons les poires cuites au vin.
Comment retrouver l’origine exacte d’une invention culinaire ?
La cuisine dite traditionnelle est plutôt une construction collective ; elle a parfois eu un inventeur, mais elle est ensuite devenue patrimoine commun, avec quelques règles de base et de nombreuses variantes possibles. Dans ces cas, c’est-à-dire pour la quasi-totalité des recettes, on ne peut que spéculer sur l’origine de l’innovation par des considérations relatives au contexte, qui prennent en compte les produits utilisés, la manière dont ils sont traités, le goût que la recette exprime, etc.
Les mêmes besoins n’ont-ils pas produit des résultats comparables en plusieurs endroits ?
Oui, des besoins (ou des désirs) similaires peuvent engendrer des solutions similaires dans des contextes culturels différents. Les pâtes ont été inventées en Italie et en Chine, indépendamment. En Italie, c’est un produit ancien, déjà présent à l’époque romaine même s’il reste alors marginal. Cette culture s’est ensuite développée au Moyen Âge, au contact de la culture arabe, qui a introduit dans la Péninsule des formes nouvelles (comme les spaghettis) et la technique de séchage, qui permet aux pâtes de se conserver longtemps et d’être transportées. Quand Marco Polo débarque en Chine, il ne découvre donc pas les spaghettis ; il les reconnaît, car ils sont fabriqués en Italie depuis des siècles. Deux histoires indépendantes, deux produits similaires. Magnifique, n’est-ce pas ? Certains se plaisent à imaginer que ces deux histoires possèdent une origine commune, dans une région intermédiaire entre la Méditerranée et la Chine, à savoir l’ancienne Perse. Moi, je préfère penser que les hommes se ressemblent et sont capables de créer le même plat à des milliers de kilomètres de distance.
De quand date l’apparition du dessert, et plus particulièrement de la pâtisserie, l’une des innovations culinaires les plus ancrées dans nos habitudes alimentaires ?
L’idée de terminer le repas par un goût sucré n’est pas nouvelle du tout : à l’époque romaine déjà, à la Renaissance, au Moyen Âge, on en trouve des exemples. Toutefois, la cuisine européenne était dominée, jusqu’au XVIIe siècle, par une gastronomie que j’appelle « synthétique » parce qu’elle aimait conjuguer toutes les saveurs. C’est encore une fois la conséquence des conceptions diététiques propres à l’époque prémoderne. On mélangeait donc tous les types d’aliments, à la fois dans chaque assiette et au cours du repas. À la Renaissance, on avait par exemple l’habitude de commencer par des biscuits et du vin doux. Ensuite, cette saveur douce traversait le dîner du début à la fin. Et le sucré-salé caractérise une grande partie des mets antérieurs à l’époque moderne. On en retrouve d’ailleurs des traces dans les cuisines les plus conservatrices, notamment en Allemagne et en Europe orientale. Ce sont les poires et les pommes qui accompagnent la viande, et en particulier le gibier. Pour aller plus loin, c’est aussi l’aigre-doux de la cuisine chinoise et le pigeon au miel de la tradition marocaine : tout cela, c’est de la cuisine médiévale.
L’idée de placer le sucré en fin de repas n’apparaît qu’au XVIIe siècle, quand se propage en Europe, à partir de la France, l’idée totalement nouvelle qu’il est préférable de séparer les saveurs plutôt que de les réunir. Le doux est éliminé des plats du début et du milieu. La pâtisserie moderne, à base de beurre et de crème, est inventée parallèlement. Jusque-là, les gâteaux servis à table étaient des produits secs, de boulangerie.
Vous soulignez dans vos livres le rôle de l’imaginaire dans le goût pour les épices qu’avait l’Europe de la fin du Moyen Âge. Aujourd’hui, quels sont les aliments qui nous font rêver ?
On rêve toujours de ce qui est rare ou difficilement accessible, et donc très cher. Comme l’écrivait le grammairien Servius au début du Ve siècle, « tout ce qui est abondant est vil ». C’est pourquoi les épices étaient au Moyen Âge un produit de prestige. Quand elles sont devenues plus courantes à partir du XVIIe siècle, les élites ont cherché de nouveaux éléments de distinction dans le beurre ou la pâtisserie. Et l’imaginaire collectif du XIXe siècle a mis l’accent sur des produits comme le champagne ou le homard.
Aujourd’hui, le marché mondialisé donne plus facilement accès à tout, à des prix abordables. Le vrai signe de distinction consiste désormais à déguster une nourriture « locale », des produits du terroir. Dans l’idéal, même, une alimentation que l’on peut contrôler soi-même, sans passer par le marché. Le rêve de l’homme contemporain, c’est d’avoir un jardin potager derrière la maison.
Cette aspiration au « naturel » est-elle propre à notre époque ?
C’est incontestablement un phénomène emblématique de nos sociétés ; un effet du renversement de perspective qui a commencé au siècle des Lumières. De ce point de vue, nous sommes tous les petits-enfants de Rousseau. Lorsque celui-ci écrit dans L’Émile que « tout est bien sortant des mains de l’Auteur des choses [la nature], tout dégénère entre les mains de l’homme », il contribue à faire chavirer la vision qui gouvernait la pensée occidentale depuis l’Antiquité : l’idée que l’homme peut et doit améliorer la nature, en agissant à travers ses productions culturelles. Cette idée, bien sûr, n’a pas été partagée par tous avec la même conviction – témoin, l’ascétisme chrétien –, mais elle dominait. À partir de Rousseau, et au XXe siècle en particulier, le « naturel » devient un concept positif.
Il ne s’agit évidemment pas seulement d’un changement philosophique. Les avancées technologiques et scientifiques y ont elles aussi contribué. Je pense en particulier à la réfrigération, qui depuis un siècle et demi permet de conserver les aliments « au naturel », sans nécessité de les corrompre pour les conserver. Je pense aussi à l’industrie de la conserve, qui va dans le même sens. Et je pense à la découverte des vitamines, qui explique l’utilité de maintenir les aliments tels qu’ils sont, sans les altérer trop à la cuisson. Toutes ces évolutions ont contribué au triomphe, aujourd’hui, de l’idée de « naturel ». D’autant que le malaise engendré par un système alimentaire plus uniforme produit des formes de nostalgie de la campagne très paradoxales. Car enfin, qu’y a-t-il de plus urbain que l’actuel engouement pour les céréales inférieures et les pains noirs ? Les citadins riches transforment désormais une nourriture de pauvre comme le pain bis en nourriture d’élite, via les magasins bio et les épiceries fines, qui exploitent cette nouvelle image d’un passé qui n’a jamais existé, d’une ruralité heureuse et non corrompue que les paysans n’ont, eux, jamais connue.
Avec l’avènement de grands chefs considérés comme de véritables stars, la cuisine semble de plus en plus assimilée à l’art. Cette conception est-elle totalement nouvelle ?
L’échelle du phénomène – l’audience dont jouissent ces grands cuisiniers que l’on voit à la télévision – est parfaitement inédite. Mais la renommée des chefs elle-même est un phénomène ancien. Dès la Renaissance, voire le Moyen Âge, le cuisinier a un statut d’artiste. Et cela d’autant plus que la cuisine a alors pour vocation non de magnifier le goût naturel des aliments, comme c’est aujourd’hui le cas, mais de le métamorphoser par l’artifice : le cuisinier, jusqu’au XVIIe siècle, est un artiste qui ne respecte en rien les qualités originelles des denrées. Mais son public est beaucoup plus restreint qu’aujourd’hui, puisque seule l’aristocratie profite de son talent.
Historiquement, l’innovation culinaire a-t-elle été le fruit du talent des cuisiniers ou du besoin des populations ?
L’innovation se produit sur ces deux fronts à la fois. D’un côté, les professionnels éprouvent les techniques, inventent des recettes, appliquent leur imagination à la cuisine. De l’autre, le monde paysan n’est pas inerte, même s’il est conservateur car il a tendance à répéter ce qui lui est transmis oralement par les générations précédentes. La culture populaire est profondément novatrice parce que chaque nouveau défi, à commencer par le manque de nourriture – quelles que soient l’intensité et la forme qu’il prenne – exige des solutions nouvelles. « La nécessité est mère de l’invention », dit un proverbe très clairvoyant. La culture populaire a forgé les pratiques les plus fondamentales de la cuisine par nécessité, et par sa capacité à exploiter pleinement les ressources. Le besoin de conserver les aliments, notamment, a engendré d’innombrables innovations. La fermentation, pour ne prendre que cet exemple, a réussi à tirer avantage d’un processus naturel en soi négatif, la putréfaction. Résultats : le fromage et les autres dérivés du lait, les jambons et les autres charcuteries qui intègrent fermentation et salage. Voilà qui révèle des liens fascinants entre le monde de la faim et celui du plaisir.
Les tabous et les règles religieuses associées à l’alimentation n’ont-ils pas également influencé les pratiques ?
Certes, mais il ne faut pas penser les règles religieuses (ou philosophiques) comme des sources d’inspiration au sens technique. Elles se contentent de définir le cadre qui régit la sélection des ressources, sans imposer véritablement une façon de cuisiner les aliments. Cela étant, ce cadre est nécessaire, car il est difficile de construire dans le vide.
La tradition monastique offre un bon exemple de ce jeu complexe. La vie des moines est régie par une multitude de normes alimentaires, relatives aux périodes d’abstinence, à la distinction entre le quotidien et le festif, aux types d’aliments recommandés. Dans ce cadre contraignant, les monastères ont prêté une grande attention à la nourriture et à la cuisine, favorisant certains produits, comme le fromage, les œufs, les légumineuses, le poisson, que les règles imposaient comme substituts de la viande.
En outre, la culture des moines a joué un rôle très important d’intermédiaire entre la « haute » culture et la culture populaire : les frères venaient souvent de l’aristocratie et partageaient ses valeurs, mais ils prenaient pour modèle le mode de vie sobre et simple des paysans. Le dialogue entre les deux cultures culinaires, manifeste pendant tout le Moyen Âge, a été favorisé par cette médiation.
Quels sont les autres facteurs qui nourrissent l’inventivité gastronomique ?
Au-delà du besoin et de la créativité, la quête de la santé nous conduit à faire des expériences alimentaires sur des bases scientifiques. Et le désir de surprendre, d’enchanter ses invités. Ces quatre motivations fondamentales gouvernent l’acte de manger : nécessité, plaisir, santé, communication. Sans oublier, bien sûr, la part du hasard.
Propos recuellis par Sandrine Tolotti.