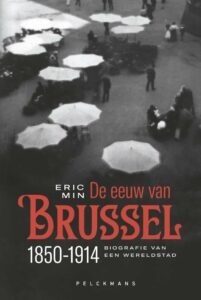Quand Bruxelles aimantait
Publié en février 2025. Par Michel André.
Marx y rédigea le Manifeste du Parti communiste, Hugo s’y réfugia, Baudelaire y déversa sa bile, Rimbaud et Verlaine s’y querellèrent, Rodin y fut heureux… Des décennies durant, Bruxelles fut un pôle d’attraction et parfois de détestation pour écrivains, peintres, architectes et esprits forts en tout genre.

En octobre 1885, en route vers Paris où il allait assister durant quatre mois aux cours du neurologue Jean-Martin Charcot, Sigmund Freud fit une courte étape à Bruxelles. Dans une lettre à sa fiancée Martha Bernays, il décrit la promenade qu’il effectua dans la ville. Il y raconte sa découverte d’un bâtiment « monumental et doté de splendides colonnes faisant penser à la reconstruction d’un palais assyrien, tel qu’on peut en voir dans les dessins de Gustave Doré » : « J’ai d’abord pensé qu’il s’agissait du Palais royal en raison de la présence à son sommet d’une coupole en forme de couronne. Mais il n’y avait pas de sentinelles, pas d’animation et la construction n’avait pas l’air d’être achevée. […] Le bâtiment se révéla être le Palais de Justice. » Sigmund Freud n’est pas le seul visiteur étranger à avoir été frappé par cet édifice aux proportions colossales. Verlaine le qualifiait de « biblique et michelangelesque, avec du Piranèse et un peu, peut-être, de folie ». Dans un texte d’une véhémente animosité envers la Belgique, Octave Mirbeau le décriait comme « un monument d’une laideur considérable » dans lequel « on avait empilé de l’assyrien sur du gothique, du gothique sur du tibétain, du tibétain sur du Louis XVI, du Louis XVI sur du papou ».
Beaucoup d’écrivains et de penseurs sont passés par Bruxelles durant la période qui va du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre mondiale, et plusieurs y sont restés bien plus longtemps que le père de la psychanalyse. La Belgique était un pays libéral où les intellectuels chassés de leur pays pour des raisons politiques trouvaient volontiers refuge. Et, à l’instar de Londres, Vienne et Paris, Bruxelles était un foyer de vie culturelle où résidaient de nombreux artistes. Dans De eeuw van Brussel, Eric Min raconte l’histoire des uns et des autres.
Un des plus célèbres exilés à Bruxelles fut Karl Marx. Persona non grata en Allemagne et en France, avant de déménager à Londres, où se déroula le reste de son existence, il resta trois ans dans la capitale belge. Il en fut expulsé en 1848 avec toute sa famille pour avoir manqué à son engagement de ne pas se mêler des questions politiques. Loin de rester discret sur ce plan, il n’avait cessé de multiplier les écrits et les interventions publiques. C’est à Bruxelles qu’il rédigea avec Engels le Manifeste du Parti communiste. On dit souvent que c’est la description des usines de Birmingham et Manchester par Engels qui aida Marx à formuler sa théorie de l’exploitation. Mais il y avait été préparé par ce qu’il avait observé des rapports entre la bourgeoisie et la classe ouvrière en Belgique et Le Capital contient des pages extrêmement dures à l’égard des capitalistes belges. Ainsi que le rappelle l’historien de l’économie Paul Bairoch, de 1830 à la Première Guerre mondiale, la Belgique fut la seconde puissance industrielle du monde après l’Angleterre.
Un autre exilé fameux est Victor Hugo. Il avait effectué un premier séjour dans le pays comme touriste en 1837 et 1838 en compagnie de sa maîtresse Juliette Drouet. Lors de l’arrivée au pouvoir de Napoléon III, en 1851, il s’installa à Bruxelles pour une durée de sept mois. Il y revint à plusieurs reprises après s’être transporté à Jersey et Guernesey. En 1871, il fut expulsé pour avoir exprimé son soutien à la Commune : les autorités belges ne souhaitaient pas s’aliéner la sympathie du gouvernement d’Adolphe Thiers. C’est à Bruxelles que furent en partie écrits Les Misérables. Le livre y fut imprimé, comme d’ailleurs Les Travailleurs de la mer et L’Homme qui rit. De manière générale, les écrivains français recouraient volontiers aux services des imprimeurs bruxellois pour échapper aux contraintes de la censure française. J.-K. Huysmans le fera des années plus tard pour son roman à fort parfum de scandale Marthe, histoire d’une fille.
Baudelaire, lui, n’eut pas cette possibilité. En 1864, il se rendit à Bruxelles pour fuir Paris, mais aussi dans l’espoir de rencontrer Albert Lacroix, patron des éditions Lacroix et Verboeckhoven, l’éditeur de Hugo, pour lui confier la publication de ses œuvres. N’y étant pas parvenu, il développa envers l’éditeur une haine inextinguible. Les conférences qu’il donnait pour subsister se révélèrent des fiascos. Il en conçut une aversion féroce pour la Belgique, qui s’exprime dans le pamphlet venimeux et méprisant Pauvre Belgique. Durant son séjour, sa santé très abîmée se détériora. En 1866, il fut victime à Namur d’une attaque cérébrale qui le laissa aphasique. Ramené à Bruxelles, il fut transporté à Paris où il mourut quelques mois plus tard. Dans l’ensemble, Bruxelles ne semble guère avoir réussi aux poètes français. Eric Min raconte aussi le fameux épisode du coup de revolver tiré par Verlaine, ivre, sur Rimbaud lorsque celui-ci, l’ayant rejoint en quittant Londres, où ils avaient passé quelque temps ensemble, lui fit part de son intention de retourner seul à Paris. Rimbaud ne fut que légèrement blessé mais, à la gare du Midi, demanda la protection d’un agent de police lorsque Verlaine le menaça de nouveau. Arrêté, jugé, Verlaine resta en prison deux ans.
Auguste Rodin avait, lui, toutes les raisons de garder un excellent souvenir de Bruxelles. Il y passa six ans, de 1871 à 1878, qui furent, à lire ce qu’il en dit dans ses Mémoires, « les plus belles de sa vie ». Il eut l’occasion d’y réaliser sa première œuvre en bronze, L’Âge d’airain, et d’y sculpter plusieurs éléments de la frise décorative du bâtiment de la Bourse. Il y exposa aussi ses œuvres à la Maison d’Art créée par un de ses plus fermes soutiens, Edmond Picard. Avocat, écrivain, professeur, journaliste, sénateur socialiste, franc-maçon comme beaucoup de membres de l’élite intellectuelle, politique et économique de l’époque, amateur d’art et de littérature, collectionneur et mécène, personnage aujourd’hui très controversé – il est l’auteur d’écrits antisémites et défendant une théorie des races qui font de lui une sorte de Gobineau ou de Drumont belge –, Picard, qui connaissait tout le monde et était partout, fut au cœur de la vie littéraire et artistique bruxelloise et, plus largement, belge, durant plusieurs décennies.
Cette vie culturelle, il est commun de la placer sous le signe du symbolisme. C’est à ce courant que sont par exemple souvent rattachés Georges Rodenbach, Émile Verhaeren et Maurice Maeterlinck, tous trois flamands d’origine écrivant en français. Mais le symbolisme est une étiquette un peu fourre-tout. Elle ne caractérise ces écrivains qu’avec toutes sortes de nuances. Et elle ne s’applique pas à Georges Eekhoud et Camille Lemonnier, influencés par le naturalisme. Il en va de même en peinture : les « symbolistes » Léon Spilliaert et Fernand Khnopff ont l’un et l’autre un style très singulier. James Ensor et Félicien Rops, qui possédaient tous deux un grand talent d’invention verbale, sont inclassables.
Bruxelles au tournant des XIXe et XXe siècles fut aussi, avec Paris, Vienne et Barcelone, un des hauts lieux de l’art nouveau. Mentionnant au passage Paul Hankar, Eric Min consacre de longues pages aux architectes Victor Horta et Henry van de Velde. Le premier n’aimait guère le second, qu’il considérait comme « un peintre défroqué » (il avait effectivement commencé sa carrière comme peintre). Il enviait son succès, qu’il comparait au manque de reconnaissance dont lui-même souffrait. Horta avait ramené de Paris l’idée d’une architecture légère basée sur l’utilisation de la lumière naturelle. Il l’exploita dans de nombreux hôtels particuliers (dont le sien), une série de grands magasins et ce qui fut son chef-d’œuvre, la Maison du Peuple, construite pour le Parti ouvrier belge. Il eut la tristesse d’assister au saccage de certaines de ses réalisations et la chance de ne pas voir la destruction de la Maison du Peuple, en 1960, abandonnée par le Parti socialiste qui y voyait le vestige d’un passé révolu. Van de Velde, lui, après une brillante carrière en Allemagne, revint en Belgique où il fonda et dirigea l’Institut supérieur des arts décoratifs, aujourd’hui École de La Cambre, du nom de l’ancienne abbaye qui l’abrite.
Et puis il y avait les anarchistes. Eric Min décrit l’histoire de l’arrivée et de l’installation à Bruxelles du géographe libertaire Élisée Reclus, en compagnie de son frère Élie. L’Université Libre de Bruxelles ayant renoncé au dernier moment à lui donner un poste, il se vit offrir une chaire à l’Université nouvelle, institution créée à cette occasion. Sa réputation et son charme attiraient notamment les jeunes femmes. Végétarien, partisan de l’union libre, Reclus a été décrit par un journal bruxellois comme « un maître en géographies féminines comparées ». Eric Min raconte aussi l’histoire d’une éphémère communauté anarchiste établie dans la banlieue bruxelloise de Stockel, baptisée « L’Expérience ». Une expérience qui ne débouchera sur rien. « Philosophes et artistes, écrira un des participants, vagabonds et clandestins, savants et ignorants, militants et intrigants, rêveurs et hommes d’action, coupeurs de cheveux en quatre et briseurs de vitres, parasites et entrepreneurs […], tous n’ont fait que passer, victimes de leurs illusions diverses. »
Quelques figures éminentes du monde politique apparaissent dans l’ouvrage. Ainsi le bourgmestre (maire) de la ville Jules Anspach, le « Haussmann bruxellois », qui organisa le voûtement de la Senne (la rivière qui traverse Bruxelles, à présent invisible), le percement des grands boulevards du centre et une série de grands travaux d’urbanisme voulus par le roi Léopold II. Et l’un de ses successeurs, Charles Buls, le « bourgmestre esthète », ami des beaux-arts et défenseur du patrimoine. Le monde économique est présent avec le baron Empain, ingénieur, fondateur de la dynastie d’hommes d’affaires qui porte son nom, dont les sociétés construisirent des lignes de tramways en Belgique, au Congo belge et en Égypte, ainsi qu’Ernest Solvay, ami d’Horta, chimiste et industriel, mécène de l’Université Libre de Bruxelles et de plusieurs initiatives scientifiques dont les célèbres Congrès Solvay de physique et chimie, qui rassemblaient les plus grands savants de l’époque.
L’élan acquis à l’âge d’or de Bruxelles se maintint quelque peu au début du XXe siècle. L’évolution de la manière architecturale d’Horta, abandonnant, pour ses deux dernières grandes réalisations, le Palais des Beaux-Arts et la gare centrale, la profusion des formes fleuries et courbes pour un style plus dépouillé et des lignes géométriques, donna le signal d’une explosion d’art déco dans la capitale durant les années 1920 et 1930. À la même époque, le mouvement surréaliste, né en France, suscita l’apparition d’un groupe surréaliste bruxellois autour du poète Paul Nougé et du peintre René Magritte. Après la Seconde Guerre mondiale, l’Exposition universelle de 1958 fut un grand moment de célébration de la modernité et de rayonnement international. Mais sa tenue marque aussi le début du processus connu dans les écoles d’architecture et d’urbanisme sous le nom de « bruxellisation » : la destruction de quartiers anciens entiers livrés à la spéculation immobilière sous l’effet d’une volonté effrénée de modernisation et de l’appât du gain. Elle affectera une partie importante du centre et de l’est de la ville ainsi que ce qui est aujourd’hui appelé le « quartier européen », né de l’acquisition progressive par Bruxelles du statut de capitale administrative de l’Union européenne. Aujourd’hui, Bruxelles est une ville internationale d’une manière différente de celle dont elle l’était au XIXe siècle. Sa population comprend des ressortissants de quelque 180 nationalités, dont 70 000 Français, de nombreux expatriés de toute l’Europe et une forte proportion d’immigrés de pays du Sud. On y parle un nombre de langues vraisemblablement très supérieur à la centaine. Le français y est la langue la plus parlée (le néerlandais l’est peu, et de moins en moins), mais il est talonné par l’anglais, qui sert de langue de communication entre les différents groupes nationaux. Dressé sur un des points les plus élevés de la ville, le Palais de Justice continue à dominer celle-ci de sa masse cyclopéenne. Victime de son gigantisme, il s’est progressivement dégradé. Un chantier de rénovation de la coupole et des façades a été lancé en 1984. Durant quarante ans, l’édifice n’a été visible qu’enfermé dans une cage d’échafaudages. On en a récemment démonté une partie, mais les travaux de restauration de l’extérieur du bâtiment ne sont pas terminés. Ils devraient l’être en 2030, pour le 200e anniversaire de la création de la Belgique.