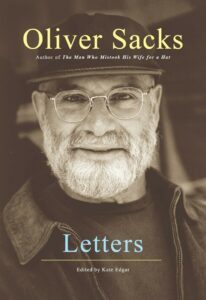Oliver Sacks en toutes lettres
Publié en décembre 2024. Par Michel André.
L’auteur de L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau a laissé une énorme correspondance, dont sa collaboratrice a sélectionné de quoi faire un volume de 700 pages. Plongée dans l’univers foisonnant d’un esprit hors du commun.

Oliver Sacks vivait la plume à la main. Le célèbre neurologue et auteur d’histoires médicales, un genre qu’il a largement contribué à faire connaître et populariser, est décédé en 2015 à l’âge de 82 ans. À côté de textes inédits dont certains furent repris dans deux recueils posthumes, il laissait dans ses archives 70 boîtes de correspondance contenant quelque 200 000 pages : il gardait copie de la plupart des lettres qu’il envoyait. De cette masse, Kate Edgar, qui fut sa secrétaire, son assistante et sa collaboratrice pour la fabrication de tous ses livres à partir du quatrième (L’Homme qui prenait sa femme pour un chapeau), a extrait quelques centaines de lettres. Représentant une petite fraction du total, elles composent malgré tout un volume de 700 pages : épistolier compulsif, Sacks était également souvent prolixe et beaucoup parmi les lettres sélectionnées sont très longues. Les premières datent de 1960, peu après son arrivée aux États-Unis à l’âge de 27 ans, les dernières de quelques jours avant sa mort.
Loin de faire double emploi avec ses deux livres d’autobiographie Oncle Tungstène et En mouvement, ce volume de correspondance les complète heureusement : parce qu’il s’y livre au jour le jour dans toutes ses contradictions et ses humeurs changeantes, torturé mais plein d’excitation et d’enthousiasme, absorbé par lui-même mais généreux, on y approche au plus près sa personnalité et sa vitalité hors du commun. La variété de ses intérêts, la vivacité de sa curiosité, la finesse psychologique de ses observations, l’étendue de ses connaissances en médecine, biologie et psychologie, mais aussi en histoire des sciences, philosophie et littérature, donnent à cette correspondance une richesse exceptionnelle.
Si Oliver Sacks, né à Londres dans une famille de médecins juifs, est parti aux États-Unis, c’était pour fuir l’environnement dans lequel il avait grandi et l’avenir dont ses parents rêvaient pour lui : épouser une jeune fille juive et reprendre le cabinet médical de son père. Traumatisé par son séjour, au moment du Blitz, dans un internat dur et sinistre où il avait été envoyé en conformité avec les consignes du gouvernement, il l’était tout autant par la présence à ses côtés d’un frère schizophrène et par la réaction violente de sa mère lorsqu’elle découvrit son homosexualité. Ce qui l’avait sauvé était sa passion dévorante pour les sciences naturelles et la chimie, qui suscitait chez lui des sentiments violemment affectifs. Mais il ne songeait qu’à s’éloigner le plus possible de l’Angleterre. Une fois son diplôme de médecine obtenu à Oxford, après un crochet par le Canada, il s’installa aux États-Unis. Le pays l’attirait par « sa splendeur géographique, son énergie […], son excitante nouveauté ». Il rêvait plus particulièrement de la Californie, où vivait le poète Thom Gunn, qu’il admirait : il l’y rencontra, ils devinrent amis (mais pas amants) et il resta un de ses correspondants réguliers.
Tout en travaillant dans un hôpital de San Francisco et poursuivant une formation en neuropathologie à l’Université de Californie à Los Angeles, il se livra durant plusieurs années à ce qui allait constituer ses grandes passions de jeunesse, poursuivies avec excès comme tout ce qu’il entreprenait : la moto, la musculation et l’haltérophilie, ainsi que la consommation de drogues excitantes ou hallucinogènes et de psychotropes (hashish, mescaline, morphine, cocaïne, amphétamines, LSD). Ce furent également des années d’aventures sentimentales. En 1965, à l’occasion d’un voyage en Europe, il fit la connaissance d’un jeune et très beau directeur de théâtre hongrois nommé Jenö Vincze. Durant quelques mois, ils vécurent une liaison fiévreuse d’une intensité dont témoignent plusieurs lettres de Sacks, brûlantes de passion. Lorsqu’elle prit fin à sa propre initiative – il était apparemment terrifié à l’idée d’une vie commune –, Sacks vécut strictement solitaire sur le plan amoureux pendant 43 ans. À l’âge de 75 ans, il rencontrera l’écrivain Bill Hayes qui fut son compagnon durant ses dernières années.
Les principaux destinataires des lettres des premières années sont ses parents, ses frères et l’auteur et directeur de théâtre et d’opéra Jonathan Miller, qui était un ami d’école. Leur contenu est surtout personnel. Il y raconte sa vie et y fait fréquemment part de ses interrogations sur son identité et de ses doutes, y compris au sujet de sa vocation médicale. En 1961, il avouait ainsi à ses parents éprouver « une extrême aversion pour les patients, la maladie, les hôpitaux et tout particulièrement les médecins ». Neuf ans plus tard, il leur écrivait toutefois : « Je pense que je suis un bon (et, très rarement, à des moments magiques), un grand professeur : non parce que je communique des faits, mais parce que d’une manière ou d’une autre je transmets une sorte de passion pour le patient […], une sensation de la texture des patients, de la manière dont leurs symptômes se raccordent à leur personnalité et [...] à leur environnement. »
À ce moment-là, il avait jugulé ses pulsions autodestructrices et commencé à trouver une sorte d’équilibre qu’il allait bientôt consolider en voyant une fois par semaine un même psychanalyste durant 49 ans. Et il s’était établi à New York, où il travailla dans plusieurs hôpitaux et institutions hospitalières. Il s’y occupa tout d’abord de malades atteints d’encéphalite léthargique (c’est l’histoire racontée dans son livre L’Éveil et le film qui en a été tiré), puis de patients souffrant d’une grande variété de troubles neurologiques ou des sens. Ainsi que le montrent plusieurs lettres, il s’y trouva souvent en butte à l’hostilité du corps professoral et médical, qui n’appréciait ni ses méthodes, ni sa personnalité excentrique, ni son comportement peu discipliné. C’est de ce travail que sont tirées les études de cas rassemblées dans ses livres ultérieurs. Il y décrit les symptômes que présentent les malades, mais aussi les stratégies qu’ils emploient pour compenser les carences dont ils souffrent, éléments de la clinique qui lui semblent autant nécessaires à la compréhension de la maladie que les données physiologiques.
Sacks souffrait lui-même de certains troubles, par exemple une grande difficulté à reconnaître les lieux et les visages, et pensait présenter certains traits d’autres maladies. Dans son effort pour comprendre le monde dans lequel vivaient ses patients, il faisait appel à l’introspection. Il l’explique dans une lettre au neurologue russe Alexandre Luria, pionnier de la formule du récit clinique, qu’il s’est employé à appliquer : « Lorsque j’avais 10 ans, j’ai développé une passion absolue pour l’astronomie, et c’est cette sorte de passion, je pense, qui me domine aujourd’hui encore […], mais il y a eu un changement de direction […]. Avec les années, et presque contre ma volonté, je suis devenu une sorte d’astronome de l’intime, concentré […] sur mes propres états mentaux, mais faisant cela (j’aime à le penser) pour apprendre quelque chose au sujet d’autres esprits que le mien […], parce que si je suis unique – comme tout le monde est unique – je suis aussi semblable à n’importe qui d’autre, ce que j’observe en moi-même se produit certainement chez les autres également. »
Luria n’est qu’une des personnalités connues qui apparaissent dans ce recueil de lettres. À partir d’un certain moment, la notoriété venant avec le succès de ses livres, le nombre de ses correspondants s’est fortement accru. Durant la dernière partie de sa vie, plusieurs milliers de lettres lui étaient adressées par an, auxquelles il se faisait un devoir de répondre. Lui-même, mû par son insatiable curiosité et son goût pour les gens, n’hésitait pas à prendre contact avec des savants ou des écrivains dont les livres lui avaient plu ou dont il aurait aimé avoir l’avis. Le plus souvent, l’échange commençait sur un ton assez formel. Au bout de quelques lettres, on passait à l’emploi du prénom et très souvent une réelle amitié s’ensuivait. Parmi les personnes avec lesquelles il s’est ainsi trouvé en relation régulière, voire amicale, figurent Gerald Edelman et Antonio Damasio, deux neurologues dont il partageait les idées, le biologiste Francis Crick, le physicien Freeman Dyson, les philosophes Daniel Dennett et Peter Singer, le poète W. H. Auden, les critiques Frank Kermode et Susan Sontag, l’écrivain Paul Theroux et bien d’autres. Mais on trouve à côté d’eux de nombreuses personnes moins connues, voire carrément inconnues. À toutes, il s’adressait avec beaucoup de chaleur et de délicatesse, parlant souvent de lui-même, de ses objets d’intérêt et de ses passions, mais sans ostentation. Lorsqu’il s’agissait d’une personne malade ou dont un proche l’était, il manifestait toujours une extrême compassion.
En 2006, Oliver Sacks apprit qu’il était atteint d’un mélanome à l’œil droit. Une intervention chirurgicale au laser le laissa apparemment guéri, mais quelque temps après il devint borgne de l’œil opéré. Neuf ans plus tard – il avait entretemps publié trois livres supplémentaires –, on découvrit que le cancer avait récidivé et développé des métastases au foie. Sacks savait qu’il n’en avait plus que pour quelques mois. On accéléra le processus de publication de son second livre de souvenirs, de manière à ce qu’il paraisse encore de son vivant, de même que la préparation de ce qui allait devenir un de ses recueils de textes posthumes. Il avertit les membres de sa famille et ses amis de sa fin imminente. Les lettres dans lesquelles il leur fait part de la sombre nouvelle sont franches, factuelles et dépourvues de la moindre trace d’auto-apitoiement. C’est aussi le cas de l’article du New York Times par l’intermédiaire duquel il rendit l’information publique. Cet article figure dans le petit livre intitulé Gratitude en compagnie notamment de deux autres textes rédigés durant les derniers mois de sa vie. Celui qui clôt le livre, écrit trois semaines avant sa mort, a pour titre « Sabbat ». Il y évoque ses souvenirs de la célébration de cette fête lorsqu’il était enfant.
Les rapports de Sacks avec la judéité ont toujours été compliqués. Dans une lettre, il parle du fait d’être né juif comme « à la fois une malédiction et une bénédiction » et exprime clairement ses sentiments ambivalents à ce sujet : « Le côté dogmatique-doctrinal, légal-scholastique du judaïsme m’a toujours dégoûté, et a fortement contribué à m’éloigner de lui ; mais la profondeur, la disposition pacifique, contemplative, hospitalière [...] du judaïsme dans sa dimension lyrique et méditative m’a attiré vers lui. » C’est cette dimension humaine et spirituelle, non nécessairement accompagnée d’une croyance religieuse, qu’il voit sans doute à l’œuvre dans l’idée du Sabbat, jour du repos mérité après une semaine de travail : « Je sens que j’ai accompli ma tâche, écrit-il à sa belle-sœur dans des termes similaires à ceux du texte publié, à tout le moins que j’ai fait ce que je pouvais, et que le temps qui me reste devrait être une sorte de paisible Sabbat de fin de la vie, et j’éprouve une impression de sérénité et d’acquiescement. » Commencée dans les tourments, l’existence d’Oliver Sacks s’est peu à peu apaisée et s’est achevée par une sorte de réconciliation avec lui-même. De cette trajectoire et des soubresauts par lesquels sa vie est passée, ses lettres retracent en quelque sorte l’histoire en temps réel. Cette caractéristique, l’intelligence et la profonde humanité qui s’y expriment constamment, ainsi que le brio de son style et sa grande qualité littéraire font de ce recueil de lettres un de ses meilleurs livres.