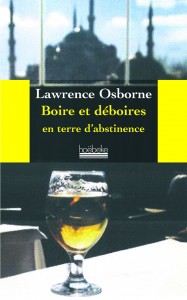Mémoires d’alcool en terre d’islam
Publié en avril 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.

Lawrence Osborne, ©Chris Wise
«Une telle odeur de vin émanera de ma tombe
que les passants en seront enivrés.
Une telle sérénité entourera ma tombe
que les amants ne pourront s'en éloigner.»
Omar Khayyâm (Rubaiyat).
Il faut descendre la rue Furn El Hayek, dont la pente est douce, pour atteindre la rue de l’Université Saint-Joseph et le Time Out, lové dans les entrailles d’une vieille maison ottomane qui a essuyé le feu de la guerre civile – « les gens qui nous tiraient dessus habitaient la maison voisine » dit simplement Jacques Tabet, le maître des lieux. Ceux qui viennent là trouvent généralement accoudé au comptoir cet homme que l’écrivain Lawrence Osborne nous présente comme le plus généreux et le plus grincheux des propriétaires de bar de Beyrouth ; l’un des personnages qui font le charme surprenant d’un récit insolemment consacré à l’alcool dans le monde musulman et tout juste publié, Boire et déboires en terre d’abstinence. C’est drôle comme un livre peut en cacher un autre. Celui-là n’avait, a priori, rien pour me plaire, à en juger d’après la couche superficielle de son épiderme. Un grand écrivain britannique, journaliste de haut vol pour les pages « lifestyle » des plus prestigieux magazines papier glacé, hante les grands hôtels du monde musulman pour y biberonner à partir de 18 h 10 tapantes son sacro-saint cocktail – enfin, ses sacro-saints cocktails, puisqu’il en faut plusieurs à ce « buveur endurci » – au motif d’explorer le « choc des civilisations » entre Orient et Occident sous l’angle de la fracture entre régime « sec » et « arrosé ». En ces temps d’islamophobie rampante où tout est bon pour accentuer d’un nouveau trait de crayon 4B la caricature du monde arabo-musulman, le lascar pouvait bien écrire comme un dieu, l’aventure ne me disait rien qui vaille. Jusqu’à ce qu’un sourire change tout, lancé dès les premières pages par une musulmane du Golfe à l’auteur, dans un bar de Milan où il s’est très sérieusement laissé ensorceler par l’odeur d’herbe givrée d’une série de Gins Tonic : « La matriarche arabe me jeta un coup d’œil et je devinai sans peine ce qu’elle pensait. A ma grande surprise, cependant, elle leva soudain son verre d’eau et sourit. » Lawrence Osborne n’a pas besoin d’en dire davantage pour signifier qu’il ne part pas en croisade : ce poivrot a du respect pour une tradition qui prohibe la substance dont il a fait, dit-il, son « bâton de vie ». Dans ces pays qui ont « choisi de dire non aux plaisirs corrosifs de l’alcool », écrit-il, « l’énigme qu’il représente est plus fragile, méprisée et redoutée avec davantage de lucidité. Les raisons qu’on a de haïr cette énigme sont toutes valides. » Mais les raisons qu’on a de l’adorer, aussi. Au Time Out où « les soirées s’écoulent sous les voûtes de pierre ébréchée que l’on pourrait prendre pour de la craie, parmi les chats de la maison et les hommes qui portent encore sur leurs visages et dans leurs gestes cette guerre lointaine », Jacques Tabet sert une palanquée de portos rouges et lâche : « J’ai horreur d’être sobre, c’est un état qui m’exaspère, comme il vous exaspère aussi, j’en suis sûr. Si j’avais été sobre, pendant toutes ces années, je n’aurais pas survécu. » Qu’ont donc d’infortunes et de grâces en plus ceux qui ont pris l’alcool pour moyen d’apprivoiser la vie ? La question imprègne ces pages et si Lawrence Osborne est allé chercher la réponse en terre d’abstinence, c’est parce que l’interdit donne davantage d’éclat au mystère.L’auteur qui la pose est resté fidèle au petit garçon qui jouait à la vie, à la mort avec l’alcool et les moissonneuses-batteuses dans les champs de blé anglais de son enfance : « Les conducteurs ne voyaient rien de ce qui se passait au sol. Tour à tour, nous lampions une gorgée de vodka, dans le bouchon métallique d’une bouteille dérobée à nos parents. Nous nous allongions sur le chemin des moissonneuses-batteuses, cachés dans le blé, puis au tout dernier moment, nous roulions hors d’atteinte des lames qui tournoyaient. C’était la vodka qui nous en rendait capables. » Il n’aura pas fallu longtemps pour pénétrer les couches profondes de l’épiderme. En partant explorer la fascination qu’exerce l’alcool sur les sociétés arabo-musulmanes, fascination décuplée par l’interdit, Lawrence Osborne sonde d’abord la sienne. Un groupe d’islamistes de la ville ultra-rigoriste de Solo, en Indonésie, l’y aide d’emblée. C’est l’une des rencontres les plus sidérantes du livre. Là, dans cette ville « sans alcool » de 600 000 habitants d’où sont partis les responsables de l’attentat de Bali, l’écrivain en manque demande à des étudiants coraniques qui portent la tenue blanche traditionnelle s’ils connaissent un restaurant qui lui servirait une bière. Aussitôt dit, aussitôt regretté. Mais leur foudre ne s’abat pas sur lui. « Ils m’invitèrent à venir prendre un café avec eux, afin que nous “discutions” » S’ensuit un dialogue improbable mais vrai : ne voit-il pas les désastres que l’alcool inflige au monde occidental ? Que c’est une plaie, une maladie de l’âme ? Si, il voit. Plus tard, du fond d’un Gin Tonic (« cette boisson fait partie de mon patrimoine ») : « Je me rappelai tout particulièrement l’expression “une maladie de l’âme”, parce que plus j’y pensais, plus je me sentais incapable de la contester, même s’il m’était tout aussi impossible de l’entériner. » Lawrence Osborne n’est pas du genre à jouer les vierges effarouchées sur les désarrois du buveur, sans tomber jamais dans l’apitoiement. « Chacun est responsable de ses propres naufrages », écrit-il, et c’est bien plus que politesse du désespoir. Il accepte d’avance le prix de l’accès à l’ivresse car elle est à ses yeux une forme d’immanence, de celles qui amènent à se battre contre des moissonneuses-batteuses et permettent de lutter contre la « conviction démente qu’il n’existe rien d’autre que le quotidien ». [caption id="attachment_36434" align="alignnone" width="680"]Lawrence Osborne accepte d’avance le prix de l’accès à l’ivresse car elle est à ses yeux une forme d’immanence, de celles qui permettent de lutter contre la « conviction démente qu’il n’existe rien d’autre que le quotidien ».
 Café El Fishawi, Le Caire ©Mohannad Khatib[/caption]
Il suffit à l’écrivain de se poser à quelques encablures du port de Batroun, sur la côte libanaise, pour arrimer son récit à cette très vieille histoire. C’est peut-être de là, confie la propriétaire du domaine des Côteaux de Botrys, que Dionysos aurait fait voile vers la Grèce, qu’il serait « parti à bord des navires qui faisaient le commerce du vin vers l’Attique ». Dionysos, dont le culte était le plus populaire du bas empire romain, dieu du théâtre, des vergers en fleur et du vin. Que le poète Pindare assimilait à la « pure lumière du plein été ». « Le buveur ou la buveuse qui se dirige mollement, chaque soir, vers le bar dans lequel il ou elle croit voir son Bethléem, est en quête de sa propre version de la stupéfiante intuition de Pindare, songe Osborne. Nous voulons, ne serait-ce que pour quelques instants, la “pure lumière du plein été” au-dedans de nous. »
Mais Dionysos est aussi un dieu de mort et de sacrifice. L’écrivain qui arpente le monde escorté par ses fantômes, galerie d’êtres déchiquetés entre les ténèbres et les lumières de l’alcool, le sait mieux que personne. Voici le grand-oncle John, éditeur à la Liverpool University Press, insupportable, céleste, de l’engeance de ces parents suffisamment éloignés pour pouvoir transmettre aux enfants une certaine idée de la liberté, de ceux qu’on ne voit jamais mais qui envahissent tout de leur présence énorme quand ils débarquent enfin, une fois l’an ou à peu près. « Il faisait surface tous les 24 décembre, en compagnie d’une nouvelle petite amie, tout juste descendu d’un paquebot transatlantique ou de l’avion de Madrid, se présentait à notre porte d’entrée couvert de neige et filait s’asseoir au piano, en remontant ses manchettes, pour se mettre à jouer et à chanter sans en être prié, maboul et ivre. Petit garçon, je l’adorais. J’admirais son intrépidité. J’admirais la façon dont, au repas de Noël, il portait un toast individuel à chacun des convives, et avec du Glenfiddich pur s’il vous plaît, avant de se mettre à brailler une de ses compositions sans queue ni tête. » Ténèbres ou lumières ?
Et puis, il y a cette femme sans même un prénom. Une femme dont l’esprit – elle vient de mourir – accompagne Lawrence Osborne quand il s’installe pour quelque temps à Istanbul : « Le plus triste, c’est que je n’avais pas pu partager avec elle un dernier Famous Grouse et que je dois maintenant le boire tout seul, dans un bar d’Istanbul. Elle adorait le Bosphore, sans doute parce que Lord Byron l’avait traversé à la nage et parce qu’il l’adorait, lui aussi ». Elle l’accompagne toujours dans la chambre un peu miteuse de ce palace magnifiquement décati qu’est, paraît-il, l’hôtel Bristol du Caire. L’auteur est venu dénicher en Egypte deux Libanais qui exploitent le seul vignoble du pays et produisent un vin pétillant rosé « rafraîchissant, acide, bien fait ». Le crépuscule est tombé et il porte un toast muet à l’âme sœur « qui aurait pris plaisir à le boire avec moi, dans cette chambre sombre qui sent le moisi et dont les volets sont en train de se dégonder. » C’est elle, sa mère, qui lui a transmis l’habitude de boire pour stimuler l’imagination, et à laquelle, donc, il doit tout puisqu’il est aujourd’hui salué par la critique unanime comme le nouveau Graham Greene.
Elle m’est apparue comme le plus beau personnage du livre, précisément parce que son fils en esquisse les traits avec une délicatesse tourmentée qui bouleverse ; parce qu’il raconte la maladie de son âme avec une infinie décence. Journaliste et dramaturge pour la radio, elle avait développé son goût pour le Famous Grouse lorsque la famille avait quitté le centre de Londres pour Haywards Heath, fief conservateur à une heure de Londres, « forteresse de la vertu privée, protégée par un millier de pelouses, de haies d’ifs et de grilles en fer forgé », où les femmes éclusaient toute la journée un ennui gluant dans leurs grandes maisons désertées par des époux partis faire affaires : « C’était une femme qui avait dérivé de manière presque fortuite dans une existence qui n’était pas vraiment celle qu’elle avait prévu de mener. Mais comme c’est souvent le cas, un mari loyal et travailleur, un homme doté d’un sens de l’humour et de la faculté d’aimer ses enfants, était parvenu à la séduire. Et pourquoi ne pas être séduite ? L’existence banlieusarde de Haywards Heath après Naples, la vie conjugale après sa carrière de journaliste en cavale, durent être pour elle un sacré choc. A mesure que les années passaient, elle se mit à boire. » Je n’ai pas pu m’empêcher de lui donner en imagination le visage de Gena Rowlands. Ténèbres ou lumières ?
Café El Fishawi, Le Caire ©Mohannad Khatib[/caption]
Il suffit à l’écrivain de se poser à quelques encablures du port de Batroun, sur la côte libanaise, pour arrimer son récit à cette très vieille histoire. C’est peut-être de là, confie la propriétaire du domaine des Côteaux de Botrys, que Dionysos aurait fait voile vers la Grèce, qu’il serait « parti à bord des navires qui faisaient le commerce du vin vers l’Attique ». Dionysos, dont le culte était le plus populaire du bas empire romain, dieu du théâtre, des vergers en fleur et du vin. Que le poète Pindare assimilait à la « pure lumière du plein été ». « Le buveur ou la buveuse qui se dirige mollement, chaque soir, vers le bar dans lequel il ou elle croit voir son Bethléem, est en quête de sa propre version de la stupéfiante intuition de Pindare, songe Osborne. Nous voulons, ne serait-ce que pour quelques instants, la “pure lumière du plein été” au-dedans de nous. »
Mais Dionysos est aussi un dieu de mort et de sacrifice. L’écrivain qui arpente le monde escorté par ses fantômes, galerie d’êtres déchiquetés entre les ténèbres et les lumières de l’alcool, le sait mieux que personne. Voici le grand-oncle John, éditeur à la Liverpool University Press, insupportable, céleste, de l’engeance de ces parents suffisamment éloignés pour pouvoir transmettre aux enfants une certaine idée de la liberté, de ceux qu’on ne voit jamais mais qui envahissent tout de leur présence énorme quand ils débarquent enfin, une fois l’an ou à peu près. « Il faisait surface tous les 24 décembre, en compagnie d’une nouvelle petite amie, tout juste descendu d’un paquebot transatlantique ou de l’avion de Madrid, se présentait à notre porte d’entrée couvert de neige et filait s’asseoir au piano, en remontant ses manchettes, pour se mettre à jouer et à chanter sans en être prié, maboul et ivre. Petit garçon, je l’adorais. J’admirais son intrépidité. J’admirais la façon dont, au repas de Noël, il portait un toast individuel à chacun des convives, et avec du Glenfiddich pur s’il vous plaît, avant de se mettre à brailler une de ses compositions sans queue ni tête. » Ténèbres ou lumières ?
Et puis, il y a cette femme sans même un prénom. Une femme dont l’esprit – elle vient de mourir – accompagne Lawrence Osborne quand il s’installe pour quelque temps à Istanbul : « Le plus triste, c’est que je n’avais pas pu partager avec elle un dernier Famous Grouse et que je dois maintenant le boire tout seul, dans un bar d’Istanbul. Elle adorait le Bosphore, sans doute parce que Lord Byron l’avait traversé à la nage et parce qu’il l’adorait, lui aussi ». Elle l’accompagne toujours dans la chambre un peu miteuse de ce palace magnifiquement décati qu’est, paraît-il, l’hôtel Bristol du Caire. L’auteur est venu dénicher en Egypte deux Libanais qui exploitent le seul vignoble du pays et produisent un vin pétillant rosé « rafraîchissant, acide, bien fait ». Le crépuscule est tombé et il porte un toast muet à l’âme sœur « qui aurait pris plaisir à le boire avec moi, dans cette chambre sombre qui sent le moisi et dont les volets sont en train de se dégonder. » C’est elle, sa mère, qui lui a transmis l’habitude de boire pour stimuler l’imagination, et à laquelle, donc, il doit tout puisqu’il est aujourd’hui salué par la critique unanime comme le nouveau Graham Greene.
Elle m’est apparue comme le plus beau personnage du livre, précisément parce que son fils en esquisse les traits avec une délicatesse tourmentée qui bouleverse ; parce qu’il raconte la maladie de son âme avec une infinie décence. Journaliste et dramaturge pour la radio, elle avait développé son goût pour le Famous Grouse lorsque la famille avait quitté le centre de Londres pour Haywards Heath, fief conservateur à une heure de Londres, « forteresse de la vertu privée, protégée par un millier de pelouses, de haies d’ifs et de grilles en fer forgé », où les femmes éclusaient toute la journée un ennui gluant dans leurs grandes maisons désertées par des époux partis faire affaires : « C’était une femme qui avait dérivé de manière presque fortuite dans une existence qui n’était pas vraiment celle qu’elle avait prévu de mener. Mais comme c’est souvent le cas, un mari loyal et travailleur, un homme doté d’un sens de l’humour et de la faculté d’aimer ses enfants, était parvenu à la séduire. Et pourquoi ne pas être séduite ? L’existence banlieusarde de Haywards Heath après Naples, la vie conjugale après sa carrière de journaliste en cavale, durent être pour elle un sacré choc. A mesure que les années passaient, elle se mit à boire. » Je n’ai pas pu m’empêcher de lui donner en imagination le visage de Gena Rowlands. Ténèbres ou lumières ?
Lawrence Osborne ne le sait pas, qui est capable de dire ici que « la solitude d’un bar est si absolue, si ravageuse qu’on se demande pourquoi Edward Hopper ne l’a pas peinte plus souvent », et là que « le mal de vivre et la frustration légendaires de l’ivrogne sont souvent exagérés ». Il ne sait pas, mais il choisit. Je crois que cela s’est passé justement dans cette chambre de l’hôtel Bristol, au moment du toast muet à sa mère, en sirotant ce « très bon vin » pétillant du Delta du Nil, Le Baron, « une noble tentative de réussir quelque chose de compliqué et difficile » : « Je le bus lentement, au lit. La pièce s’emplit de la lumière que diffusaient les lampes à acétylène dans la rue. Plus qu’à n’importe quel autre moment, durant ces deux années, je sentis les mots de Pindare me revenir en tête, tandis que je vidais entièrement ma bouteille de “bulles” égyptiennes. Les mots qui décrivaient le dieu Dionysos : hagnon phengos oporas, “la pure lumière du plein été”. C’était une expression que je ne parvenais pas à oublier et je veux bien croire qu’elle dénotait quelque chose que j’avais cherché toute ma vie. Cette lumière paraissait m’emplir à ce moment précis, jaillissant de ces délicates bulles roses qui nageaient au bord d’un verre à vin bon marché, souillé par une fourmi morte. Lorsque je me réveillais, ma mère était partie et j’étais tout seul au soleil. » Alors, lumières ! En fait de croisade, ce livre est une célébration. Ecoutez Lawrence Osborne évoquer le parfum de chocolat blanc des vodkas du maître distillateur suédois Börje Karlsson, par ailleurs inventeur de l’Absolut ; citer le poète persan Abu Nuwas, qui disait de l’arak (boisson nationale au Liban) qu’il avait « la couleur de l’eau de pluie » mais était « aussi chaud au-dedans que les côtés d’une torche enflammée » ; décrire par le menu la fabrication des single malts exceptionnels de l’ïle d’Islay, ce lieu magique des Hébrides intérieures où l’on se déplace « au milieu de tempêtes de pluie salée » et qui ressemble à la Grèce en hiver. Après le maltage, « pendant quinze heures, un feu de tourbe crache sa fumée odorante dans le four et sature l’orge séchée de ses arômes. La distillerie Laphroaig tourbe intensément ses whiskies. Les connaisseurs disent que la plupart des scotches peuvent se vanter de posséder une demi-douzaine de saveurs de fumée, alors que le Laphroaig en révèle au moins quatorze ». Il émane de ce récit une sensualité communicative.Est-ce que nous ne devons pas l’alambic à un alchimiste musulman du VIIIe siècle et l’al-kohl aux alchimistes arabes du XIIe ? N’existe-t-il pas une grande tradition arabo-persane de poésie bachique ?
Nulle part ailleurs plus qu’à ses côtés sur l’île d’Islay le lecteur ne prend conscience que Lawrence Osborne parcourt le Liban, la Malaisie, Dubai, l’Indonésie, la Turquie ou le Pakistan en quête d’alcool d’abord parce qu’un monde au régime sec lui paraît plus râpeux pour l’âme. On boit « parce qu’on est humain et qu’il délicieux de boire », avait-il prévenu dès la première page. Voilà pourquoi il est venu fêter, au cœur de cette civilisation arabo-musulmane plus lucide sur ses méfaits, un art de vivre avec l’alcool dont il refuse d’admettre l’effacement à mesure que progresse l’islam radical. Il en va d’un certain raffinement du monde. Est-ce que nous ne devons pas l’alambic à un alchimiste musulman du VIIIe siècle et l’ al-kohl aux alchimistes arabes du XIIe ? N’existe-t-il pas une grande tradition arabo-persane de poésie bachique, incarnée dans le genre poétique des khamriyyat – littéralement « le plaisir de boire » ? Les poètes soufis n’ont-ils pas célébré l’ivresse, ce courant hétérodoxe voyant dans le vin la métaphore suprême de l’amour ? Lawrence Osborne nous emmène sur les traces de ce monde qu’il pense menacé. Il en tire un portrait de l’alcool en patrimoine commun de l’humanité. Regardez comme il « se déverse de partout » au Pakistan, où une longue histoire de cultures interfécondes lui a pavé la voie. Dans cette république islamique d’où l’alcool est banni, les « permit rooms » y pourvoient. Ces magasins de spiritueux très discrets sont fréquentés par les non-musulmans (munis de l’indispensable livret), qui ne se privent pas de revendre leur butin au prix fort. Le directeur de la brasserie Murree, le seul fabricant d’alcool du pays (bière, gin, vodka, whisky, souvent de bonne facture), propriété d’une famille parsie, tire la chose au clair. La firme qui n’a pas le droit d’exporter est censée écouler sa considérable production auprès des 5 % de non-musulmans du pays. Peu probable : « Nous savons tous que les non-musulmans en achètent pour les musulmans. C’est une combine florissante ». Et puisque la combine ne suffit pas à étancher toutes les soifs, les « bootleg wallahs » et leur contrebande font le reste, fournissant aux riches pakistanais leur Johnny Walker de prédilection pour des fêtes alcoolisées qui durent jusqu’au bout de la nuit. Comme de juste, Lawrence Osborne atterrit dans l’une de ces soirées privées, muni d’une bouteille de Gymkhana, honorable whisky de chez Murree : « Nous emplîmes les verres. Je remarquai que tout le monde se léchait les babines d’un air pensif, pendant un moment, tout en contemplant le fond de son verre. Quelqu’un mit en route un CD de Rabbi Shergill et bientôt la moitié des invités dansait, certains levant d’une main leur verre de Gymkhana tout en faisant tournoyer leur partenaire. Je reconnus aussitôt la chanson, une très belle version techno d’un poème mystique soufi de Bulleh Shah, poète pundjabi du XVIIIe siècle, dont la sépulture est au Pakistan. Bulleh écrit qu’il n’est pas “le croyant de la mosquée”, qu’il n’est ni musulman, ni hindou, ni parsi, et ne sait d’ailleurs pas qui ni ce qu’il est. La vidéo lyrique de Bulla Ki Jana, par Shergill, sonne comme un appel à la paix et à la tolérance. » Il fut un temps où Bagdad était la ville aux innombrables de tavernes, Istanbul la cité à la centaine de distilleries, et l’on boit de la bière en Egypte depuis des milliers d’années. Lawrence Osborne évoque pour finir avec une tendresse iconoclaste le sultan Mourad IV, mort ivre à 28 ans, qui tirait à l’arc sur les passants depuis les fenêtres du palais de Topkapi durant ses beuveries, devenu fou de chagrin après avoir perdu l’ami qui l’avait initié aux plaisirs du vin. C’est en lisant ce genre d’histoire que l’on comprend qu’Osborne aime, à travers l’alcool, les sociétés avec grain comme les existences avec aspérités. Rien ne l’indigne plus, au fond, que l’aseptisation du monde. Et il ne nous laisse pas le confort de croire que c’est une simple affaire d’islam : « Chaque société livre sa propre guerre contre le plaisir ». Dans l’un des passages les plus drôles du livre, il se souvient avec insolence du vieux bar de Brooklyn où il avait autrefois ses habitudes. « A l’époque, c’était un troquet qui faisait quelques chichis. On aurait dit le boudoir d’une mère maquerelle espagnole désorganisée. Les femmes qu’on y voyait étaient de merveilleuses et authentiques salopes, une race totalement éradiquée de notre ville par ces autocrates de la police, qui ont si hardiment amélioré nos existences à tous, en faisant de nos divers quartiers des endroits où les chihuahuas et les ménagères peuvent évoluer en toute sécurité. » Je déconseille ce livre aux amoureux des chihuahuas et aux ligues de tempérance.A Islamabad, les « bootleg wallahs » et leur marchandise de contrebande fournissent aux riches pakistanais leur Johnny Walker de prédilection pour des fêtes alcoolisées qui durent jusqu’au bout de la nuit.
L’objet fétiche
C’est un bas-relief en marbre que l’on peut voir au pied des marches de l’autel du temple de Bacchus/Dionysos (« le plus grand sanctuaire jamais consacré au dieu du vin »), à Baalbeck, au Liban. L’unique panneau sculpté représente une jeune danseuse, « parfaitement découpée avec sa chevelure et son chiton flottants ». Cette bacchante n’est pas plus grande que la main : « Je plaçai ma paume sur la fille de marbre et fermai les yeux. Il faut se rappeler en l’honneur de quoi elle dansait et pourquoi l’ivresse est le mystère le plus primitif qui soit. Dans l’univers méditerranéen, l’ivresse fut à l’origine d’une passion religieuse. » Plus tard, à Istanbul, au sortir d’une cérémonie soufie, face à la colonne de Marcien où figure une sculpture de la victoire ailée, Nike, dans sa robe flottante, Lawrence Osborne repense à la petite danseuse bachique du temple de Baalbeck : « C’était le même mouvement, une jeune fille qui avançait comme si elle dansait : ce qui nous rappelait que dans ce monde révolu, c’étaient aussi les jeunes filles qui dansaient en proie à l’ivresse et qui étaient donc immortalisées ainsi, les jeunes filles dont les formes évanescentes et extasiées étaient célébrées comme si elles devaient durer de toute éternité. »A lire aussi
C’est l’occasion où jamais de découvrir les romans de Lawrence Osborne traduits en français : Terminus Oasis, paru en mars chez Calmann-Lévy ; et Ania Malina, publié en 1990 chez Gallimard. Sur l’histoire des rapports entre l’islam et l’alcool, il faut lire et relire l’excellente Anthologie du vin et de l’ivresse en islam, de Malek Chebel (Pauvert, 2008). Et, parfaitement en condition après ces bonnes lectures, vous serez fin prêts pour la nouvelle édition du Salon des vins organisé par nos amis de Rue 89 : Sous les pavés la vigne, c’est le 30 avril et le 1er mai à Paris. Notez-le !Prochain rendez-vous le 29 avril, après une courte pause de printemps, pour une jolie balade en compagnie d’un randonneur de Palestine.