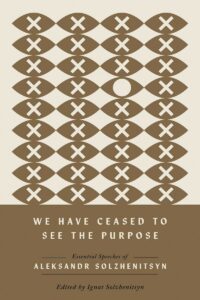Le déclin de l’Occident, selon Soljenitsyne
Publié en avril 2025. Par Books.
Quand en 1974 l’Occident, bras ouverts, accueillit Soljenitsyne, il ne s’attendait pas à la volée de bois vert qui allait lui être infligée. À peine le prix Nobel de littérature avait-il débarqué à Zurich, après avoir été déchu de la nationalité soviétique et expulsé d’URSS, que le ton était donné lors d’une conférence de presse avec des journalistes italiens. « Un jeune journaliste est venu me voir après », raconte Soljenitsyne ; « il était presque en larmes : “Dans tout ce que vous venez de dire, il n’y a rien pour mes lecteurs. Pourriez-vous être un peu plus clair ?” ». Clair, Soljenitsyne l’a résolument été ensuite, comme le montre la récente publication par son fils Ignat aux États-Unis des plus importants discours paternels entre 1974 et son retour en Russie en 1994. Mais l’Occident n’y gagnerait pas vraiment au change, se faisant étriller au fil d’harangues oraculaires prononcées (ou lues) un peu partout – à Stockholm, à Zurich, à Valley Forge, à Harvard, à Londres, à Liechtenstein même.
En vrac, Soljenitsyne y mettait en garde l’Ouest à la fois contre le communisme, dont « la sauvagerie intrinsèque et les projets impitoyables » étaient systématiquement occultés, mais aussi contre « la révérence d’une société d’adultes envers les opinions des enfants, l’enthousiasme fiévreux des jeunes pour des idées d’une valeur toujours déclinante, la lâcheté de leurs professeurs qui tremblent à l’idée de diverger par rapport à la dernière mode, l’usage irresponsable que font les journalistes des mots qu’ils diffusent à tout vent, la systématique sympathie envers les extrémistes, le mutisme de ceux qui pourraient protester, le défaitisme passif de la majorité, la faiblesse des gouvernements, la paralysie des mécanismes de défense des sociétés et l’effondrement spirituel qui ne peut conduire qu’aux cataclysmes politiques ». À toutes ces tares occidentales il fallait encore ajouter l’obsession « débilitante » des biens matériels, la prééminence concédée au légalisme, les « révoltants assauts de la publicité » et l’intolérable laideur de la musique moderne…
C’est à Harvard en juin 1978 que, face aux étudiants en fin d’année, Soljenitsyne allait mettre le plus brutalement les points sur les i dans un discours intitulé « Le déclin du courage », où tout le monde en prendrait pour son grade – « “les adolescents qui préfèrent la fainéantise à l’étude et à l’amélioration morale”, les avocats “qui défendent même les coupables manifestes”, les médias qui diffusent “de fausses nouvelles” et les politiciens à qui toute liberté est donnée “de promouvoir sans réfléchir tout ce que souhaitent leurs électeurs” », résume Leon Aron dans The Wall Street Journal. Bref, ce n’est vraiment pas ce modèle social-là que le prophète souhaitait voir transposé dans la Russie en devenir. Hélas, avec 30 décennies de recul, bien des vaticinations du sage du Vermont – hyper-patriotisme, exaltation de l’Amérique profonde, dénonciation de la corruption des intellectuels et du wokisme en émergence, propos ambigus sur les mérites d’un autoritarisme sélectif… – prennent une curieuse coloration proto-trumpiste. Mais à une grande réserve près, car Soljenitsyne invoque aussi deux palliatifs à la dérive de nos « pitoyables » sociétés dévitalisées et engluées dans le matériel. D’abord l’art (« celui qui est digne de ce nom ! »), et notamment la littérature « lorsqu’elle est porteuse de vérité ». Et surtout le retour « au spirituel », pris dans une perspective non pas religieuse (le prétendu prosélyte est plutôt discret sur le sujet) mais éthique : la quête au plus profond de soi de la distinction entre bien et mal, de l’amélioration morale et de la bonté. Pas sûr que ces admonestations-là aient retenti jusqu’aux rives du Potomac.