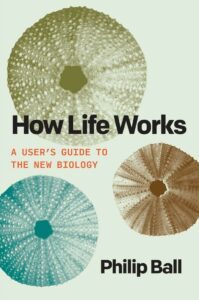La vie, c’est bien plus que les gènes
Publié en mars 2024. Par Michel André.
Le génome n’est pas un logiciel mécaniquement exécuté. Plutôt qu’un programme, c’est, pour l’organisme, une ressource.

En 1944, dans son petit livre Qu’est-ce que la vie ?, le physicien autrichien Erwin Schrödinger, s’autorisant une excursion en dehors de sa discipline, énonçait une idée appelée à connaître une grande fortune : si les organismes vivants sont capables de se reproduire (une des propriétés fondamentales qui les caractérisent) tout en se développant en tissus très différents, c’est que les gènes, support matériel de l’hérédité, constituent une sorte de code. Formulée en termes encore vagues, cette intuition fut une source d’inspiration pour un groupe de biologistes et de physiciens convertis à la biologie. Parmi les premiers, James Watson ; au nombre des seconds, Francis Crick et Maurice Wilkins. Tous les trois furent récompensés en 1962 par le prix Nobel de physiologie ou médecine pour la découverte de la structure « en double hélice » de l’ADN. Dans son livre de souvenirs, Watson, qui avouera plus tard avoir inventé l’anecdote, met en scène Crick, au moment où ils sentaient qu’ils avaient atteint leur but, proclamant devant la clientèle d’un pub où les deux scientifiques avaient leurs habitudes qu’ils venaient de « découvrir le secret de la vie ». Avec des mots plus grandiloquents encore, le président américain Bill Clinton, le 26 juin 2000, lors de l’annonce de l’achèvement du vaste projet international de cartographie du génome humain lancé en 1990, n’hésita pas à saluer l’occasion ainsi offerte « d’apprendre le langage dans lequel Dieu a créé la vie ».
Plutôt qu’une telle image biblique, c’était en réalité une comparaison technique qui avait guidé le projet. Le génome était en effet vu comme une sorte de programme d’ordinateur comprenant toutes les informations et les instructions nécessaires pour le développement et le fonctionnement des organismes, selon un mécanisme rigide unidirectionnel : transcription de l’ADN en ARN dit « messager », puis translation de celui-ci en protéines. Vingt-cinq ans après, ainsi que le montre brillamment Philip Ball dans un livre au titre délibérément moins philosophique et ambitieux que celui de Schrödinger, on s’aperçoit que les choses sont plus compliquées que cela.
Une des premières surprises auxquelles a donné lieu l’analyse du génome humain est le petit nombre de gènes qu’il contient : quelque 20 000, soit à peu près autant que celui du ver ou de la souris. La plus grande partie de l’ADN composant le génome ne code de surcroît pas pour des protéines. Elle est largement constituée de séquences régulantl’expression des gènes, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’ARNs d’un autre type que les ARNs messagers, à l’aide d’une série de mécanismes dits « épigénétiques ». Contrairement à ce que l’on pensait, les protéines codées par les gènes existent, d’autre part, sous la forme de très nombreuses variantes. Et parce qu’elles ont souvent des contours désordonnés, ces protéines interagissent de manière beaucoup plus aléatoire et diverse que par le simple mécanisme « clé-serrure » qu’on imaginait. Dans l’ensemble, on se trouve face à un système d’une exceptionnelle complexité, organisé en une série de niveaux superposés allant du gène à l’environnement au sein duquel vit l’organisme, qui interagissent et rétroagissent de multiples manières. De la biologie du développement (embryologie) à la « biologie des systèmes » qui étudie les organismes de manière « holistique » (globale), en passant par l’étude du repliement des protéines et de leur conformation spatiale, Philip Ball, avec un sens exemplaire de l’explication, décrit le maquis de ces milliers d’interactions qui constituent le vivant.
L’extrême complexité des phénomènes vivants a des conséquences importantes dans un domaine où le séquençage complet du génome humain avait allumé de vifs espoirs : la médecine. Contrairement aux attentes, les progrès réalisés y sont restés jusqu’à présent limités, notamment dans le cas de ces maladies qui « surgissent de notre biologie » comme le cancer. L’identification de gènes impliqués seuls (le cas le plus rare) ou de concert avec de nombreux autres (situation la plus fréquente) dans certaines maladies, parce qu’une version défectueuse de ces gènes est à l’origine de ces maladies ou y prédispose, ne s’est que timidement traduite sur le plan clinique. Les thérapies géniques, impliquant le remplacement du gène fautif, demeurent en nombre réduit, et les progrès de la médecine personnalisée (dite aujourd’hui « de précision »), qui adapte le traitement au profil génétique du patient, bien que réels, sont lents. « La médecine génétique, observe Ball, n’est efficace qu’en proportion du degré où les gènes contrôlent la santé, c’est-à-dire quelque part entre “un peu” et “dans une certaine mesure”. » Bien d’autres couches du vivant sont concernées, à commencer par l’épigénétique et le système immunitaire. Au bout du compte, « aucune maladie n’est authentiquement génétique […], la maladie est un phénomène physiologique ».
Vers la fin de l’ouvrage, Philip Ball se risque à avancer un certain nombre de concepts abstraits. Le fonctionnement des systèmes vivants, fait-il observer, ne peut être compris sans que l’on dote ceux-ci d’une réelle capacité d’action (« agency »), de buts (« goals ») et de finalités (« purposes ») qu’ils poursuivent en identifiant la signification (« meaning ») que possèdent certains agencements matériels pour la réalisation de ces objectifs. Ceci suppose de leur part une certaine connaissance (« cognition »), fût-ce sous une forme très rudimentaire. De tels concepts ont mauvaise presse dans la communauté scientifique, parce qu’ils peuvent donner l’impression de réintroduire dans la biologie le finalisme qui en a été chassé par la pensée scientifique moderne, notamment la théorie darwinienne de l’évolution. Mais que l’évolution, basée sur un double mécanisme de variations génétiques aléatoires et de sélection des phénotypes les plus aptes à laisser des descendants, soit dépourvue de finalité n’empêche pas les organismes de poursuivre des buts concrets et précis dans leurs efforts pour survivre et se reproduire.
La synthèse à laquelle se livre Philip Ball, remarquable par sa clarté et sa richesse d’information, est assurément inédite. Mais la mise en cause du déterminisme génétique strict et exclusif n’est pas nouvelle. Philip Ball cite à cet égard à plusieurs reprises le nom de Michel Morange, ainsi que ceux d’Evelyn Fox Keller, Lynn Margulis et Barbara McClintock. Parmi ceux qui attirèrent l’attention sur l’importance du niveau d’intégration de la cellule, à côté de Paul Nurse (cité), il aurait pu mentionner le mathématicien Freeman Dyson, qui, dans un petit livre sur l’origine de la vie, reprochait à Schrödinger d’avoir mis à l’excès l’accent sur la mécanique des gènes au détriment du métabolisme cellulaire. Des mises en garde contre une interprétation trop dogmatique du rôle des gènes et trop littérale du modèle du « code informatique » figurent aussi dans les ouvrages récents sur la génétique de Matthew Cobb, Siddhartha Mukherjee et Denis Noble. Elles ne font que refléter la prise de conscience de plus en plus forte, parmi les chercheurs, de la complication des phénomènes qu’ils étudient.
Dans leurs tentatives pour comprendre et théoriser le fonctionnement du vivant, philosophes, biologistes et médecins ont constamment fait appel à des métaphores tirées de l’activité humaine. En fonction, souvent, de la technique dominante du moment, l’hydraulique, la mécanique, l’électricité, l’électronique, l’informatique leur ont successivement fourni des modèles. Certains se sont révélés pertinents et utiles : le cœur est bien une pompe, tout comme certains organites des cellules ; le système sanguin est effectivement un circuit, et certains neurones agissent comme des relais. Mais d’autres souffrent de trop simplifier des réalités complexes et ont pour grave défaut de fourvoyer l’esprit sur des voies sans issue : le cerveau n’est pas un ordinateur, le génome n’est pas un logiciel mécaniquement exécuté – plutôt qu’un programme, c’est, pour l’organisme, une ressource. Dans leurs mécanismes, leur organisation et leur comportement, les systèmes vivants – le livre de Philip Ball le met merveilleusement en lumière – démontrent une créativité, une flexibilité, une originalité, une subtilité, une capacité à exploiter le hasard dont sont dépourvues les créations techniques humaines, même les plus sophistiquées. La machinerie du vivant considérée dans son ensemble (parce qu’il s’agit bien d’une machinerie) n’a aucun équivalent dans l’univers de nos machines. Au bout du compte, le meilleur modèle du vivant, c’est le vivant lui-même.