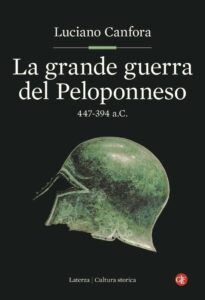La première guerre « mondiale »
Publié en février 2025. Par Michel André.
Témoin de ce conflit qui ravagea la Grèce pendant près d’un demi-siècle, Thucydide avait raison d’y voir une guerre « mondiale », en ce qu’elle impliquait « la plus grande partie de l’humanité » du monde connu, écrit l’historien italien Luciano Canfora.

Les guerres de grande ampleur n’ont pas manqué dans l’Antiquité : guerres médiques entre la Grèce et la Perse au début du Ve siècle av. J.-C., campagnes de conquête d’Alexandre le Grand au IVe siècle, guerres puniques opposant Rome et Carthage aux IIIe et IIe siècles, guerre des Gaules de Jules César au Ier siècle avant notre ère. De toutes, celle qui a le plus marqué les esprits est la guerre du Péloponnèse qui, durant la seconde moitié du Ve siècle, mit aux prises les deux villes d’Athènes (une cité démocratique) et de Sparte (sous régime oligarchique) ainsi que les coalitions bâties autour d’elles. Les historiens n’ont cessé de se pencher sur elle, on l’enseigne dans les écoles militaires, les spécialistes de géopolitique l’utilisent volontiers comme grille de lecture des relations internationales, par exemple des rapports des États-Unis et de la Chine.
L’attention particulière dont bénéficie ce conflit s’explique par plusieurs raisons. Son bilan matériel fut considérable et elle décima la population de plusieurs des villes engagées dans les combats, à commencer par Athènes, dont les élites payèrent un lourd tribut. Cet affrontement marque par ailleurs la fin, sinon de l’âge d’or de la civilisation grecque classique, qui se poursuivit au IVe siècle (les œuvres des philosophes Platon et Aristote sont postérieures à sa conclusion), à tout le moins de la domination politique et artistique d’Athènes, marquée par la construction du Parthénon et les grandes tragédies d’Eschyle, Sophocle et Euripide. Enfin et surtout, l’histoire de la guerre du Péloponnèse nous a été racontée en détail par celui que l’on considère, davantage encore que son prédécesseur immédiat, Hérodote, comme le premier historien au sens moderne du terme, Thucydide, qui en fait un récit à la fois factuellement précis et accompagné d’explications. Bien qu’ayant lui-même participé à la guerre (il était un des « stratèges », c’est-à-dire un des généraux de l’armée athénienne), il présente de son déroulement une vision équilibrée et aussi objective que possible. Les seuls éléments de fiction qui apparaissent dans son texte sont les discours qu’il met dans la bouche de certains acteurs, dont la fameuse oraison funèbre prononcée par le grand homme d’État Périclès, le plus célèbre morceau d’éloquence de ce genre avec le discours de Gettysburg d’Abraham Lincoln : faire énoncer sous cette forme les points de vue des différents protagonistes était alors un procédé rhétorique courant. Interrompu par sa mort, vraisemblablement autour de 396, son récit s’arrête en 411, quelques années avant la fin de la guerre. Les dernières années de celle-ci seront narrées par Xénophon dans les Helléniques.
Les historiens distinguent traditionnellement trois grande phases dans la guerre du Péloponnèse. La première démarre avec une série d’incursions des troupes de Sparte dans l’Attique, la partie continentale de la Grèce, où se situe Athènes. À l’issue des guerres médiques qu’ils avaient remportées contre les Perses grâce à leur victoire lors de la bataille terrestre de Marathon et celle, navale, de Salamine, les Athéniens avaient constitué avec plusieurs autres cités une ligue défensive, dite de Délos, qui se transforma rapidement en un empire de caractère colonial : en échange de sa protection, Athènes exigeait des villes qui lui étaient associées un lourd tribut, tout en leur interdisant de construire une flotte. Effrayés par les vues qu’avaient apparemment les Athéniens sur le Péloponnèse, la grande presqu’île où se situe Sparte, les Spartiates lancèrent des attaques préventives qui les conduisirent jusqu’à proximité d’Athènes. Dans un premier temps, celle-ci mit en œuvre une stratégie défensive en laissant les citoyens de l’Attique se réfugier derrière les hauts murs qui protégeaient la ville et l’accès à son port, le Pirée. Une épidémie de « peste » de nature inconnue (le typhus ou une autre maladie transmissible) frappa toutefois durement la population, emportant notamment Périclès. À l’initiative de son successeur Cléon, et sous la direction d’un autre général, Démosthène (sans rapport avec le célèbre orateur du siècle suivant), les Athéniens lancèrent à leur tour des offensives dans le Péloponnèse.
Une trêve de six ans marque le début de la deuxième phase, qui vit toutefois éclater une série de guerres par procuration entre les villes de la ligue de Délos et celles du Péloponnèse, emmenées par Sparte. Une bataille de grande ampleur entre les troupes des deux villes et leurs alliés permit à Sparte de reprendre le contrôle du Péloponnèse. En 415, Athènes s’engageait dans une expédition en Sicile dont l’objectif affiché était de défendre une de ses villes amies contre une attaque de la cité de Syracuse, alliée de Sparte. L’opération finit en désastre. Les Athéniens perdirent toute leur flotte et leurs troupes furent massacrées ou capturées par les soldats de Syracuse et ceux de Sparte. La troisième phase se caractérise par l’entrée en jeu de la Perse, qui aida Sparte, jusqu’alors puissance terrestre face à la puissance maritime d’Athènes, à s’équiper d’une flotte de guerre. La défaite d’Athènes face à l’escadre des navires spartiates commandée par le très habile général Lysandre précipita sa défaite et sa capitulation. Dans les années qui suivirent, un empire spartiate se substitua à l’empire athénien. Un régime oligarchique aux ordres de Sparte fut installé à Athènes, bientôt ravagée par une guerre civile conduisant à la restauration de la démocratie. Athènes récupéra son pouvoir dans les décennies suivantes avant que Philippe II et son fils Alexandre le Grand n’unifient l’ensemble du territoire grec au sein d’un nouvel empire. Ce ne sont là que les grandes lignes : ces trente années de la guerre furent émaillées de conflits locaux et intermittents, de luttes intestines entre factions soutenues par les deux belligérants, de retournements d’alliance et de loyauté : un des plus brillants généraux athéniens, Alcibiade, craignant pour sa vie parce qu’il était accusé de sacrilège, se mit un temps au service de Sparte, puis des Perses, avant d’être rappelé par Athènes.
Thucydide énonce avec beaucoup de clarté, de précision et d’intelligence des questions que nous nous posons encore aujourd’hui au sujet de la guerre du Péloponnèse et de la guerre en général. Son texte et les événements qu’il décrit et analyse sont donc un sujet d’étude classique. Parmi ceux qui s’y sont récemment intéressés figurent notamment des historiens américains de sensibilité conservatrice. Dans une somme en quatre volumes qui fait autorité, Donald Kagan reconstitue l’enchaînement des épisodes en montrant de quelle manière ils mettent en lumière des constantes de la nature humaine : la lutte féroce pour le pouvoir et la manière dont, pour reprendre les termes de Thucydide, les hommes se font la guerre « par peur, pour l’honneur et par intérêt ». Spécialiste de l’histoire militaire, Victor Davis Hanson consacre de longues pages à l’armement et à l’équipement des hoplites et aux techniques de combat des phalanges, formations compactes de fantassins qui demeureront très lourdes jusqu’à leur modernisation par Alexandre le Grand, ainsi qu’à la manœuvre des trières de guerre à plusieurs rangs de rameurs, la composition de leurs équipages et leurs divers usages, du transport de troupes à l’éperonnage des vaisseaux ennemis.
Le livre de Luciano Canfora sur la guerre du Péloponnèse est d’une autre nature. Bien qu’il suive en gros l’ordre chronologique, il ne se veut pas un récit complet des événements mais présente, à propos d’une sélection d’épisodes, une série de réflexions sur leur signification profonde. Philologue autant qu’historien, et classiciste aguerri naviguant dans l’histoire grecque et romaine avec une grande aisance, Canfora multiplie les observations judicieuses au sujet du texte de Thucydide et d’autres auteurs postérieurs qui ont traité du conflit. « Communiste sans parti » depuis la dissolution du parti communiste italien, il a conservé de sa formation marxiste une propension à privilégier, dans l’explication historique, les facteurs économiques et matériels, le rôle des idéologies et les causes structurelles, à l’intérieur de cadres de référence larges, dans le temps comme dans l’espace.
Ceci le conduit à proposer des dates de début et de fin de la guerre différentes de celles traditionnellement retenues. Pour lui, le conflit commence, non, comme on le dit le plus souvent, avec l’invasion de l’Attique par les troupes de Sparte en 431 av. J.-C., mais en 447, au moment où se constitue, en opposition à Athènes, la ligue béotienne associant Thèbes et Sparte. On pourrait même la faire débuter, suggère-t-il, en 478, au moment où Athènes crée la ligue de Délos et où sont érigées ses murailles. Elle ne se termine par ailleurs pas en 404, avec la destruction de ces mêmes murailles, mais en 394, lorsque celles-ci sont reconstruites, voire en 378 avec la création, par Athènes, d’une nouvelle ligue. À ses yeux, la guerre du Péloponnèse doit être comprise, au-delà de la rivalité entre Athènes et Sparte, comme le produit de la lutte pour le contrôle de la Méditerranée entre l’empire athénien et l’empire perse. À l’origine de la guerre, il y a l’impérialisme de la « thalassocratie athénienne », et en ce sens la guerre menée par Sparte est une guerre défensive. Canfora reprend à son compte la comparaison avec d’autres puissances maritimes comme l’empire anglais au XIXe siècle ou les États-Unis au XXe ainsi que la comparaison souvent faite avec la Première Guerre mondiale, dans laquelle leur rivalité a entraîné les grands empires européens. Thucydide a raison, dit-il, de présenter ce conflit comme une guerre « mondiale » impliquant « la plus grande partie de l’humanité », le monde connu couvrant alors l’Europe occidentale, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient : au-delà de Syracuse, Alcibiade entendait prendre le contrôle de l’ensemble de la Sicile et même de Carthage. Et, durant cette période, tant Athènes que la Perse sont intervenues en Égypte, grenier à blé de toute la Méditerranée et objet de toutes les convoitises.
Canfora insiste par ailleurs sur le rôle important joué par la propagande dans la conduite de la guerre. Athènes affirmait apporter la démocratie aux villes qu’elle plaçait sous son autorité et sa protection, et Sparte prétendait lutter pour libérer ces mêmes villes de la tyrannie athénienne. Dans un cas comme dans l’autre, la rhétorique employée n’était pas seulement un instrument d’autojustification mais une arme utilisée pour convaincre les alliés potentiels. En matière philologique, Luciano Canfora défend des thèses qui s’écartent du consensus. Il est généralement admis que Thucydide, puni pour n’avoir pas réussi à empêcher la prise d’Amphipolis par Sparte, a écrit une partie importante de son histoire de la guerre du Péloponnèse en exil, sur la base de récits de témoins. Canfora suggère que sa fortune (il était un riche aristocrate) lui a permis de les payer pour leur contribution. Mais surtout, il soutient qu’il n’a pas été exilé et a été le témoin oculaire direct de beaucoup des faits qu’il rapporte. Il affirme également qu’une partie de son texte a été mise en forme par Xénophon.
Dans l’ensemble, Luciano Canfora crédite Thucydide d’avoir parfaitement saisi à quel point les trente ans de combats interrompus de trêves qu’il raconte constituaient un événement historique unique. Il le félicite d’avoir réussi à identifier, sous-jacentes aux causes occasionnelles, les causes profondes de la guerre. Il le loue pour sa rigueur, son sens politique et son réalisme, qualités qui lui sont universellement reconnues : Nietzsche recommandait de le lire, à côté de Machiavel, pour cette raison.
L’application des analyses de Thucydide à d’autres épisodes historiques ou à la compréhension de la situation internationale actuelle peut se révéler extrêmement éclairante mais conduit parfois aussi à des simplifications basées sur d’évidents anachronismes, des inférences abusives et des rapprochements hâtifs. C’est le cas de toutes les comparaisons historiques. Les enseignements qu’historiens, spécialistes des relations internationales et responsables politiques tirent de son histoire de la guerre du Péloponnèse varient selon leur tempérament et leur idéologie. C’est le cas de toutes les œuvres de l’esprit d’une grande richesse, qui sont une inépuisable source d’inspiration. On continuera longtemps à lire Thucydide.