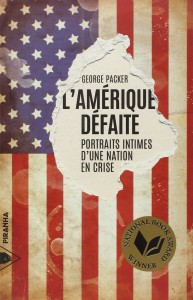La possibilité d’une vie, à Youngstown
Publié en avril 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.
« Je suis de mon enfance comme d’un pays »,
Antoine de Saint-Exupéry (Terres des hommes).
J’aimerais, cette semaine, vous parler d’enfances. Est-ce l’effet de tous ces gens qui passent la Nuit, debout, place de la république et ailleurs ? Est-ce l’intensité théâtrale des primaires américaines ? J’ai eu l’envie de me replonger dans le livre que George Packer a consacré à L’Amérique défaite, sorti il y a tout juste un an aux éditions Piranha (ceux d’entre vous qui visitent régulièrement ce blog savent que j’ai le goût des livres qui durent et que je milite contre le zapping permanent et pour le slow-reading). Une passionnante chronique de la mutation (dislocation, dirait l’auteur) vécue par les Etats-Unis ces quarante dernières années, avaient dit les gazettes. Peut-être y puiserais-je de quoi comprendre l’indignation qui monte des « 99 % » ? Mais c’est tout le plaisir des bons livres que d’y trouver ce que l’on n’y cherche pas. Car George Packer fait bien davantage que raconter la désindustrialisation, la financiarisation de l’économie et la montée des inégalités. Le journaliste du New Yorker – le sait-il ? – a surtout écrit à mes yeux un magnifique récit sur l’enfance. Ou plutôt, sur cette chose impalpable qui, dans l’enfance, même la plus fracassée parfois, façonne un adulte capable de tenir debout. Et j’ai souvent repensé, à mesure que je faisais connaissance avec le plus beau personnage du livre, Tammy Thomas, à Jenny Diski s’interrogeant sur ce « mystère total » : « Pourquoi certaines personnes sont-elles terrassées et réduites à l’impuissance par ce qui semble n’être qu’un environnement dysfonctionnel des plus bénins, alors que d’autres, dont l’enfance a été dévastée par les mauvais traitements et la pauvreté, semblent trouver le moyen de vivre leur vie comme si elle leur appartenait bel et bien ? » Tammy Thomas, donc, est née à Youngstown, Ohio, en 1966 dans une famille où ça ne tournait pas bien rond : sa mère, une jolie Vickie de 17 ans, se fichait pas mal de son père, un gamin des cités de 15 ans. Et réciproquement. Elle avait quitté le lycée, et commencé de se droguer peu après la naissance ; comme son propre père, revenu héroïnomane de la Deuxième Guerre mondiale. A 3 ans, la gosse avait déjà appris à retirer la cigarette des mains de sa mère, qui s’endormait en fumant. Tammy Thomas aurait pu se faire un sarcophage de cette enfance, mais non.A l’époque, il faut dire, Youngstown, trépidait encore. Les aciéries tournaient à plein régime ; à la fraîche, le soir, sous le porche, l’air sentait bon le soufre ; les Noirs commençaient même d’accéder aux bons boulots bien payés jusque-là réservés aux ouvriers blancs dans les usines. La fillette n’a évidemment pas bien conscience de tout cela, mais le samedi c’est fête quand Granny lui met ses gants, son chapeau, son petit haut à dentelles et ses chaussures vernies pour aller au centre-ville faire les magasins. Granny, le soleil dans son ciel de plomb, l’arrière-grand-mère avec qui Vickie et Tammy vont vivre. A presque 70 ans, elle travaille comme bonne à tout faire chez Mrs Purnell, une riche veuve des beaux quartiers, et fait vivre tout le monde dans la maison qu’elle a fini par pouvoir acheter à force de besogne. A plus de quarante ans de distance, l’arrière-petite-fille se souvient encore des quelques jours passés avec Granny dans cette villa (parce que Vickie avait disparu) : « Elle regardait les écureuils qui venaient manger dans la main de Mrs Purnell sous le portique, et Mrs Purnell lui donna un téléphone Mickey. » Tammy y fera bientôt un séjour de quelques mois, quand la fillette et l’aïeule garderont la propriété, le temps que les héritiers règlent la succession de Mrs Purnell, à sa mort : elle avait 5 ans. La gamine, dont la mère commence à multiplier les séjours en prison, s’émerveille d’une crinoline dénichée dans une vieille malle : « Elle aimait la mettre et tournoyer dans la salle de bal en imaginant comment les gens dansaient autrefois. Elle descendait le grand escalier comme une princesse et donnait des spectacles sur la terrasse circulaire pour un public de buissons. » Elle grimpe au grand arbre, aussi, malgré l’interdiction. Tammy sait profiter à grandes goulées de toutes les parenthèses enchantées que lui offre la vie. Est-ce parce qu’elle a pu s’émerveiller, malgré tout, qu’elle a acquis ce « pouvoir brut » que les autres verront plus tard en elle ? En tout cas, du plus loin qu’elle s’en souvienne, « ça allait » : quand sa mère s’est installée avec un certain Wilkins, qu’il a fallu quitter la maison de Granny pour habiter dans une bicoque divisée en appartements, que sa chambre était en fait un placard où elle tenait à peine debout, « ça allait ». A Youngstown, pourtant, passé la deuxième moitié des années 1970, ça n’allait plus du tout. Tammy avait autour de 11 ans quand les aciéries se sont mises à fermer les unes après les autres ; quand ses chers magasins du centre-ville ont jeté l’éponge les uns après les autres. En 1982, la ville avait le taux de chômage le plus élevé des Etats-Unis, 22 %. Au terme de cette désindustrialisation foudroyante dont Bruce Sprinsteen a fait une chanson, 50 000 emplois avaient disparu. 50 000 ! La ville s’évide, les maisons sont saisies. Il y a plus de deux incendies par jour parce que certains veulent toucher l’argent de l’assurance et que la mairie s’acoquine avec la mafia, qui fait flamber tout ça pour moitié moins cher qu’il ne coûte de démolir. C’est à ce moment là qu’on vole la porte d’entrée de la maison de Granny (la gamine est retournée vivre là), une vieille porte en chêne massif avec une ouverture ovale ; il n’y a pas d’argent pour la remplacer, Tammy commence à avoir honte d’inviter ses amis. Peut-on s’immuniser contre le monde qui se défait autour de soi ?Le samedi c’est fête quand Granny lui met ses gants, son chapeau, son petit haut à dentelles et ses chaussures vernies pour aller au centre-ville faire les magasins. Granny, le soleil dans son ciel de plomb.
A 15 ans, Tammy tombe enceinte : on lui avait juste dit que les bébés naissaient sous les rochers. Elle l’avait cru. Pourquoi non ? Et la nouvelle fait pleurer Granny : « Encore une qui ne finira pas le lycée, explique aujourd’hui Tammy Thomas avec le recul. Elle disait qu’elle avait travaillé, récuré des parquets, fait la cuisine, passé tout ce temps loin de sa famille et que tout ce qui comptait le plus pour elle, c’était que j’aie un diplôme et une maison et ça n’était toujours pas arrivé. On avait une maison mais personne n’aurait de diplôme. » Nous ne saurons pas si c’est l’électrochoc provoqué par le chagrin de son arrière-grand-mère, ou d’avoir eu un aperçu de bonheur possible au cours d’après-midis en crinoline, qui lui a donné ce sursaut. A moins qu’il s’agisse d’une réaction de fierté noire, héritée des trois volumes de la collection Ebony Success Library offerts par Granny, sur les succès des Noirs dans l’histoire… Quoi qu’il en soit, l’adolescente se jure de ne pas finir comme les filles des cités qui passent leur vie aux crochets de l’aide sociale ; ni comme sa mère. Tammy continuera le lycée et après, elle trouvera un bon boulot pour que sa fille ait une meilleure vie qu’elle. Ce sale coup produirait le plus grand des miracles. Mais la volonté ne faisant pas tout, les dieux ont été un peu lents à rendre leur jugement. Dans l’immédiat, le père ne vient pas signer l’acte de naissance. Séparation. Si c’était un roman, à ce stade, j’accuserais l’auteur d’en faire beaucoup trop. Ce n’est pas un roman. Tammy rencontre le garçon un peu plus tard, en compagnie de sa nouvelle petite amie, enceinte elle aussi. Mais ça allait, elle s’en remettrait. La jeune femme va jusqu’au bout du lycée, trouve un job de caissière, a deux autres enfants, d’un autre père, fait attention à l’argent, achète les cadeaux de Noël en avance en versant un acompte au magasin jusqu’à ce qu’elle puisse les payer totalement, cherche un boulot plus sûr, le déniche : ouvrière à la chaîne dans une usine Packard Electric. Elle sort de l’aide sociale, comme elle se l’était promis. [caption id="attachment_35990" align="alignnone" width="800"]A 15 ans, Tammy tombe enceinte : on lui avait juste dit que les bébés naissaient sous les rochers. Elle l’avait cru. Pourquoi non ?
 AfroDad[/caption]
Tammy passera dix-neuf ans dans cette entreprise, où elle reçoit en prime l’asthme (parce que son travail consiste, pendant un temps, à plonger des câbles de cuivre dans du plomb en fusion) et le syndrome du canal carpien (les « mains Packard », ils appellent ça). A part ça, la vie suivait son cours. Des hommes y entraient et en repartaient. Les déménagements se succèdaient à mesure que Youngstown sombrait – on n’en parlait plus que sous le nom de « Murdertown » – et Tammy perdait de l’argent à chaque fois. Ça doit être à peu près l’époque, d’ailleurs, où sa future amie Hattie, une sacrée bonne femme elle aussi, a perdu sa petite-fille Marissa (16 ans), morte d’une balle en plein cœur à la sortie d’une soirée, et décidé de créer sur une parcelle vide près de chez elle le « jardin des fleurs fauchées en pleine jeunesse » : « Elle récupérait des bulbes de tulipes et de jonquilles et des rosiers sur les terrains des maisons abandonnées et elle les laissait s’épanouir sans jamais les couper car Marissa avait été coupée comme une fleur. »
Du côté de Tammy, cela dit, le boulot s’apprivoisait, elle gagnait même assez correctement sa vie – 25 dollars de l’heure sur la fin. Avec les collègues, ils rigolaient bien, fêtaient tous les anniversaires avec un gâteau et pariaient sur les matchs de football américain (une fois, elle a empoché 800 dollars comme ça). Evidemment, elle traversait aussi des orages, subissait des pertes : la mort de Granny, celle d’un homme qui venait de la demander en mariage et s’était fait descendre à peu près à la seconde où elle avait décidé d’accepter, et puis sa mère qu’elle n’avait cessé d’adorer envers et contre tout ; mais globalement, son salaire de Packard « l’avait sauvée et avec, elle avait pu sauver ses enfants ».
Ses enfants qu’elle tenait collés-serrés question discipline. Le week-end, Tammy les occupait à peu de frais en les emmenant cueillir des fraises et des pommes à la campagne. Elle les obligeait à voir leurs amis à la maison pour les connaître et savoir ce qu’ils faisaient. « Les filles ne furent pas autorisées à se maquiller avant 16 ans et le jour où son fils rentra l’oreille percée, à 13 ans, Tammy lui fit enlever son anneau parce qu’elle le lui avait formellement interdit jusqu’au lycée, et une fois au lycée, il n’en voulut plus ». Les filles de Tammy ne sont pas tombées enceintes, son fils n’a pas rejoint un gang, ils sont tous allés à l’université. « Mes enfants devaient avoir une meilleure vie que moi. J’ai fait ce que j’avais à faire, et c’est ce que mon arrière-grand-mère avait fait ».
AfroDad[/caption]
Tammy passera dix-neuf ans dans cette entreprise, où elle reçoit en prime l’asthme (parce que son travail consiste, pendant un temps, à plonger des câbles de cuivre dans du plomb en fusion) et le syndrome du canal carpien (les « mains Packard », ils appellent ça). A part ça, la vie suivait son cours. Des hommes y entraient et en repartaient. Les déménagements se succèdaient à mesure que Youngstown sombrait – on n’en parlait plus que sous le nom de « Murdertown » – et Tammy perdait de l’argent à chaque fois. Ça doit être à peu près l’époque, d’ailleurs, où sa future amie Hattie, une sacrée bonne femme elle aussi, a perdu sa petite-fille Marissa (16 ans), morte d’une balle en plein cœur à la sortie d’une soirée, et décidé de créer sur une parcelle vide près de chez elle le « jardin des fleurs fauchées en pleine jeunesse » : « Elle récupérait des bulbes de tulipes et de jonquilles et des rosiers sur les terrains des maisons abandonnées et elle les laissait s’épanouir sans jamais les couper car Marissa avait été coupée comme une fleur. »
Du côté de Tammy, cela dit, le boulot s’apprivoisait, elle gagnait même assez correctement sa vie – 25 dollars de l’heure sur la fin. Avec les collègues, ils rigolaient bien, fêtaient tous les anniversaires avec un gâteau et pariaient sur les matchs de football américain (une fois, elle a empoché 800 dollars comme ça). Evidemment, elle traversait aussi des orages, subissait des pertes : la mort de Granny, celle d’un homme qui venait de la demander en mariage et s’était fait descendre à peu près à la seconde où elle avait décidé d’accepter, et puis sa mère qu’elle n’avait cessé d’adorer envers et contre tout ; mais globalement, son salaire de Packard « l’avait sauvée et avec, elle avait pu sauver ses enfants ».
Ses enfants qu’elle tenait collés-serrés question discipline. Le week-end, Tammy les occupait à peu de frais en les emmenant cueillir des fraises et des pommes à la campagne. Elle les obligeait à voir leurs amis à la maison pour les connaître et savoir ce qu’ils faisaient. « Les filles ne furent pas autorisées à se maquiller avant 16 ans et le jour où son fils rentra l’oreille percée, à 13 ans, Tammy lui fit enlever son anneau parce qu’elle le lui avait formellement interdit jusqu’au lycée, et une fois au lycée, il n’en voulut plus ». Les filles de Tammy ne sont pas tombées enceintes, son fils n’a pas rejoint un gang, ils sont tous allés à l’université. « Mes enfants devaient avoir une meilleure vie que moi. J’ai fait ce que j’avais à faire, et c’est ce que mon arrière-grand-mère avait fait ».
Fin de l’histoire ? Non. Il y a presque plus miraculeux encore. Car une fois ses enfants tirés d’affaire, Tammy a une chance de devenir autre chose qu’une virtuose de la survie. Elle la saisit, évidemment, puisqu’elle est ce qu’elle est. « L’effondrement apporte plus de liberté que le monde n’en a jamais accordée, et à une variété de personnes jamais vue, écrit George Packer dans l’un des rares passages à thèse de ce livre de reportage. Liberté de partir, de revenir, de changer d’histoire, d’arranger votre histoire, de vous faire embaucher, de vous faire virer, de vous défoncer, de vous marier, de divorcer, de faire faillite, de recommencer, de vous lancer dans une affaire, de refuser de choisir, de risquer le tout pour le tout, de laisser un champ de ruines derrière vous, de réussir au-delà de vos rêves et de vous en vanter, d’échouer lamentablement et de réessayer. » Tammy est sa plus belle démonstration. En octobre 2005, elle va bientôt avoir 40 ans, Packard Electric fait faillite. Les rares rescapés doivent accepter une baisse de salaire de 40 %. Ou alors partir en touchant des indemnités de licenciement. Tammy se décide vite : « Vous savez quoi ? Il n’y a pas que Packard dans la vie. » Elle allait commencer par s’inscrire en socio à l’université. Après, elle verrait bien. Elle a vu rapidement. Contactée par un animateur social désireux d’organiser les habitants des quartiers de Youngstown pour lutter contre le déclin, elle s’engage, démarche rue par rue, participe à la renaissance de cette ville que ses enfants ont quittée « parce qu’il n’y a rien pour eux ici » : « Ma grand-mère a travaillé trop dur pour mon quartier pour qu’on puisse le laisser ressembler à ça. Elle a fait la cuisine et le ménage dans tellement de maisons et maintenant elles sont toutes en ruine. » Elle pouvait continuer l’université, elle avait un boulot intéressant, décemment payé, et les avantages sociaux. L’homme qui l’avait repérée avait dit d’elle : « C’est peut-être une mine d’or » Manju aussi est peut-être une mine d’or. Pas d’arrière-grand-mère pour ange-gardien, au contraire. Une existence de Cendrillon de bidonville, esclave d’une marâtre prête à toutes les arnaques pour s’en sortir. Mais je me suis souvenue de son histoire en lisant celle Tammy. Elle m’avait donné les mêmes frissons. Je l’imaginais trop bien, cette beauté solaire de 19 ans, dans son gourbi situé à dix mètres d’un cloaque puant où s’écoulent les eaux usées, en train d’essayer de comprendre l’intrigue de Mrs Dalloway et d’autres personnages de la littérature anglaise, au programme de l’université de troisième zone qu’elle fréquente. Manju est l’héroïne du livre que Katherine Boo a consacré à un bidonville de Bombay, Annawadi (traduit chez Buchet-Chastel). Elle voulait être la première femme du bidonville diplômée de l’université. « Elle en mourrait de continuer toute sa vie à faire ce qu’elle fait maintenant : balayer la poussière que les rafales de vent poussent dans la maison, passer la serpillière, puis balayer à nouveau la poussière qui s’est insinuée pendant qu’elle passait la serpillière ». Manju et Tammy n’ont pas eu la même enfance, mais ont en commun leur rébellion. A Youngstown, la femme noire américaine ne décolère pas de voir sa ville s’abîmer. A Bombay, la jeune fille de basse caste ne décolère pas contre sa mère qui magouille en permanence, lui a donné un coup de hache sur la nuque le jour où elle avait chipé quelques roupies pour s’acheter des chocolats, refuse de lui acheter un dictionnaire anglais-marathi. Et leur colère, toutes deux l’ont évacuée dans leur rêve d’instruction. A Annawadi, écrit Katherine Boo, « il n’existe que trois façon de se sortir de la pauvreté : trouver et garder un filon qui rapporte, se lancer dans les magouilles et la corruption, ou bien s’instruire ». Dans la vraie vie qui a continué après le livre de Katherine Boo, Manju a décroché son master en littérature anglaise et réalisé son rêve : elle est enseignante. A quoi ça tient ?« Mes enfants devaient avoir une meilleure vie que moi. J’ai fait ce que j’avais à faire, et c’est ce que mon arrière-grand-mère avait fait ».