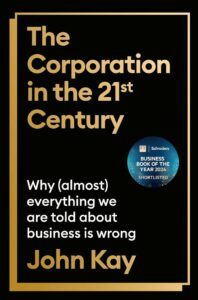Un capitalisme sans capital ?
Publié en novembre 2024. Par Michel André.
Les très grandes entreprises du XXIe siècle n’ont pas grand-chose à voir avec leurs aînées. La priorité accordée au profit à court terme et à la rémunération des actionnaires éloigne l’entreprise de sa mission d’origine : offrir à ses clients des produits et des services de qualité. La mutation est telle que l’on peut s’interroger sur le sens à donner au mot « capital ».

On voit bien que le monde de l’entreprise ne ressemble plus aujourd’hui à ce qu’il a été entre le début de l’ère industrielle et le milieu du XXe siècle. Mais en quel sens exactement a-t-il changé, et avec quelles conséquences ? C’est à ces questions que John Kay, économiste réputé et commentateur économique très lu en Grande-Bretagne, s’emploie à répondre dans un livre explicitement présenté comme très différent de la plupart de ceux qui sont consacrés aux entreprises. Ni manuel pratique énumérant des recettes de succès à l’attention des candidats investisseurs, ni brûlot anticapitaliste dénonçant les méfaits des firmes multinationales (deux catégories identifiées par John Kay à l’aide de titres parodiques très amusants), l’ouvrage a pour ambition de fournir à toute personne intéressée par le sujet, mais n’en ayant pas une vue d’ensemble, les éléments d’information nécessaires pour comprendre le fonctionnement des entreprises contemporaines.
Bien que les progrès techniques aient affecté le travail qu’on y effectue et que l’essor de la concurrence internationale les frappe très souvent de plein fouet, les millions de petites et moyennes entreprises qui composent partout une partie très importante du tissu économique n’ont pas changé substantiellement dans leur principe au cours des dernières décennies. Le livre porte donc exclusivement sur les très grandes entreprises opérant à l’échelle mondiale et employant plusieurs dizaines de milliers de personnes. À part quelques remarques incidentes, il s’en tient à la description et à l’analyse. Les conséquences de celle-ci pour la politique économique, annonce John Kay, seront examinées dans un second volume.
Née de l’acquisition, par les anciennes « compagnies », d’un statut juridique, l’entreprise moderne s’est longtemps présentée de la façon suivante : une organisation conçue pour réaliser des profits en produisant des biens matériels répondant aux besoins de la société, dirigée par la personne ou la famille qui possédait les moyens de production (les ateliers, les usines, les machines) et rétribuant le second facteur de production, le travail, sous la forme de salaires. Sous l’effet d’une série d’évolutions intervenues au cours des cinquante dernières années, ce modèle a perdu de son importance, s’est complexifié et a été supplanté par d’autres.
Une de ces évolutions est la conséquence du remplacement progressif du capitalisme familial traditionnel par des formes plus ou moins généralisées de capitalisme d’actionnaires. C’est la fétichisation de la « valeur pour l’actionnaire », devenue quasiment la raison d’être de l’entreprise. La conception du profit à court terme comme objectif cardinal de l’entreprise et comme signe de sa valeur s’est appuyée sur une interprétation de la théorie de l’efficacité des marchés que John Kay juge simpliste et dogmatique. « L’idée que le marché en sait davantage sur l’avenir d’une entreprise que ses propres dirigeants […] représente le triomphe de la théorie abstraite sur le bon sens. » La recherche à tout prix du profit immédiat, rappelle-t-il, ne peut pas servir de guide à l’activité des entreprises et se révèle même souvent contre-productive. La meilleure manière de garantir la valeur pour l’actionnaire à long terme est de bâtir une entreprise solide qui offre à ses clients des produits et des services de qualité.
Le même raisonnement s’applique à un autre aspect du triomphe de la logique financière qui s’est emparée des entreprises à la fin du XXe siècle. Les fusions et acquisitions ne sont pas une nouveauté, mais avec les offres publiques d’achats (OPA) hostiles, la signification et l’objectif de ces opérations ont changé : « Les opérations de fusion et acquisition, à présent, sont poussées par l’ego des gestionnaires et les revenus qu’elles procurent aux banquiers, juristes et consultants. Pour les décrire, les professionnels de la finance emploient aujourd’hui l’expression “activité des entreprises”, comme si ces opérations étaient leur première raison d’être. »
L’emprise croissante des considérations strictement financières peut s’avérer désastreuse pour certaines sociétés, y compris des géants de leur secteur. John Kay décrit les conséquences négatives qu’a entraîné le primat qui leur était accordé pour plusieurs d’entre elles, américaines et anglaises : ICI (chimie), GE (énergie), Sears (vente au détail), Marks & Spencer (habillement), Boeing (construction aéronautique) et IBM (informatique). Sans s’attarder, parce que ce n’est pas son sujet central, il évoque aussi les changements profonds dans l’univers de la banque et de la finance qui ont accompagné et soutenu ces évolutions : l’essor du capital à risque, la multiplication des fonds spéculatifs, l’expansion des activités financières des banques, la titrisation des créances et la création de nouveaux types d’actifs à très haut risque (« obligations pourries »), etc. Comme on sait, ces développements, auxquels John Kay a consacré un autre livre, sont à l’origine de la crise financière de 2008, dont les conséquences économiques et politiques se font encore sentir aujourd’hui.
La combinaison de ces mutations n’est pas sans effet sur la manière dont certaines très grandes entreprises sont aujourd’hui perçues par le public, que John Kay résume par la formule suivante : « amour du produit, haine du producteur ». Dans aucun domaine ceci n’est plus vrai que dans celui de l’industrie pharmaceutique. « L’industrie pharmaceutique illustre ce qu’il y a de meilleur et de pire dans l’entreprise moderne. Ses produits – antibiotiques, […] vaccins […] – ont sauvé des centaines de millions de vies et amélioré la qualité de vie de presque tout le monde. » Ses revenus ont permis de financer de nouvelles recherches et des initiatives de philanthropie. Parce que les actions des sociétés concernées sont largement détenues par des particuliers et des investisseurs institutionnels, ils ont aussi contribué à assurer la retraite de très nombreuses personnes. En même temps, toutefois, obnubilés par la « valeur pour l’actionnaire » et intoxiqués par l’idée que le profit était la raison d’être de leurs entreprises, « beaucoup de ses dirigeants ont montré des standards de comportement très en dessous de ce qu’une société moderne peut accepter ou devrait tolérer de personnes possédant des responsabilités dont l’exercice détermine aussi profondément le bien-être général ».
Tous ces faits sont bien connus et font l’objet d’une littérature abondante, dont John Kay présente les enseignements de manière claire et accessible. Un des mérites du livre est de mettre bien en lumière les changements considérables qui se sont produits dans le processus de production lui-même. Ils sont particulièrement visibles dans le domaine des industries de l’information et de la communication. Pour produire les biens et, davantage encore, les services qu’elles commercialisent, des entreprises comme Google, Meta, Netflix, Microsoft ou Apple ne dépendent pas fondamentalement de la possession d’énormes infrastructures : « Les compagnies leaders du XXIe siècle n’ont que peu besoin de tels équipements. Le montant relativement modeste de capitaux qu’elles lèvent est utilisé pour couvrir les pertes d’exploitation ou pour lancer de nouvelles activités. Leurs actifs matériels […] sont principalement […] des bureaux, des magasins, […] des centres de données qui peuvent être utilisés pour d’autres activités. Il n’est pas nécessaire que l’entreprise possède elle-même ces « moyens de production » et souvent ce n’est pas le cas. » Pour l’essentiel, les moyens de production qu’elles mobilisent sont humains : c’est l’ensemble des individus dont la combinaison des compétences techniques, financières, de gestion et commerciales leur permet de mener leurs activités.
Ce modèle s’applique même dans le cas d’entreprises produisant ou commercialisant des objets matériels comme Apple ou Amazon, ne fût-ce qu’en raison de la part de recherche et développement et de services dans leurs activités. Il trouve son apothéose dans les sociétés dont la raison d’être est d’offrir des services d’intermédiation comme Airbnb et Uber, qui combinent des caractéristiques des plateformes et des franchises : « comme plateformes, elles mettent en relation des propriétaires d’appartements et leurs locataires éphémères, ou des passagers et des chauffeurs ; comme franchises, elles contrôlent la qualité des logements offerts et la fiabilité des chauffeurs ». À la manière dont la chaîne d’assemblage a été l’innovation majeure de l’entreprise du XXe siècle, conclut John Kay, les entreprises de ce type représentent l’innovation majeure de l’entreprise du XXIe siècle.
Une thèse centrale du livre est que les changements spectaculaires récemment intervenus dans le monde de l’entreprise ne se reflètent pas (encore) dans le vocabulaire utilisé pour décrire celui-ci et les concepts employés pour en comprendre le fonctionnement. La théorie économique, affirme John Kay, ne capture pas correctement ce que ce monde est devenu. Elle n’est par exemple pas capable de rendre compte adéquatement d’un phénomène qu’il considère largement définir les entreprises contemporaines : la dissolution du lien qui a très longtemps existé entre fortune personnelle, détention des moyens de production et contrôle de l’entreprise : « Le capital comme facteur de production doit être distingué du capital comme mesure de la fortune personnelle. Et ni l’un ni l’autre ne sont étroitement liés au contrôle de l’entreprise moderne, qui est essentiellement dans les mains de gestionnaires professionnels. Ces dirigeants ne tirent leur autorité et leur pouvoir économique ni de la propriété des moyens matériels de production, ni de leur fortune, mais de leur rôle dans l’organisation. » L’ordre causal est inversé. C’est le contrôle de l’activité industrielle et financière par les gestionnaires (ou les fondateurs) qui leur permet d’accumuler des richesses par l’intermédiaire de parts de capital ou de rémunérations élevées : « Si les cadres supérieurs sont riches – et beaucoup d’entre eux à présent le sont –, leur rôle dans la direction de l’entreprise ne provient pas de leur richesse ; c’est plutôt leur richesse qui provient de leur rôle dans la direction de l’entreprise. » Qui, aujourd’hui, détient par ailleurs le capital d’une entreprise ? Quelquefois en partie son fondateur, assurément, mais aussi souvent une population hétéroclite d’acteurs composée de banques, de fonds spéculatifs, d’investisseurs institutionnels et de particuliers, directement lorsqu’ils possèdent des actions et indirectement par l’intermédiaire des fonds de pension.
Si le terme « capital » doit être encore utilisé, suggère aussi Kay, il faudrait l’étendre, au-delà du capital physique et du capital financier, aux actifs immatériels (essentiellement les connaissances scientifiques et techniques), au capital humain (la compétence des individus), au capital social (mesuré par le degré de confiance à l’intérieur et autour de l’entreprise) et au capital naturel. Mais le concept de capital est-il encore adapté ? Dans une économie complexe fonctionnant selon les principes et à l’aide des mécanismes qui prévalent aujourd’hui, le profit des entreprises, suggère-t-il, ne devrait plus être décrit comme le produit du retour sur le capital investi, mais (ressuscitant un concept longtemps exclusivement utilisé pour les revenus de l’agriculture) comme celui d’une « rente » obtenue en fournissant des biens et des services.
The Corporation in the Twenty-First Century n’épuise pas tout ce que l’on peut dire au sujet des différences observables entre les grandes entreprises d’aujourd’hui et celles d’hier. Le livre ne dit par exemple rien du foisonnement des procédures et de leur couplage obligé avec les outils informatiques, de l’accroissement de la proportion du personnel de gestion par rapport au personnel technique, de l’importance croissante accordée, non sans impact sur les relations de travail, d’un côté au contrôle des performances et à l’évaluation, de l’autre aux droits individuels des employés. Il glisse aussi trop rapidement sur les effets de la mondialisation. Dans l’ensemble, toutefois, on y trouve une série d’aperçus éclairants de certaines caractéristiques fondamentales de l’entreprise moderne.
La théorie de l’entreprise esquissée par John Kay dans ce livre s’intègre dans le cadre de la vision d’ensemble de l’économie et de sa place dans la société développée dans un ouvrage précédent co-écrit avec son confrère Paul Collier, vision construite à l’aide d’idées comme celles d’intelligence collective et d’un « pluralisme discipliné » garantissant l’équilibre entre compétition et coopération. Comment cette théorie se traduirait-elle en pratique, et quels types de stratégies d’entreprise et de politiques publiques conduirait-elle à mettre en œuvre ? On devrait l’apprendre dans le second volume annoncé.
Pour aller plus loin : Entretien avec John Kay et Mervyn King, « Les modèles économiques ne produisent pas de prédictions fiables », Books n° 114, juillet-août 2021.