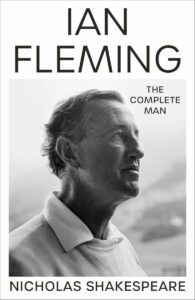Ian Fleming avant James Bond
Publié en janvier 2025. Par Michel André.
Sans jamais avoir été envoyé sur le terrain, Ian Fleming avait joué un rôle de premier plan dans les services secrets britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Enrichi par cette expérience, le personnage de James Bond est aussi à certains égards le portrait rêvé de son auteur.

« Avez-vous souvent le sentiment d’être Bond et que Bond est Fleming ? » À cette question posée lors d’un entretien publié trois mois après sa mort, en 1964 à l’âge de 56 ans, Ian Fleming avait répondu : « Lorsque je le fais fumer un certain type de cigarettes ou boire un certain type de bourbon, c’est parce que je le fais moi-même et que j’en sais le goût. Mais, naturellement, James Bond est une version extrêmement romancée de n’importe qui, a fortiori de moi-même. » Dans une entrevue donnée à la télévision canadienne six mois avant son décès, il affirmait que les histoires de James Bond étaient basées à 90 % sur son expérience personnelle. Dès la parution de Casino Royale, le premier roman de la série, la question fut soulevée : qu’y avait-il de Fleming et de sa vie dans le caractère et les aventures du plus célèbre héros de la littérature d’espionnage ? Les avis étaient très partagés sur ce point, parfois diamétralement opposés.
Dans la nouvelle biographie de l’écrivain qu’il vient de publier, Nicholas Shakespeare propose une réponse subtile : Bond est assurément Fleming à plusieurs égards, mais sous la forme d’un alter ego idéalisé. S’appuyant sur son expérience dans les services secrets, il a attribué à son personnage des exploits inspirés de ceux que, sans les avoir réalisés lui-même, il avait eu l’occasion d’observer de très près. Les précédents biographes de Fleming, notamment John Pearson et Andrew Lycett, avaient déjà mis en lumière ses activités au sein des services de renseignement britanniques durant la Seconde Guerre mondiale. Shakespeare, qui reconnaît pleinement sa dette envers ses prédécesseurs, fournit une série de détails supplémentaires à leur sujet. La plupart des auteurs anglais d’histoires d’espionnage – Somerset Maugham, Graham Greene, John le Carré (Eric Ambler est une exception notable) – ont travaillé pour les services secrets de la Couronne britannique. Contrairement aux deux derniers, suggère Shakespeare, à qui n’ont jamais été confiées que des missions de peu d’importance, Fleming, tout au long de la Seconde Guerre mondiale, était au cœur du dispositif de renseignement. Ce qu’il y a vu lui a fourni, après transposition dans le contexte de la guerre froide et ajout d’une bonne dose de fantaisie, le matériau des histoires de James Bond.
Ian Fleming est né dans une famille aisée d’origine écossaise, deuxième garçon d’une série de quatre. Trois figures dominèrent son enfance et sa jeunesse. D’abord son père, membre du Parlement, mort au front en 1917 lorsqu’il avait 9 ans : toute sa vie il conserva un exemplaire de sa nécrologie, signée par Winston Churchill, qui l’avait rédigée lui-même. Ensuite son frère aîné Peter, qu’il admirait et dont les prouesses scolaires, la réussite sociale, les exploits durant la Seconde Guerre mondiale (il est un des multiples modèles de James Bond) et le succès que lui valurent ses récits de voyage ne cessèrent de l’écraser jusqu’au moment où sa propre renommée supplanta la sienne. Et enfin sa mère, une femme autoritaire et très snob qui entendait régir complètement la vie de ses enfants, leurs études, leur carrière et leurs relations sentimentales.
Très bon athlète, il ne fut pas un élève brillant. Expulsé du collège de Sandhurst pour avoir contracté une maladie vénérienne, il ne fit qu’un bref passage à Eton, mais qui l‘a marqué. Sous l’effet des châtiments corporels brutaux qu’on y administrait et des punitions cruelles que s’infligeaient mutuellement les élèves, il y prit goût aux plaisirs troubles de la flagellation active et passive. Et il se fit des relations qui lui furent très utiles toute sa vie. On ne peut qu’être frappé à cet égard par la quantité d’« Old Etonians » qui peuplent le livre de Nicholas Shakespeare : le milieu que forment les élites intellectuelles, politiques, économiques et littéraires britanniques est particulièrement homogène, comme est remarquable le réseau d’entraide et d’influences qui résulte des liens noués par ses membres durant leurs études dans les établissements prestigieux.
De ce qu’il entreprit ensuite grâce à l’appui de sa mère, on retiendra surtout son passage par l’agence de presse Reuters, parce qu’il y apprit à écrire de manière concise, directe et factuelle et que cela lui donna l’occasion d’assister à un procès politique à Moscou. Une de ses principales activités à cette époque semble avoir été de séduire les femmes. Bien qu’il les ait souvent traitées cavalièrement, relève Shakespeare, beaucoup parmi ses éphémères petites amies – assez nombreuses pour remplir le Royal Albert Hall, ironisait Rebecca West – restèrent liées avec lui. À deux reprises, il fut profondément amoureux, mais les deux fois l’histoire finit mal. Lorsqu’il avait 25 ans, jugeant que la personne concernée n’était pas d’un niveau social approprié, sa mère l’obligea à rompre avec une jeune fille suisse, menaçant de lui couper les vivre s’il n’obtempérait pas. Il céda. Plus tard, en 1944, une Anglaise qu’il avait connue lors d’un séjour linguistique en Autriche mourut dans un bombardement au moment où il allait lui proposer de l’épouser.
Entretemps, il était entré au service de l’Amiral John Godfrey, le directeur du Service de renseignement de la marine de guerre. Godfrey, le principal modèle du personnage de « M » dans les aventures de James Bond, était à la recherche d’un collaborateur doué d’imagination et à l’aise en société. Son attention avait été attirée par une série de rapports sur la situation en Europe écrits par Fleming durant un bref passage dans l’univers de la finance. Il l’engagea. Jamais envoyé sur le terrain, Fleming fut par contre impliqué dans la conception de nombreuses initiatives importantes comme l’opération Mincemeat, une supercherie organisée en préparation du débarquement allié en Sicile, ainsi que d’autres actions, visant par exemple à mettre la main sur la machine allemande de codage Enigma. La direction d’un commando de 150 agents aguerris opérant dans l’Europe occupée lui fut confiée. Et il joua un rôle actif dans la mise sur pied du service de renseignement américain qui allait devenir l’OSS, puis la CIA.
Après la guerre, sollicité par Lord Kemsley, directeur du groupe de presse qui possédait le Sunday Times, Fleming fut nommé à la tête du service international du quotidien. Son contrat lui accordait trois mois de vacances annuelles qu’il passait à la Jamaïque dans un bungalow au confort sommaire qu’il avait fait construire sur l’île. Une partie des quelques centaines de correspondants qu’il dirigeait se livraient-ils à des activités d’espionnage à côté de leur travail de journalistes ? Nicholas Shakespeare laisse la question ouverte, tout comme celle de la nature exacte des liens qu’il conserva durant ces années avec ses anciens employeurs. En 1945, il refusa un poste important dans ce qui était devenu le SIS (Secret Intelligence Service). Mais il continua à l’évidence à suivre de très près ce qui se passait dans ce domaine, par exemple la défection à Moscou de Guy Burgess et Donald Maclean, deux membres du fameux cercle d’agents anglais de l’Union soviétique appelés les « Cinq de Cambridge », qu’il avait croisés à Eton.
Nicholas Shakespeare le fait clairement comprendre : si Ian Fleming a commencé à écrire des histoires d’espionnage, c’est parce qu’il était terrifié à la perspective de la vie monotone qui l’attendait après avoir épousé celle qui allait être sa veuve, Ann, l’ancienne femme de Lord Rothermere, le propriétaire du Daily Mail. Celui-ci venait de découvrir leur liaison, dont était née une fille qui n’avait pas survécu, et d’obtenir le divorce. Et Ann était à nouveau enceinte.
La première histoire de James Bond fut ainsi écrite en 1952 à la Jamaïque, en quelques semaines. Il en ira de même pour toutes les autres. Suivant l’exemple d’Alec Waugh (le frère d’Evelyn Waugh), Fleming s’obligeait à écrire chaque jour 2000 mots, durant cinq heures. Parfaitement conscient qu’il n’était pas un génie de la littérature, il s’efforçait d’atteindre une certaine qualité de prose, simple, énergique et efficace. Jamais il ne se relisait, jugeant plus important de conserver le rythme du récit que de perdre des heures à chercher un mot. Ses modèles en littérature étaient Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, John Buchan, Somerset Maugham, Georges Simenon et, par-dessus tout, Eric Ambler. Un jour, Raymond Chandler, qu’il admirait et qu’il avait eu l’occasion de rencontrer, lui dit qu’il était capable de faire mieux que ce qu’il avait produit jusque-là. L’effort qu’il fit en ce sens est à l’origine de Bons Baisers de Russie, sans doute son meilleur roman. À la Jamaïque, dans sa propriété baptisée Goldeneye, lorsqu’il n’écrivait pas, il s’adonnait à la pêche sous-marine. Il recevait souvent d’autres écrivains, par exemple Truman Capote, et de grands amis, comme Noël Coward.
L’univers des histoires de James Bond est psychologiquement pauvre, simpliste et manichéen. Il reflète un état d’esprit très présent durant la guerre froide et exprime la nostalgie des Britanniques au moment où leur pays perdait définitivement son rang de première puissance mondiale au profit des États-Unis. On a parfois dit que l’atmosphère de sexualité dans laquelle baignent ces histoires anticipait la libération des mœurs des années 1960. Comme le fait justement remarquer Nicholas Shakespeare, il faut plutôt y voir un écho de la liberté qui régnait dans ce domaine durant la guerre, dans un monde où l’on n’était jamais sûr d’être en vie le lendemain.
Parfois très drôle mais de tempérament fondamentalement mélancolique, à la fois séducteur et puritain, généreux et égocentrique, quelquefois charmant mais volontiers distant, Ian Fleming pouvait facilement changer d’humeur d’un jour à l’autre. Un trait fondamental de son caractère était une profonde horreur de l’ennui. « J’aime les sensations fortes », confia-t-il un jour. Lorsque sa vie ne lui procura plus l’excitation permanente que son existence de célibataire et son travail au sein des services secrets dans l’atmosphère fiévreuse de la guerre lui avaient fournie, il lui chercha un substitut dans la création d’un univers de fiction : James Bond est largement l’homme qu’il aurait rêvé être, il retrouvait avec lui l’intensité de sa jeunesse.
Avec l’épuisement progressif de son stock de souvenirs, son imagination tarit toutefois peu à peu. Le succès de ses livres et des premières adaptations à l’écran le rendit otage du personnage qu’il avait inventé, qui finit par le dévorer. Ses dernières années furent sombres, marquées par des tensions conjugales de plus en plus aigües – sa femme avait une liaison avec le leader du parti travailliste et lui avec une jeune et riche veuve rencontrée à la Jamaïque – ainsi que par deux pénibles procès : celui de sa mère, accusée de parjure dans une affaire l’opposant à la femme d’un vieil aristocrate qu’elle avait voulu épouser, et celui que lui intenta un des co-auteurs du scénario du film Opération Tonnerre dont il avait après coup tiré un roman.
Sa santé, compromise par des décennies de forte consommation d’alcool et de tabagisme effréné, se détériora. « J’échangerais volontiers tout cela, dit-il un jour à propos de sa notoriété tardive, pour un cœur en bonne santé. » Endommagé par une première crise durant son procès, le sien le lâcha peu de temps après, sur un terrain de golf. Sa mort précoce lui épargna d’apprendre le suicide, neuf ans plus tard, de son fils Caspar. Que Ian Fleming penserait-il en découvrant que quelque 100 millions d’exemplaires des aventures de James Bond ont été vendus à ce jour et que plusieurs milliards de personnes ont vu au moins un film le mettant en scène ? Il a créé un mythe, ce qui n’est pas donné à tout le monde, mais il n’est pas sûr qu’il en tirerait une particulière fierté.