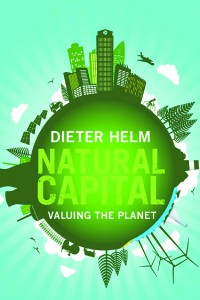Le précédent livre de Dieter Helm n’était pas à proprement parler consensuel : plaidoyer pour une taxe carbone mondiale,
« Le crash du charbon » recommandait de remplacer massivement les centrales à charbon très polluantes par des centrales à gaz (y compris de schiste), réputées un peu moins polluantes. Ne reculant devant aucun sujet épineux, l’économiste d’Oxford s’attaque aujourd’hui à un problème au regard duquel la lutte contre le réchauffement pourrait presque passer pour une promenade de santé. « Le capital naturel », voilà ce qui préoccupe Helm et qui donne son titre au nouvel ouvrage.
Comme l’explique l’auteur, la règle d’or de tout ministre de l’Économie, son objectif premier, avant même la lutte contre les déficits, devrait être de maintenir un niveau de ressources naturelles au moins égal, en valeur, à ce que lui ont transmis ses prédécesseurs. Ce qu’il appelle le « niveau agrégé de capital naturel » ne devrait jamais diminuer. C’est à cette condition, et à cette condition seulement, que la croissance pourra être qualifiée de « durable ».
Réduire la nature à une valeur monétaire ? Dieter Helm écarte toute objection faite à ce principe : « Ce que l’on mesure est ce qui tend à avoir de l’importance », écrit-il. Autrement dit, il faudra bien en passer par des calculs économiques si l’on veut avoir une chance de sauver notre planète. Helm reconnaît, en revanche, que les modalités de prise en compte de la nature dans la comptabilité nationale s’annoncent malaisées (c’est un euphémisme). « Si fixer le juste prix du charbon est déjà difficile, souligne l’économiste Frances Cairncross dans le mensuel
Prospect, l’opération est infiniment plus ardue et controversée pour l’Arctique immaculé ou la survie du léopard. » Comment évalue-t-on le degré d’importance d’une espèce, d’un paysage ou d’un écosystème ? Et comment détermine-t-on lesquels, parmi eux, pourraient éventuellement être sacrifiés et ceux qui doivent au contraire être sanctuarisés ?
Car, pour Dieter Helm, préserver le niveau du capital naturel ne signifie pas nécessairement le laisser intact. Une économie peut très bien dégrader ses ressources, du moment qu’elle prévoit des mécanismes pour les compenser. « Une politique de ce type impliquerait par exemple qu’un pays qui épuise ses réserves de pétrole réinvestisse une partie des revenus qu’il tire de cette activité dans la promotion d’alternatives renouvelables », développe Nick Hanley dans la revue
Nature.
L’exemple n’est pas choisi au hasard. En effet, comme le rapporte David Runciman dans la
London Review of Books, « les sources d’énergie non renouvelables comme les combustibles fossiles ont tendance à être substituables ».
On peut imaginer que la technologie offre de plus en plus d’alternatives crédibles au charbon, au gaz et au pétrole. Mais le problème reste entier concernant la plupart des ressources renouvelables, celles qui – tout comme les espèces, les paysages et les écosystèmes cités plus haut – se régénérèrent normalement de façon naturelle. Parce que ces « biens » sont aujourd’hui les plus menacés, il importe, selon Helm, d’en dresser au plus vite un audit détaillé.
Mais vient alors la question du contrôle. Quand bien même les économistes parviendraient à mettre au point les outils d’une comptabilité fiable de la nature, qui déciderait de sa gestion ? Dieter Helm plaide pour la création de nouvelles institutions
ad hoc, aux moyens importants, afin de s’assurer en toute indépendance de l’évaluation et de la compensation des ressources naturelles sur le marché. Comme il le formule, « les prix sont peut-être imparfaits, mais ils sont en général nettement supérieurs aux solutions alternatives ». Pour Runciman, un tel mécanisme reviendrait à favoriser le pouvoir des experts et des bureaucrates au détriment de la participation démocratique. Or, « l’expérience de la décennie écoulée suggère que se reposer sur un mélange de marchés et de régulateurs est extrêmement dangereux ».