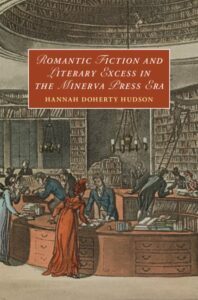Demoiselles en mal d’amour
Publié en mai 2024. Par Books.
Trop de livres ! Le sombre auteur de l’Ecclésiaste s’en plaignait déjà. Qu’aurait-il dit en voyant le déferlement, en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle, des « romans gothiques », des mélodrames ultra sentimentaux aussi spectaculaires par leur nombre que par leur longueur ? Ces ouvrages visaient un lectorat émergent, pas trop exigeant et largement féminin, avide d’héroïnes éthérées qui, dans des châteaux généralement en ruine et en Écosse, se laissaient terroriser pendant des volumes (jusqu’à 10 !) par des bandits, des fantômes ou des séducteurs cyniques. Dans son pavé formidablement détaillé, l’universitaire Hannah Doherty Hudson décrit en grande profondeur ce phénomène littéraire qu’avait stimulé la maison d’édition Minerva Press, aux buts et aux méthodes résolument commerciaux.
Sujets à des modes et donc éphémères, les « romans gothiques » semblaient issus du même moule tant ils se copiaient les uns les autres. Ils étaient bon marché car fabriqués en masse, et même accessibles à bas prix aux abonné(e)s des « bibliothèques circulantes ». Enfin leur inépuisable contenu, stéréotypé et d’une lecture facile, était à la portée des plus rustiques. Samuel Richardson avait lancé le mouvement en 1749 avec Clarissa (7 volumes, 1 million de mots) ; mais c’est Ann Radcliffe la grande pionnière de « ces auteurs qui pour 5 à 10 £ étaient capables de maintenir des demoiselles en mal d’amour suspendues entre espoir et désespoir pendant des milliers de pages », écrit Freya Johnston dans The Times Literary Supplement. Bien entendu les beaux esprits virent d’un mauvais œil cette nuée d’ouvrages réputés médiocres, littérairement comme moralement (« Mauvais auteurs-mauvais lecteurs »), dilatés sans vergogne à coup de plagiats, de tripatouillages typographiques ou de superfluités éhontées. Heureusement, Walter Scott (22 romans en 71 volumes, plus ou moins ancrés dans la réalité historique) et Jane Austen, aux récits plus courts mais stylistiquement comme psychologiquement très soignés, relevèrent le genre. Après avoir publié entre 1790 et 1820 plus d’un quart des livres anglais, la Minerva Press fut emportée par la vague qu’elle avait déclenchée, et que la presse à vapeur de l’Allemand Koenig, aux capacités quadruplées, allait encore renforcer. Aujourd’hui on publie toujours trop de romans, déplore Freya Johnston ; « mais où donc se situe la limite ? ».