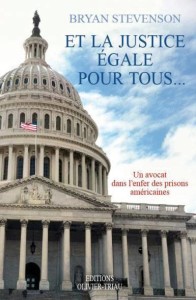Selon Amnesty International, un petit Afro-Américain sur huit passera au moins deux ans de sa vie en prison avant de fêter son 20e anniversaire. Sur les 18 000 prisonniers exécutés aux États-Unis depuis l’instauration de la peine de mort en 1790, 42 % étaient des Noirs, dont 15 % avaient été condamnés à tort (1).
Ces chiffres, abondamment relayés par les médias, finissent par susciter dans l’opinion publique européenne de la résignation ou de l’indifférence à l’égard de l’injustice qui mine le système pénal outre-Atlantique. En racontant la douleur des hommes et des familles que les statistiques seules ne parviennent pas à dire, l’avocat Bryan Stevenson rappelle ce qui caractérise d’abord l’univers carcéral : la misère sociale à l’extérieur, la violence et la mort à l’intérieur. Dans son livre
Just Mercy, qui vient d’être traduit en français sous le titre
Et la justice égale pour tous…, il revient sur l’histoire révoltante de Walter McMillian, condamné à la peine capitale en 1988 pour un meurtre qu’il n’avait pas commis. Ce faisant, il nous plonge au cœur d’un système qui repose fondamentalement sur l’erreur. Et on n’en ressort pas indemne.
Stevenson commence par le commencement : sa propre enfance dans une communauté noire rurale de l’État du Delaware. Puis son parcours exemplaire à l’université publique, qui lui ouvre les portes de l’école de droit de Harvard. À la fin de sa première année, Stevenson décide de passer l’été en Géorgie, dans le sud des États-Unis, pour travailler comme bénévole dans un petit cabinet qui vient en aide aux prisonniers démunis. Sa rencontre avec un condamné du couloir de la mort lui fait l’effet d’un électrochoc. Son diplôme en poche, Stevenson fait ses valises pour l’État de l’Alabama, où il monte une association, Equal Justice Initiative (EJI), destinée aux détenus ne bénéficiant pas d’assistance juridique (2). Stevenson a bientôt à défendre Walter McMillian, condamné à mort pour le meurtre d’une jeune femme qu’il n’a jamais vue. McMillian est un homme travailleur et très apprécié au sein de sa communauté. Sa seule faute est d’avoir eu une liaison avec une femme blanche et mariée. Et d’être noir. C’est pour cela qu’il a été condamné à mort pour homicide.
À mesure que Stevenson enquête, mettant au jour l’écœurante machination – où se conjuguent corruption, parjure, décisions de justice ouvertement racistes et falsification de documents – qui a abouti à sa condamnation, l’image effrayante du système policier et judiciaire de l’Alabama des années 1980 se révèle. Au bout d’une dizaine de pages, il apparaît clairement que la condamnation de McMillian est tout simplement un acte raciste, qui témoigne d’une violence d’État systémique et institutionnalisée (3).
En croisant ses connaissances juridiques et historiques, Stevenson analyse les origines de cette violence qui, selon lui, puise ses sources dans les lois esclavagistes. Stevenson va jusqu’à affirmer que l’incarcération de masse des Afro-Américains s’inscrit dans le droit fil de la ségrégation raciale et du lynchage. Stevenson montre comment le racisme opère de façon insidieuse au quotidien. Il se souvient d’être rentré chez lui un soir après une longue journée passée avec des détenus dans le couloir de la mort. Sur le chemin du retour, il allume la radio et tombe sur une émission de chansons de
Sly and the Family Stone, un de ses groupes favoris. « Après trois ans en Alabama, ce genre de petites joies était essentiel au maintien de mon équilibre mental », raconte Stevenson. Alors qu’il arrive dans sa rue, il décide de rester encore un peu dans sa voiture pour écouter la fin d’un morceau, malgré sa fatigue et l’heure tardive. À ce moment-là, une voiture de police s’arrête et les deux agents braquent une torche sur lui. Stevenson ouvre calmement la portière de son véhicule pour rentrer chez lui quand un des policiers sort son arme et la pointe sur sa tête en hurlant : « Si tu bouges, je t’explose la cervelle ! » Stevenson reste immobile, même si son instinct lui crie de détaler. Sous les insultes racistes des voisins penchés aux fenêtres pour observer la scène, Stevenson patiente alors que les policiers fouillent sa voiture, avant de finalement le laisser partir. À compter de ce moment, une question obsède Stevenson : comment expliquer à tous les jeunes Noirs du quartier qu’ils ne doivent jamais tenter de fuir dans ce genre de circonstances ?
Le combat quotidien de Stevenson contre l’injustice est d’abord et surtout le combat contre le délabrement social qui ronge la société américaine. Si la bataille judiciaire de six ans pour faire annuler la condamnation à mort de McMillian constitue le fil conducteur du livre, on rencontre en chemin nombre d’affaires tout aussi révoltantes. Il y a le cas d’Antonio Nuñez, le seul mineur des États-Unis à avoir été condamné à mort, pour avoir été impliqué, à l’âge de 14 ans, dans un délit qui n’avait pas fait de blessés. Il y a l’histoire de Marsha Colbey, condamnée à mort en 2007 pour avoir donné naissance à un bébé mort-né, qu’elle fut accusée d’avoir tué. Il y a aussi celle de Diane Tucker, atteinte de troubles mentaux, condamnée à mort pour un meurtre qui n’avait jamais eu lieu. Stevenson pointe les erreurs judiciaires à l’origine de ces affaires et montre que l’incarcération perpétue les inégalités sociales.
Au début du livre, l’auteur se souvient d’une phrase que lui disait sa grand-mère : « On ne comprend pas les choses importantes si on est trop loin, Bryan. Pour comprendre, il faut s’approcher. » Dans
Et la justice égale pour tous…, Stevenson nous entraîne au plus près de la violence du système carcéral. Sans rien nous épargner. Il décrit comment, au centre pénitentiaire William C. Holman, où McMillian est incarcéré, les détenus vivent au rythme des crépitements de la chaise électrique, la « Yellow Mama », comme ils la surnomment. Stevenson reproduit le compte rendu complet de l’exécution de John Evans, électrocuté quelques années avant l’arrivée de McMillian : l’opération dura quatorze minutes, durant lesquelles Evans reçut trois décharges de 1 900 volts qui laissèrent son corps en lambeaux, fumant et déchiqueté. On apprend que des flammes jaillissaient des électrodes collées sur la peau de son torse, que la pièce sentait la chair brûlée, que l’air était irrespirable.
Dans le chapitre suivant, Stevenson nous fait revivre la dernière journée du condamné à mort Herbert Richardson, qu’il passa à ses côtés. Il évoque les agents chargés de lui raser le torse afin qu’il puisse être « tué plus efficacement », le surveillant pénitentiaire qui sépare Herbert de sa famille venue lui rendre visite une dernière fois, les gardiens qui semblent mal à l’aise et Herbert qui cherche à réconforter tout le monde. Comme si tous avaient conscience qu’il y avait quelque chose d’absurde à tuer cet homme aimant et aimé. « Les considérations abstraites sur la peine de mort sont une chose, nous dit Stevenson, mais la réalité de la mise à mort systématique de quelqu’un qui n’est pas un danger en est une autre. »
Finalement, écrit Stevenson, la vraie question que soulève la peine de mort est celle-ci : avons-nous le droit de tuer ? Dans un des derniers chapitres, il relate le cas de Jimmy Dill, exécuté par l’État de l’Alabama le 19 avril 2009. Ce jeune homme, souffrant de troubles mentaux et ayant subi des violences physiques et sexuelles quand il était enfant, avait bénéficié d’une assistance juridique si sommaire durant son procès que ni les jurés ni la cour n’avaient été en mesure d’établir si oui ou non il avait commis les crimes dont il était accusé. En dépit de cette procédure bancale et de la jurisprudence de la Cour suprême des États-Unis – qui avait rendu un arrêt interdisant l’exécution de personnes handicapées mentales –, Jimmy fut déclaré coupable en 1989 et condamné à mort. Vingt ans plus tard, quand Stevenson entreprit de demander la révision de son procès, la cause semblait perdue d’avance – et Jimmy fut en effet électrocuté. La nuit précédant son exécution, Jimmy appela son avocat : « Monsieur Bryan, je veux juste vous dire merci, merci de vous êtes battu pour moi. Merci de vous être intéressé à moi. Je vous aime. Merci d’avoir essayé de me sauver. » Et Stevenson de s’en remettre à la puissance de la compassion et du pardon, car « nous valons tous mieux que les pires choses que nous ayons commises ».
Des journalistes ont critiqué le ton emphatique de Stevenson, des universitaires lui ont reproché sa conception simpliste et manichéenne de l’injustice, des politiques sa vision caricaturale de la réalité. Pourtant, le récit de Stevenson est tout l’inverse. Quand il raconte la libération de McMillian, innocenté après des années de combat judiciaire, Stevenson se rappelle s’être senti triste et en colère. Pas d’effusions de joie, pas de
happy end hollywoodien. Stevenson voit d’abord toute la douleur que McMillian et sa famille ont endurée. Et pense à tous les autres condamnés qu’il n’a pas réussi à sauver. Et la justice égale pour tous… ne s’arrête pas à la libération de McMillian, mais relate sa vie d’après, sa difficulté à reconstruire une existence brisée par six ans passés dans le couloir de la mort.
Pourquoi nous autres, Européens, devrions-nous lire
Et la justice égale pour tous… ? Parce que ce livre n’est pas qu’un témoignage de l’injustice qui règne dans le sud des États-Unis. Il nous rappelle aussi que, derrière les sciences sociales, il y a des êtres humains en chair et en os. Et que l’on peut parler de couleur de peau sans être raciste. Enfin,
Et la justice égale pour tous… bouscule le regard satisfait que nous portons volontiers sur nos pays où la peine capitale a été abolie, en nous rappelant que la vraie valeur d’une communauté ne se mesure pas tant à ses lois qu’à la manière dont les plus démunis, les détenus et les condamnés sont traités. « Le contraire de la pauvreté ce n’est pas la richesse, le contraire de la pauvreté c’est la justice », nous dit Stevenson.
—
Rosalie Calvet est étudiante à l’université Columbia de New York après un cursus à l’Institut d’études politiques de Paris. Cet article lui a valu le prix Books-Sciences Po de l’essai critique 2016.
Notes
1. « U.S. Death Penalty Facts », Amnesty International USA.
2. Dans de nombreux États du sud des États-Unis, il n’existe pas de système d’avocats commis d’office.
3. Walter McMillian a été acquitté et libéré en 1993. Deux ans plus tard, Pete Earley, un ancien journaliste du Washington Post, a publié une enquête fouillée sur son cas, intitulée Circumstantial Evidence: Death, Life, and Justice in a Southern Town (« Preuves indirectes : mort, vie et justice dans une ville du sud des États-Unis »).