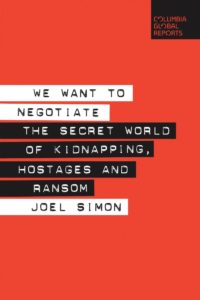Publié dans le magazine Books n° 106, avril 2020. Par Caroline Moorehead.
Les États occidentaux sont de plus en plus souvent confrontés à l’enlèvement de leurs ressortissants par des groupes terroristes ou criminels. Négocier ? Payer une rançon ? Certains le font, d’autres s’y refusent. Pour sortir de ce dilemme moral et politique, mieux vaut s’en remettre à des professionnels.
© Jean-Claude Coutausse / Divergence
En France, un enlèvement est une affaire d’État. Ici, en avril 2014, à l’arrivée de Didier François, Édouard Élias, Nicolas Hénin et Pierre Torres, détenus pendant dix mois en Syrie.
Le verbe « kidnapper » – de l’anglais
kid (« enfant ») et
nap (« enlever ») – est apparu à la fin du XVII
e siècle dans les pages de la
London Gazette à propos d’un certain John Dykes, reconnu coupable d’avoir « kidnappé des sujets de Sa Majesté pour les envoyer travailler dans les plantations d’outremer ». Edward Phillips, le neveu du poète John Milton, jugea le terme suffisamment courant pour le faire figurer en 1678 dans la quatrième édition de son dictionnaire. Plus tard, au milieu du XIX
e siècle, le mot
blackbirding [de blackbird
, « merle noir »] fut forgé pour désigner l’enlèvement de Noirs en vue d’en faire des esclaves.
Les prises d’otages remontent bien sûr à la nuit des temps. La mythologie grecque regorge d’affaires de ce genre. Et les enlèvements étaient monnaie courante dans l’Angleterre médiévale ainsi que chez les corsaires barbaresques qui écumaient la Méditerranée et chez les brigands des montagnes du sud de l’Italie. La pratique s’est aujourd’hui professionnalisée et a pris un tour plus...