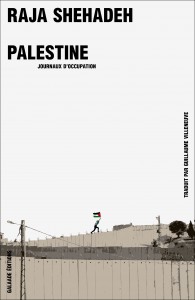L’homme qui marche en Palestine
Publié en mai 2016. Par Sandrine Tolotti – Dans la chair des livres.
« Nulle part ne peut-on trouver une retraite plus calme ou moins troublée que dans sa propre âme. »
Marc Aurèle, Pensées pour moi-même.
Le printemps va comme un gant à Raja Shehadeh. Ses chères collines de Cisjordanie se couvrent de ces minuscules fleurs sauvages qui leur font comme un tapis brodé – iris bleus, fleurs de lin roses, cyclamens multicolores. C’est le moment où les oueds se gorgent d’eau, ressuscités pour quelques mois à peine. Celui, aussi, où cet avocat-écrivain palestinien recommence vraiment à s’abandonner à la tranquillité de son jardin, dans la maison de Ramallah où il s’est bâti, de guerre lasse, un refuge personnel contre l’occupation. Puisque refuge il faut. Ma première rencontre avec Raja Shehadeh s’est faite, comme il est fréquent à la rédaction de Books, dans la presse anglo-saxonne ; il y était question de ses Palestinian Walks, livre traduit en français il y a quelques années sous le titre Naguère en Palestine. Un récit intimiste des promenades que l’écrivain a coutume de faire à travers la Cisjordanie pour, dit-il, s’échapper et se ressourcer. J’ai parlé de promenade, mais j’aurais dû écrire sarha, parce que la sarha est bien autre chose qu’une simple virée. Les hommes vivant dans ces parages cultivaient naguère ce goût de partir sur les collines pour un jour, des semaines ou des mois, reflet de tout un mode de vie : « Partir en sarha, explique Raja Shehadeh, c’était vaguer librement, au gré des envies, sans contrainte. Dans sa forme verbale, le mot signifie amener le bétail au pâturage de bonne heure, le laisser vagabonder et paître librement. Un homme qui part en sarha se promène sans but, sans restriction de temps ni de lieu ; il va où son esprit le guide pour nourrir son âme. Partir en sarha implique de lâcher prise. C’est une défonce sans drogue, typiquement palestinienne. »Je me souviens encore de l’étonnement ravi qui m’avait saisie à l’idée même d’un randonneur de Cisjordanie. Un homme qui marche, en Palestine ? Comment ça ? Est-ce qu’il n’y avait pas mieux à faire, dans cette terre déchirée, que d’aller se promener sur les collines ? Question idiote. Raja Shehadeh ne sait pas vivre autrement. Précisément parce que cette terre est déchirée, précisément parce que l’air, là-bas, est saturé de politique, précisément parce que de hauts murs, réels et imaginaires, y bouchent l’horizon, certains ont encore plus besoin là qu’ailleurs d’aller chercher cette « absolue indépendance à l’égard des engagements du monde » dont parle Henry David Thoreau à propos de la marche. Sauf qu’ici, l’absolue indépendance à l’égard des engagements du monde n’est jamais tout à fait accordée. Ce n’est pas tant qu’il faille vivre avec au cœur un pincement patriotique ; mais qu’il faille s’accommoder de mille entraves au jour le jour, mille refus de vie normale, mille rappels de son statut de dominé. Vivre sous occupation, c’est devoir supplier un soldat de vous laisser rentrer chez vous, après une journée de balade, parce qu’un couvre-feu a été instauré et que vous ne le saviez pas : « Oh l’humiliation de devoir supplier un étranger pour quelque chose d’aussi basique. » Vivre sous occupation, c’est rentrer chez soi un jour de neige, brûler un stop pour ne pas risquer le dérapage, et être arrêté par des soldats qui passaient et vous soupçonnent d’avoir voulu les fuir. Vivre sous occupation, c’est subir à plus de 80 ans (comme la mère de l’auteur) l’arbitraire d’une autorité qui refuse de renouveler le visa de l’auxiliaire de vie que vous aimiez tendrement et sur qui reposait votre quotidien. Il n’existe probablement pas de définition plus crue de ce que le mot pouvoir veut dire. Lire Naguère en Palestine (complété par Palestine, journaux d’occupation, à paraître le 12 mai), c’est plonger au cœur – littéralement – du « problème palestinien ». C’est l’une des rares occasions offertes à ceux qui ne peuvent se rendre dans les Territoires occupés de saisir au plus près de l’intime ce qui se joue là-bas. Car le livre de Raja Shehadeh possède cette double dimension propre aux meilleurs récits de marche, à la fois exploration d’un paysage et exploration de soi. Or les coups portés au premier, ici, vous vrillent une âme. Comment pourrait-il en être autrement ? Comment un randonneur passionné préserverait-il sa personnalité et sa vie des bouleversements subis par les effets de l’occupation sur son paysage chéri ? A fortiori quand il s’agit d’un avocat et militant des droits de l’homme qui se bat au quotidien contre les confiscations de terres palestiniennes par Israël. Et que, de plus en plus, il le fait en vain. Naguère en Palestine raconte six promenades à travers la Cisjordanie, mais le livre lui-même en figure une autre, la plus belle de toutes : le cheminement d’un homme de la rage à l’apaisement. [caption id="attachment_37052" align="alignnone" width="381"]« Un homme qui part en sarha se promène sans but, sans restriction de temps ni de lieu ; il va où son esprit le guide pour nourrir son âme. Partir en sarha implique de lâcher prise. C’est une défonce sans drogue, typiquement palestinienne. »
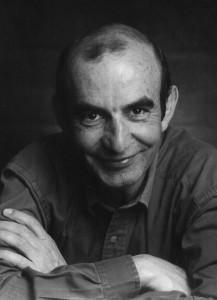 Raja Shehadeh. DR.[/caption]
La rage, d’abord, que lui inspire la lente agonie des collines de Palestine. Tout au long des années 1980 et 1990, il la sent sous ses pas, quand il lui faut prendre d’autres chemins, ou même renoncer à telle balade, en raison des routes et, bientôt des murs, qu’Israël construit pour les colons en tronçonnant le territoire. Il la voit s’imprimer sur ses pupilles, quand elles butent sur la silhouette blanche et massive d’une colonie installée sur un sommet, là précisément où les villages palestiniens ne nichent jamais, mieux protégés qu’ils sont, en bas, contre les vents violents et les intempéries. Il la touche du bout des doigts à chaque fois qu’il s’empare – gare aux chiens errants ! – d’une branche de natsh, la pimprenelle épineuse qui envahit tout depuis l’abandon des cultures en terrasse, et dont l’administration militaire se sert devant les tribunaux pour attester l’absence de propriétaire. « Sommet après sommet, résume Raja Shehadeh, les collines furent revendiquées par les colonies juives qui se multipliaient. Ensuite, ces colonies se rejoignirent pour former des “blocs de colonies”. Des routes furent construites entre ces implantations tandis que, tout autour, des portions de plus en plus larges de terre furent réservées à leur future expansion, privant de plus en plus de villages de leurs terres agricoles ».
Et puis il y a la rage, cent fois plus forte si c’est possible, que font naître en lui les accords d’Oslo, cette « reddition » qui allait laisser la question de la colonisation hors des compétences de l’Autorité palestinienne (depuis, le nombre de colons a plus que doublé). Pour obtenir la reconnaissance de l’OLP, pense Raja Shehadeh, Yasser Arafat a sacrifié tout le reste : « D’un coup, l’opportunisme politique avait conduit à accepter tous les changements survenus de manière illégale dans les Territoires occupés, contre lesquels nous nous battions depuis plus de deux décennies. » La crise existentielle noire où le plonge cette « défaite » hante Naguère en Palestine. « Pendant des années, je me suis raccroché à l’espoir que ces colonies ne seraient pas permanentes. Je m’étais méticuleusement documenté sur chacune des étapes du processus illégal au terme duquel elles finissaient par s’établir. Je savais désormais que je m’étais bercé d’illusions. En dehors de ma tête, il n’y avait aucun lien entre mon savoir et la réalité. Les accords d’Oslo décapitèrent ma vérité. J’avais gâché toutes ces années à travailler sur ces questions de droit et de droits de l’homme qui n’avaient servi à rien. »
Raja Shehadeh. DR.[/caption]
La rage, d’abord, que lui inspire la lente agonie des collines de Palestine. Tout au long des années 1980 et 1990, il la sent sous ses pas, quand il lui faut prendre d’autres chemins, ou même renoncer à telle balade, en raison des routes et, bientôt des murs, qu’Israël construit pour les colons en tronçonnant le territoire. Il la voit s’imprimer sur ses pupilles, quand elles butent sur la silhouette blanche et massive d’une colonie installée sur un sommet, là précisément où les villages palestiniens ne nichent jamais, mieux protégés qu’ils sont, en bas, contre les vents violents et les intempéries. Il la touche du bout des doigts à chaque fois qu’il s’empare – gare aux chiens errants ! – d’une branche de natsh, la pimprenelle épineuse qui envahit tout depuis l’abandon des cultures en terrasse, et dont l’administration militaire se sert devant les tribunaux pour attester l’absence de propriétaire. « Sommet après sommet, résume Raja Shehadeh, les collines furent revendiquées par les colonies juives qui se multipliaient. Ensuite, ces colonies se rejoignirent pour former des “blocs de colonies”. Des routes furent construites entre ces implantations tandis que, tout autour, des portions de plus en plus larges de terre furent réservées à leur future expansion, privant de plus en plus de villages de leurs terres agricoles ».
Et puis il y a la rage, cent fois plus forte si c’est possible, que font naître en lui les accords d’Oslo, cette « reddition » qui allait laisser la question de la colonisation hors des compétences de l’Autorité palestinienne (depuis, le nombre de colons a plus que doublé). Pour obtenir la reconnaissance de l’OLP, pense Raja Shehadeh, Yasser Arafat a sacrifié tout le reste : « D’un coup, l’opportunisme politique avait conduit à accepter tous les changements survenus de manière illégale dans les Territoires occupés, contre lesquels nous nous battions depuis plus de deux décennies. » La crise existentielle noire où le plonge cette « défaite » hante Naguère en Palestine. « Pendant des années, je me suis raccroché à l’espoir que ces colonies ne seraient pas permanentes. Je m’étais méticuleusement documenté sur chacune des étapes du processus illégal au terme duquel elles finissaient par s’établir. Je savais désormais que je m’étais bercé d’illusions. En dehors de ma tête, il n’y avait aucun lien entre mon savoir et la réalité. Les accords d’Oslo décapitèrent ma vérité. J’avais gâché toutes ces années à travailler sur ces questions de droit et de droits de l’homme qui n’avaient servi à rien. »
C’est pour cela qu’il lui faut un refuge. A mesure que s’effondre le monde qu’il aime, Raja Shehadeh se laisse happer par le souvenir d’un cousin de son grand-père maternel, véritable légende familiale. « Comme j’envie la confiance, la certitude avec laquelle Abu Amin considérait les collines où il passa sa vie, tenant pour acquis qu’elles ne changeraient jamais », écrit-il dès l’orée du livre. A vrai dire, ce que l’écrivain envie surtout, on s’en aperçoit vite, c’est l’existence d’un homme qui avait su conquérir, six mois l’an, le droit de se retirer du monde. Six mois d’un bonheur ordinaire et total. Cet « homme de peu de mots », jambes courtes, torse large et musculeux, n’avait pas voulu faire d’études, au grand regret du reste de la famille. L’école lui était une prison. Exceller dans le métier complexe et magnifique de tailleur de pierres, travailler dur, s’acheter un terrain, c’était son projet de vie et il n’en démordrait pas. L’évocation de cette personnalité singulière de presque ermite m’a rappelé celle de la « race » des « gens de peu » dont Pierre Sansot a fait l’émouvant éloge : « Ils possèdent un don, celui du peu, comme d’autres ont le don du feu, de la poterie, des arts martiaux, des algorithmes. Sans doute vaut-il mieux manifester de la grandeur dans le peu que demeurer indécis, épais, risible, incapable d’un beau geste dans “l’aisance” ». Cet Abu Amin à qui il suffisait de toucher une pierre pour la jauger vivait corseté à Ramallah avec toute la famille (ils étaient dix) – et parfois les bêtes, les nuits d’hiver trop froides – dans deux pièces d’une maison caverneuse qui empestait le moisi. Oui, mais Abu Amin passait chaque année six mois de ravissement en vivant comme un prince du peu dans le qasr qu’il s’était construit seul, avec sa femme – pendant leur lune de miel. Un qasr inhabituellement haut, avec ses deux étages, l’un des plus beaux des collines ; près de la porte d’entrée, il s’était même sculpté un fauteuil monumental dans un rocher impossible à déplacer, devenu mythique dans la famille où l’on parlait de trône (arsh). Un prince, on vous dit. Le qasr est une bâtisse ronde en pierre que l’on croise un peu partout en Cisjordanie. Les paysans y stockaient leur récolte, tout en dormant sur le toit. Ce mode de vie rêche lié à la culture en terrasses a aujourd’hui disparu. Mais alors, il faisait la joie d’Abu Amin : « La fin de l’hiver était longue à venir pour lui, écrit Raja Shehadeh ; il avait hâte de rejoindre les collines pour dormir sur le toit de son qasr sous le ciel étoilé et s’éveiller au petit matin, les vêtements mouillés par la rosée. C’est surtout le silence qui lui manquait. Ce silence qui n’existe que sur les collines ». Là, il passait tout l’été à cultiver sa terre et à partir en sarha. Libre d’oublier le reste du monde, la présence des Anglais, ses enfants flemmards, le bavardage des femmes et l’air empuanti. Seul avec sa mule, dit-on, il était heureux. Il y a chez ce tailleur de pierres quelque chose de l’homme que Raja Shehadeh voudrait être. Après tout, pourquoi pas ? Et s’il pouvait, lui aussi, se créer sa bulle à l’écart des bruits du monde ? C’est dans un monastère où l’a mené une sarha, aux portes du désert du Neguev, qu’il trouve la réponse. En songeant, émerveillé, à ces moines de Saint-Georges de Koziba qui ont su pendant des siècles sauvegarder la quiétude de leur vie monastique malgré les vagues de conquérants, se contentant de cultiver leur jardin. « Cette terre de troubles et de guerres a toujours eu des oasis de tranquillité et de paix où les moines ont pu se cacher sans se préoccuper des événements du monde qui se déroulaient à l’extérieur de leur porte. Telle est peut-être la seule grâce de la religion en Terre sainte. Je songeai alors à m’inspirer de cette longue tradition et à me trouver un endroit tranquille où je pourrais me réfugier et attendre que la roue tourne en soignant mon désespoir devant le pouvoir débridé d’Israël. Je ne puis continuer dans un tel état de colère, sauf à la laisser consumer toute mon énergie et me gâcher la vie à force de doléances et de regrets. Il est un moment où il faut accepter la réalité, si difficile qu’elle soit, et trouver les moyens de vivre avec, sans perdre son estime de soi ni ses principes. » Il prend la double décision de construire sa maison et de se consacrer pour l’essentiel à l’écriture ; l’une et l’autre lui feront un sanctuaire. Réalisme oblige, il bâtit sa maison à l’intérieur des limites de Ramallah, pour être protégé contre les expropriations israéliennes, et s’y pelotonne. « Nous avions une cour où nous nous étions gardé un bout de ciel. Ce genre de refuge, dans des périodes aussi sombres, était peut-être la seule façon de préserver son intégrité et son mode de vie. » Peut-être en effet, puisque tout autour le monde qu’il aime s’abîme chaque jour davantage. Le monde qu’il aime conserve la couleur noir et or du premier papillon monarque, aperçu un jour d’enfance dans le jardin majestueux de feu le Grand Hôtel de Ramallah ; il a le parfum du thym et de l’origan qui embaume les collines et la saveur des pique-niques au bord de la mer morte (« rien de tel que d’être au bord de la mer Morte un soir de pleine lune »). Et, avec la générosité paradoxale de l’amoureux fou, Raja Shehadeh plaide que ce monde-là n’est ni palestinien, ni israélien. Il appartient à tous ceux qui parlent plus qu’ils ne tweetent, qui regardent plus qu’ils ne photographient, qui cultivent leur jardin – quel qu’il soit – plus qu’ils ne consomment. Qui aiment la terre plus que les drapeaux. Le plus beau passage du livre est une ode à cette conception de la vie évanescente, en Palestine comme ailleurs. Cela se produit lors d’une promenade dans la vallée du Jourdain. En arrivant au bord d’un oued, l’écrivain-marcheur s’avise qu’il y a déjà quelqu’un, que c’est un jeune colon, qu’il est en train de se préparer tranquillou un narguilé de haschich et « d’une autre substance, plus forte et indéfinissable ». Il poursuit sa route, s’efforçant d’attirer le moins possible l’attention (les attaques de colons contre des Palestiniens se sont multipliées, en toute impunité), traverse à gué en choisissant les pierres où poser ses pieds, jusqu’à ce qu’il entende – en hébreu : « Votre chapeau. Vous avez fait tomber votre chapeau ». Le colon, plus agile, rattrape le couvre-chef et le lui tend. Mais Raja Shehadeh ne peut s’empêcher de lorgner sur l’arme posée à côté du narguilé. S’engage une discussion dont le venin (« La terre que nous avez prise » / « Eretz Israël est à nous ») est neutralisé par l’amour commun du lieu. (« Cet oued n’est-il pas magnifique au printemps ? » / « Celui-ci tout particulièrement »). Pendant tout le temps de l’algarade, et elle dure, le jeune Israélien tient toujours à la main le chapeau de Raja Shehadeh. Quand il le lui rend, l’avocat reprend sa promenade. Mais l’autre lui demande de s’arrêter. Shehadeh est tétanisé. Et s’il allait lui tirer dessus ? « Vous voulez fumer avec moi ? » Oui, il veut, aussi étonnant que cela puisse paraître. Le colon et le Palestinien s’évadent donc un moment ensemble vers des paradis artificiels. Le hashish était opiacé, comme quoi se promener en Palestine peut être une défonce avec drogue, aussi. « Ce sont encore mes collines, malgré la façon dont les choses ont évolué. Mais elles appartiennent aussi à quiconque est capable de les apprécier. Pour l’heure, lui et moi pouvions bien nous octroyer un court répit, le temps de fumer un narguilé, un bref instant rassemblés par notre amour commun pour cette terre. »« Comme j’envie la confiance, la certitude avec laquelle Abu Amin considérait les collines où il passa sa vie, tenant pour acquis qu’elles ne changeraient jamais. »
Le plus terrible, c’est que cette possibilité d’un rapport contemplatif au monde, la possibilité précisément que Raja Shehadeh cherche au fond de sarha en sarha, ne disparaît pas seulement en raison de l’occupation. Elle est également défaite par l’intrusion d’une forme de modernité. La manne financière qui a accompagné les accords d’Oslo bouleverse la société palestinienne, et la question du matérialisme triomphant irrigue Palestine, Journaux d’occupation, le nouveau livre de Raja Shehadeh. Désespéré de voir Ramallah vérolée de panneaux publicitaires qui ne manquent pas d’ironie en affirmant qu’« il n’y a pas de limites à vos rêves » – mais il ne s’agit que de prêts bancaires. « A présent, les banques dominent nos vies comme leurs pancartes dominent nos ciels », commente l’écrivain, qui n’a pas de mots assez durs pour la classe d’arrivistes en plein essor et pour certains « fonctionnaires palestiniens irresponsables, ivres de pouvoir et avides d’argent facile ». On rit au souvenir d’une conversation entre deux garçons volée dans un restaurant hype de Ramallah, dont l’un se vante de se faire faire un soin du visage partout où il va. On se désole à l’évocation de l’outrecuidance culinaire du lieu, qui vaut au taboulé « traditionnellement délicieux, avec de l’huile et du citron » d’arriver nappé, « je vous le donne en mille, de sauce à l’ananas ». Beurk. Mais le pire, c’est la frénésie de construction qui s’est emparée de l’Autorité palestinienne. La ville nouvelle de Rawabi tout juste sortie de terre, ouvre une perspective insupportable à Raja Shehadeh : « Ce n’est qu’après avoir vu la ville nouvelle de Rawabi en construction dans les collines au nord de Ramallah que j’ai compris toutes les implications de notre défaite. Au lieu de lutter pour gagner notre propre espace et affirmer notre mode de vie, nous cherchons à copier le colonisateur et à recourir aux mêmes méthodes destructrices qui défigurent la terre et le patrimoine naturel. » Mais pour faire face à sa défaite, Raja Shehadeh possède maintenant depuis près de vingt ans ce double sanctuaire qu’est l’écriture et sa maison : « J’ai fini par apprendre ce qui s’épanouit le mieux ici. J’ai réussi à implanter des cyclamens entre les rochers qui bordent les massifs surélevés des troncs d’oliviers : ils se portent à merveille et jaillissent dans les interstices comme des cierges. Le temps est magnifique, tout est rafraîchi par une brise suave. Je n’ai besoin de rien en un tel jour. » De sa terrasse, nous glisse-t-il, on jouit encore d’un angle sans immeubles de haute taille par lequel apercevoir le littoral de la Méditerranée. Une vraie sarha, il l’avait dit, ne se conçoit pas sans lâcher prise.Le pire, c’est la frénésie de construction qui s’est emparée de l’Autorité palestinienne. La ville nouvelle de Rawabi tout juste sortie de terre, ouvre une perspective insupportable à Raja Shehadeh.
L’objet fétiche
C’est l’une de ces pierres que Raja Shehadeh aime cueillir sur les sentiers de Palestine, au retour de promenade, quand tombe le crépuscule qui les transforme. A la faveur de la demi-obscurité, l’avocat croit voir sur certaines des formes humaines et les ramène chez lui. Mais là, généralement, violentée par la lumière crue, la magie des ombres s’évanouit et les pierres redeviennent pierres, bonnes à jeter. « Sauf pour l’une d’entre elles, que je garde depuis bien longtemps. Cette pierre grise a la forme d’un visage et une large fente en guise de bouche, ouverte en un cri d’horreur. Avec ce qui a été infligé aux collines, il me semblait approprié de conserver celle-ci ».A lire aussi
Sur la marche, sujet qui a engendré une multitude de livres merveilleux, classiques et contemporains, je me contente de vous conseiller le dernier petit bijou en date, sorti il y a quelques semaines chez Perrin : Une Histoire de la marche, d’Antoine de Baecque, récit à la fois sensible et érudit sur toutes les façons de marcher, du pèlerin au flâneur citadin, en passant par le randonneur et le chasseur lapon. Sur la Palestine, autre sujet qui a fait couler beaucoup d’encre, je me limiterai à deux livres : en miroir des textes de Raja Shehadeh, l’évolution de Ramallah depuis les accords d’Oslo est excellemment décrite par Benjamin Barthe, journaliste au Monde, dans Ramallah Dream, Voyage au cœur du mirage palestinien, paru à La Découverte en 2011. Et, pour une vision plus globale : Israël, Palestine : Vérités sur un conflit, d’Alain Gresh, paru chez Fayard (collection Pluriel) en 2010. Un incontournable. Oh ! et puis, un petit dernier pour la route : le très joli Dictionnaire amoureux de la Palestine, d’Elias Sanbar, chez Plon. Et ne partez surtout pas sans avoir lu ou relu les articles que Books a consacré au sujet, notamment sur le mur et sur une autre vision de la paix possible.Prochain rendez-vous le 12 mai : Embarquement pour un voyage au charme très exotique, du côté de Montreuil-sous-Bois, à la rencontre d’un sacré bout de femme ordinaire-extraordinaire.