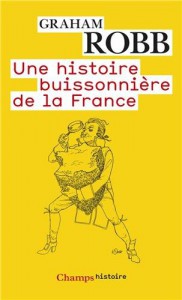La France vue du vélo
Publié le 8 juillet 2015. Par La rédaction de Books.

Le Tour de France oscille entre compétition sportive et ode à « notre beau pays ». Du moins à la télévision, où certaines chaînes se sont fait une spécialité de raconter les chemins, châteaux et villages typiques situés à proximité du passage des coureurs. L’historien britannique Graham Robb ne leur donne pas tort. Cet amoureux de la petite reine a parcouru la France à vélo. Il en a profité pour plonger dans ses archives et redécouvrir l’hexagone – une nation pas vraiment éternelle, qu’il décrit dans Une histoire buissonnière de la France. Cet article de la London Review of Books, traduit par Books en février 2009, donne un aperçu de ses trouvailles.
Comme le souligne Graham Robb, la « découverte » de la France – par ses hommes politiques, ses bureaucrates, ses cartographes, ses statisticiens, ses ingénieurs, ses folkloristes, ses touristes et, jusqu’à une date relativement récente, ses habitants, dans les rares cas où ils s’aventuraient loin de leur clocher – aboutit presque invariablement au troc d’un ensemble d’illusions ou préjugés contre un autre. Auteur de superbes biographies de Balzac, Hugo et Rimbaud, Robb est comme un poisson dans l’eau du XIXe siècle ; mais il ne partage pas la foi aveugle de l’époque dans le progrès, ni la vision parisianiste de ceux qui, tel Baudelaire, s’opposaient aux conventions de leur temps. Par moments, The Discovery of France a donc des allures de jeu intellectuel, où le lecteur se plaît à imaginer le visage qu’aurait eu le pays si Paris n’avait pas existé.
Robb nous présente tout d’abord une France qui, à certains égards, n’a guère changé depuis l’Antiquité romaine. Jusque très avant dans le XIXe siècle, il s’agit moins d’une nation que d’un ensemble de tribus habitant un immense espace apparemment vide et parlant une multitude de langues totalement étrangères les unes aux autres. Bien que les choses aient commencé de bouger, à partir de 1789, l’uniformité n’était encore guère de mise.
L’assassinat d’un géomètre
Le livre s’ouvre sur une de ces scènes saisissantes que nous offre volontiers l’auteur. Dans le village des Estables, près du mont Gerbier-de-Jonc, un jeune géomètre participant à la première tentative de cartographier l’ensemble du territoire est taillé en pièces par les habitants du cru. Nous sommes au début des années 1740 : une monarchie de plus en plus puissante cherche à contrôler le « bric-à-brac des vieux fiefs », mais la population rurale voit dans toute ingérence extérieure une impardonnable intrusion. À l’exception de Paris, il existe peu de villes de quelque importance et la plupart des gens vivent dans des communes isolées. Vus de la capitale, ce sont ces « animaux farouches répandus par la campagne » dont parle La Bruyère (1).
En soulignant à l’envi la diversité française, Robb contrecarre ce préjugé, manifeste dans nombre d’études et de récits de voyage des XVIIIe et XIXe siècles, et qui perdure dans « le racisme fratricide qui joue toujours un rôle majeur dans la société française ». Le pays (de pagus, sorte de canton gallo-romain) a longtemps défini l’identité individuelle et collective : votre pays, c’était le lieu des choses familières, un « domaine oral » délimité par la possibilité d’y entendre le son d’une certaine cloche – selon une étude du XVIIIe siècle, les deux tiers des fiancées vivaient « à portée de voix de leur futur époux ». Vos ennemis traditionnels, c’étaient les bons à rien du village voisin, dûment affublés d’un surnom grossier. Ce type de discrimination, affirme Robb, « était le sang vital de la France tribale ». Rien là de nécessairement sinistre : certains, comme les habitants du hameau perdu de Goust, dans les Pyrénées, ou les colliberts des marais poitevins, tiraient orgueil de leur isolement. Mais Robb consacre aussi des pages fascinantes aux cagots de l’Ouest, objets d’une mystérieuse persécution depuis le XIe siècle, peut-être en raison de leur nomadisme, qui a laissé maintes traces dans les églises et les monuments locaux (2).
En 1790, l’abbé Grégoire fit circuler un questionnaire sur les langues parlées par la population. Les réponses (celles, du moins, qu’il pouvait comprendre) étaient inquiétantes. De nombreuses régions « ignoraient quasiment le français » : deux cent cinquante ans après l’ordonnance de Villers-Cotterêts imposant le dialecte de Paris et de l’Île-de-France comme langue des documents officiels, six millions de citoyens ne parlaient toujours pas la langue nationale (3). Le quatrième chapitre du livre de Graham Robb illustre cette réalité, avec pour titre les différentes manières de dire oui : « O Oc Sí Bai Ya Win Oui Oyi Awè Jo Ja Oua. » Dans son rapport, l’abbé évoquait la nécessité d’« anéantir » le patois mais, quatre-vingt-dix ans plus tard, un cinquième de la population seulement parlait correctement le français. En 1858, c’est en dialecte que la Vierge Marie parla à Bernadette Soubirous. La véritable offensive contre le patois ne vint qu’avec les réformes scolaires de la IIIe République, qui visaient à l’élimination des cultures locales. Comme il arrive souvent, observe Robb, la construction de la nation moderne fut tout le « contraire d’une découverte ».
À ses yeux, le mythe tenace de la France profonde s’est toujours fondé sur une véritable « ignorance du quotidien ». Aussi bien intentionnés et omniprésents soient-ils, les musées de la vie rurale et leurs si pittoresques objets artisanaux ont transformé le passé en brocante. Après s’être plongé dans les récits d’agents du gouvernement, de folkloristes et de voyageurs, Robb tente donc de prendre la mesure des conditions de vie qu’ils déploraient souvent et de comprendre ce sur quoi ils achoppaient généralement. Certains documents, comme les cahiers de doléance rassemblés en 1789, révèlent « la douleur et la pénibilité d’une existence vécue au diapason de la nature » : une tempête de grêle pouvait détruire une récolte en quelques minutes, les hivers froids imposaient une « indolence saisonnière » ou une oisiveté en harmonie avec « les rythmes de la vie ». L’autobiographie d’un paysan breton du nom de Jean-Marie Déguignet, qui « écrivit ses Mémoires parce qu’il n’avait jamais rien lu sur quelqu’un comme lui », évoque la faim, l’incendie, la guerre et un coup de sabot de cheval sur la tête (4). Mais, même là où un voyageur aussi perspicace que l’agronome anglais Arthur Young en aurait conclu que la France rurale avait besoin de planification centralisée, Robb reste particulièrement attentif à la force paradoxale de la fragmentation (5).
Un nombre infini de sentes
Son insistance sur l’« obscure logique du quotidien » fait écho à Michel de Certeau ; comme lui, Robb célèbre cette « mystérieuse activité qu’on appelle le “bricolage” », et évoque joliment les artisanats, les métiers et le travail féminin. Dans un chapitre sur les croyances populaires, il soutient que les églises et les prêtres avaient moins d’importance dans les campagnes que les saints, les légendes, les superstitions et les sites locaux. « Un saint n’était pas un concept théologique ni une représentation artistique. La statue ou la figurine était le saint en personne. » Et les velléités de l’Église de s’approprier les croyances primitives, par exemple en dressant des croix à côté des pierres levées, se heurtaient à bien des résistances. Robb brosse à cet égard quelques tableaux mémorables : cette mère au lait tari qui presse un fromage frais contre son sein, ou ces pèlerins perclus de rhumatismes qui lancent des pelotes de laine sur un saint, à travers une grille, en visant le membre douloureux.
Les envoyés de Napoléon s’étonnaient du nombre infini de pistes et de sentes qu’ils découvraient jusque dans les zones les plus reculées. Des artisans semi-nomades comme les rémouleurs, les travailleurs saisonniers, les glaneurs ou les migrants de toute sorte, à l’instar des ramoneurs savoyards, se déplaçaient « dans ce labyrinthe comme la sève dans l’arbre ». Le colporteur, titubant sous le poids de l’énorme caisse qu’il portait sur le dos, était une silhouette familière et sans nul doute bienvenue avec son trésor d’outils, de boutons, de rubans et de lectures. Grâce au compagnonnage, les apprentis entreprenaient un long tour de France avant de rentrer chez eux. Robb cite les Mémoires d’un tailleur de pierre du Limousin, Martin Nadaud, qui, après avoir parcouru des kilomètres en chantant à tue-tête les rengaines de son pays, arriva à Paris dans un panier d’osier accroché sous une petite diligence, le coucou d’Orléans.
Mais, au XIXe siècle, les desseins du gouvernement central transforment radicalement les campagnes : de nouvelles cartes sont dessinées, de nouvelles routes tracées et le chemin de fer apparaît. La nouvelle bourgeoisie parisienne se prend d’une curiosité passionnée pour ces provinces que la plupart de ses membres viennent tout juste de quitter : au milieu du siècle, le tourisme fait fureur. Pourtant, Robb estime que les perpétuelles redécouvertes, emblématiques de l’ère du Progrès, laissent plus de choses cachées, et souvent inchangées, qu’elles n’en révèlent. À son achèvement, en 1815, l’héroïque aventure cartographique lancée soixante-dix ans plus tôt sous Louis XV et menée par quatre générations de Cassini, répertorie pour la première fois les noms d’un demi-million de hameaux inconnus (trois mille pour le seul Aveyron). En 1792, peu avant son exécution, Louis XVI avait donné sa bénédiction au projet de Delambre et Méchain de tracer le méridien de Paris, entre Dunkerque et Barcelone. L’expédition émailla la campagne de points de triangulation et de postes d’observation. Au-delà d’une utilité pratique souvent douteuse, ces cartes servaient surtout à nourrir l’imagination des citadins. Victor Hugo chérissait ainsi les pages de la carte Cassini en sa possession, trouvant dans ses hachures, ses noms et ses symboles évocateurs une source d’inspiration.
Comme les cartes, l’éclat flambant neuf des routes et des chemins de fer pourrait nous faire croire que les angles morts avaient été éliminés du territoire, et que la vie prenait désormais un autre rythme. À tort. Sous l’Ancien Régime, la corvée tant haïe avait rendu douloureusement inefficace la construction de routes (6). Mais, dans les années 1770, en réduisant les pentes et en créant le métier de cantonnier, les réformes de Trésagnet et Turgot ouvrirent la voie aux grandes routes napoléoniennes, irradiant depuis la capitale. Cependant, on voyageait encore peu, et quand on s’y risquait, l’affaire restait pour le moins inconfortable. Robb cite le manuel de conversation franco-allemand composé par Mme de Genlis (1799) à l’intention des visiteurs, qui témoigne des horreurs du voyage en calèche (« Postillon, je préfère ne pas quitter la grand-route… »). Et nombre de voyageurs préféraient emprunter les canaux ou les fleuves, tel Frédéric Moreau au début de L’Éducation sentimentale. C’était plus confortable mais bien plus lent que la route, et cela pouvait tourner mal : quand Stendhal descendit la Loire, son bateau à vapeur s’échoua sur un banc de sable. Robb nous invite ainsi à oublier la « vision rationalisée de l’ère du Progrès » en nous rappelant que la plupart des gens voyageaient à l’huile de mollet, soit sur le mode ordinaire (il n’était pas rare de faire quatre-vingts kilomètres à pied dans une journée) ou, plus haut en couleur, sur des perches comme dans les marais poitevins, ou sur ces luges propulsées par les jambes qu’on appelle « schlitte » dans les forêts d’Alsace. Les bergers des Landes, nous dit Robb en illustrant son propos d’une photographie inoubliable, «passaient des jours entiers sur leurs échasses, en prenant un bâton pour former un tripode quand ils voulaient se reposer. Perchés à trois mètres de hauteur, ils tricotaient des vêtements de laine et scrutaient l’horizon à la recherche des brebis égarées ».
Dans les derniers chapitres, Robb décrit comment l’ouverture de la France grâce au progrès technique a suscité une soif de connaissance des régions les plus reculées du pays, au moment même où elles reculaient encore. Les merveilles que les touristes réclamaient à cor et à cri étaient à la merci de forces implacables : la pacification militaire, qui avait parsemé la Vendée et d’autres régions d’affreuses villes forteresses; le développement des banlieues, dans le sillage du chemin de fer; la pollution au charbon, qui asphyxiait les campagnes, et non, comme en Angleterre, les métropoles ; la hantise nationale des « terres à l’abandon », qui conduisit à des politiques écologiquement désastreuses de défrichage et de déforestation, au prix de l’érosion des sols ; la spoliation de véritables joyaux nationaux par des ferrailleurs à l’affût des biens ecclésiastiques… « À peine les poètes et amateurs d’art apprenaient-ils l’existence de ce pays magique qu’ils le trouvaient en ruines », écrit Robb. Ce Progrès même qui avait permis de découvrir les provinces les défigurait.
La passion des provinces perdues
Loin de combler l’écart entre la capitale bourgeoise et le monde rural, la modernisation l’entretenait en popularisant l’idée d’arriération pittoresque, çà et là rehaussée d’une note de sublime si l’on savait où chercher (dans les Alpes, par exemple). Grâce au chemin de fer, on pouvait désormais traverser la France en une journée (Paris n’est plus qu’à trente-trois cigares de Marseille, observa un habitué des voyages). La bourgeoisie parisienne venait voir les provinciaux comme des vestiges du passé, bons à photographier (s’ils acceptaient de mettre des costumes qu’ils avaient en réalité cessé de porter) ou à railler en prenant les eaux dans une des stations thermales et balnéaires qui surgirent à la fin du XIXe siècle. Au même moment, le développement de l’anthropologie, en se fondant sur la mesure des crânes, tendait à corroborer l’idée de types supérieurs et inférieurs de Français, les premiers associés au mythique Gaulois (idée recyclée par Pétain, Le Pen et Astérix), les seconds à « des types néandertaliens peuplant la campagne picarde et les côtes bretonnes ».
En 1878, l’Exposition universelle et le tout nouveau musée d’Ethnographie du Trocadéro présentent un pittoresque monde rural « à moitié remémoré, à moitié inventé ». La perte traumatisante de l’Alsace et de la Lorraine, en 1870, avait attisé la passion pour les « provinces perdues ». Et la propagande de la IIIe République exhortait chacun à mieux connaître la France, entreprise d’autopromotion nationale soutenue par des historiens régionaux, de nouvelles institutions comme le Club alpin français et des livres comme Le Tour de France par deux enfants de G. Bruno. Pour leur part, les provinciaux étaient censés exprimer leur patriotisme en parlant français et en conservant leur culture uniquement pour les touristes (injonction qui nourrit une violente nostalgie chez les Bretons, les Basques et les Catalans, dont Paris cherchait à effacer l’identité).
Un pays uni par la bicyclette
Dans bien des cas, il revint aux Parisiens de « découvrir » la région dont les habitants semblaient ignorants. Édouard-Alfred Martel, avocat et spéléologue, donna leurs noms exotiques – le Crocodile, le Chameau, les Yeux du Blaireau, etc. – aux étranges rochers de Montpellier-le-Vieux découverts en 1882 par deux membres du Club alpin. Inspiré par Jules Verne, Martel raconta son exploration de plus de deux cents grottes et rivières souterraines, dont le gouffre de Padirac et, plus spectaculaires encore, les gorges du Verdon : les habitants de la région avaient beau les connaître depuis des siècles, elles ne commencèrent véritablement d’exister que lorsque le spéléologue baptisa leurs merveilles géologiques de noms comme la voûte d’Émeraude ou l’étroit de la Quille.
L’ambivalence de Robb apparaît clairement dans les dernières pages du livre. Il semble osciller entre le sentiment que la véritable diversité de la France n’a jamais été pleinement reconnue (et nous attend toujours si nous sommes prêts, nous aussi, à enfourcher nos vélos) et l’idée que sa vraie nature a été irrévocablement altérée, pour autant qu’elle ait jamais existé. Robb a mené l’essentiel de sa recherche à bicyclette, couvrant plus de vingt mille kilomètres au rythme d’une malle-poste, et il soutient que l’invention de la petite reine, qui a trouvé son apogée dans le Tour de France, a élargi l’horizon des gens ordinaires tout en ramenant le pays à des dimensions gouvernables. Et de lier la teneur nostalgique du Grand Meaulnes, publié en 1913, à « la disparition rapide de la France inexplorée, et au désir de croire qu’elle existait encore ». Le « domaine perdu » qui hante le héros du roman est emblématique de la France profonde en tant que « lieu lointain mais familier ». Cette quête d’une insaisissable France « authentique » a continué de hanter à la fois les autochtones et les visiteurs tout au long du XXe siècle. Les tentatives récentes d’identifier le centre exact du pays (plusieurs villages revendiquent ce titre) et le gigantesque pique-nique du Millénaire qui s’est tenu le 14 juillet 2000 d’un bout à l’autre de la France, le long du méridien délimité par Delambre et Méchain, sont autant de symptômes de cette obsession. À cette maladie, il n’est pas de meilleur remède que quelques jours en selle, avec le livre de Robb à portée de main.
Traduit de l’anglais par Dominique Goy-Blanquet.
Notes
1| Cette phrase est extraite d’un passage des Caractères de La Bruyère : « L’on voit certains animaux farouches, des mâles, et des femelles, répandus par la campagne, noirs, livides, et tout brûlés du soleil, attachés à la terre qu’ils fouillent et qu’ils remuent avec une opiniâtreté invincible. »
2| Les cagots n’étaient pas autorisés à s’asseoir au sein de l’assemblée principale à l’église et se voyaient donner l’hostie du bout d’un bâton. Certaines églises leur réservaient une entrée séparée. Ils n’étaient pas autorisés à marcher pieds nus en public ou à toucher le parapet d’un pont à mains nues.
3| La France comptait alors environ 26 millions d’habitants.
4| Jean-Marie Déguignet, Mémoires d’un paysan bas-breton, Pocket, 2001.
5| Cet agriculteur et agronome britannique est célèbre pour son Voyage en France, paru en 1792, qui fourmille d’informations sur la France rurale.
6| La corvée royale est un impôt mis en place sous Louis XV pour financer la construction et l’entretien des routes (payable parfois en travail, parfois en argent).