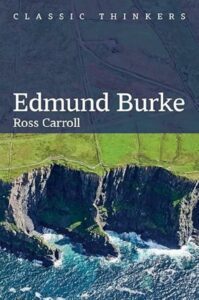Edmund Burke, un conservateur des Lumières
Publié en avril 2025. Par Michel André.
Au motif qu’il a critiqué la Révolution française, il est volontiers présenté comme un réactionnaire. Mais il avait défendu les revendications des colons américains et dénoncé avec virulence les exactions de la Compagnie des Indes. Concernant la France, il avait pressenti la Terreur et annoncé la prise de pouvoir par un militaire.
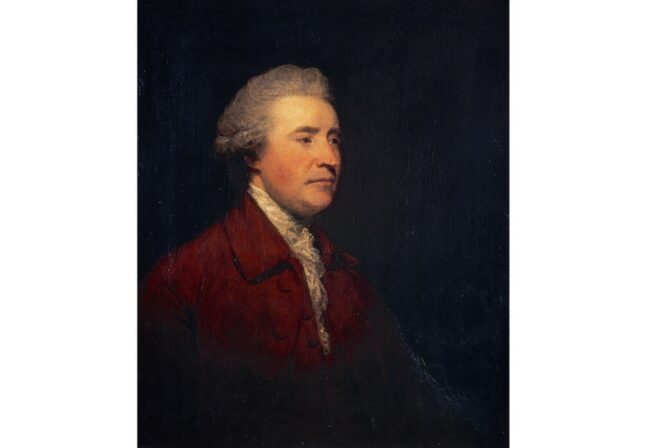
Parce qu’il a impitoyablement critiqué la Révolution française, Edmund Burke est volontiers présenté en France comme un réactionnaire, à l’instar de Louis de Bonald et de Joseph de Maistre. Dans le monde anglo-saxon, après avoir été décrit par certains historiens anglais comme un opportuniste carriériste, il est aujourd’hui célébré comme leur père spirituel par différentes familles de conservateurs. Les libéraux voient en lui un homme pénétré des idéaux des Lumières, à commencer par la défense des libertés publiques et de la liberté de commerce. Ses vues en esthétique, son style flamboyant, l’importance qu’il accorde aux sentiments et son tempérament passionné en font une figure romantique.
Ainsi que l’ont mis en évidence plusieurs ouvrages récents, notamment ceux de Richard Bourke et de David Bromwich, la pensée politique de Burke est impossible à ranger sous une étiquette. Riche, complexe, nuancée, elle n’est pas dépourvue de contradictions, parfois réelles mais souvent seulement apparentes : s’il a combattu la Révolution française après avoir soutenu les revendications des colons américains face à la Couronne britannique, défendu l’Empire tout en dénonçant férocement les exactions et les cruautés de la Compagnie des Indes orientales, loué les vertus de l’aristocratie tout en accusant les aristocrates de médiocrité, d’incompétence et de vénalité, c’est en fonction de principes qui forment un ensemble cohérent.
Comme le souligne Ross Carroll dans le livre qu’il vient de lui consacrer – une remarquable introduction à ses idées, synthétique, claire et pédagogique –, la pensée politique de Burke n’est pas celle d’un pur théoricien. Elle est inséparable de sa personne et de sa trajectoire : « Les idées de certains penseurs politiques peuvent être étudiées sans qu’il soit nécessaire d’en savoir beaucoup sur leur vie, leur personnalité et leur carrière. Burke n’est pas un de ces penseurs. » Une autre de ses caractéristiques, conséquence de la première, est qu’au lieu d’être concentrées dans une poignée de grands livres, ses contributions à la pensée politique sont contenues dans des lettres, des pamphlets, des discours et d’autres textes de circonstance.
L’implication de Burke dans la vie politique active n’en faisait pas un adversaire de la théorie. « Je ne dénigre pas la théorie et la spéculation, précisait-il. Non, lorsque je critique la théorie, c’est toujours une théorie faible, erronée, fausse, non fondée ou imparfaite que j’ai à l’esprit ; et un des moyens de découvrir qu’elle est une fausse théorie, c’est de la comparer avec la pratique. » Sans verser dans le pur pragmatisme, il n’en tenait pas moins pour certain qu’une idée « pouvait être vraie en termes métaphysiques, mais fausse en termes politiques ».
Né en 1729 en Irlande, d’une mère catholique et d’un père protestant mais sans doute catholique converti, Edmund Burke se sentait citoyen britannique. Il n’en resta pas moins sensible toute sa vie au destin de son pays de naissance, qu’il estimait outrageusement exploité par l’Angleterre. Au départ, il fut un homme de lettres. À l’âge de 26 ans, il rédigea un livre d’esthétique philosophique dont les idées sur le « sublime » inspireront plus tard Kant et Swinburne. Avec lucidité, il y relevait la fascination qu’exerce sur nous le spectacle de la douleur physique d’autrui. La même année, il épousait une jeune femme nommée Jane Mary Nugent, qu’il aima toute sa vie et qui lui donna deux enfants : le second mourut en bas âge et le premier de tuberculose à l’âge de 36 ans, un décès précoce qui laissa Burke dévasté, trois ans avant sa propre mort, en 1794.
Peu après son arrivée en Angleterre, il fut engagé comme secrétaire d’un membre du Parlement nommé William Gerard Hamilton. Il resta à son service durant six ans, avant de passer à celui du marquis de Rockingham, alors Premier ministre. La même année, il était élu membre du Parlement au sein du parti whig (libéraux). Il y resta 29 ans. La plus grande partie de sa carrière se passa dans l’opposition. Les partis étaient souvent décriés comme de simples factions. Burke s’en faisait une haute idée. Il les définissait comme des groupes d’hommes « s’unissant pour promouvoir, par leur association, l’intérêt national, en se fondant sur quelques principes sur lesquels ils sont d’accord ». Il se faisait aussi une idée élevée du Parlement et de la nécessité, pour celui-ci, d’exercer toutes ses prérogatives face à l’ambition du roi George III de renforcer le pouvoir de la Couronne. Tout en reconnaissant qu’il était du devoir des parlementaires de défendre les intérêts de leurs électeurs, il contestait la thèse selon laquelle ils devaient se contenter d’obéir fidèlement à leurs volontés. L’idée du suffrage universel lui était étrangère : « Un Parlement élu par un vaste suffrage mais rempli de favoris de la Cour serait moins à même de représenter le peuple qu’un Parlement élu par moins de votants mais composé de membres plus résolument indépendants. »
Tout au long de sa carrière, Burke fut impliqué dans plusieurs grands débats. Le premier portait sur le statut des colonies américaines, qui s’étaient révoltées. Sans être favorable à leur indépendance, il estimait légitime le refus des colons de payer des taxes sans être représentés. Il invita donc à renoncer à l’usage de la force face aux insurgés et plaida vigoureusement en faveur de la réconciliation. La seconde controverse, dans laquelle il s’engagea avec une ardeur toute particulière, concernait l’action de la Compagnie des Indes orientales en Inde. Burke ne mettait pas en cause l’existence de l’Empire, qu’il considérait comme bénéficiant à toutes les parties. Les conquêtes étaient à ses yeux un fait obligé de l’Histoire qu’il ne fallait pas chercher à empêcher. Mais il était nécessaire de veiller à ce qu’elles s’opèrent avec un minimum de violence et que l’exploitation des territoires conquis se fasse dans le respect des populations locales. La conquête des îles britanniques par les troupes romaines lui semblait à cet égard le modèle à suivre, celle de l’Irlande et des Indes par la Couronne anglaise le parfait contre-exemple.
Burke était révolté par les agissements de la Compagnie des Indes orientales qui, usurpant les prérogatives d’un État, se comportait en maître absolu des territoires qu’elle contrôlait et s’y livrait impunément à de terribles pillages. Dans le discours qu’il prononça à l’occasion de la procédure de destitution d’un des plus cruels directeurs qu’ait eu la Compagnie, Warren Hastings (démis par la Chambre des communes, il fut rétabli dans ses fonctions par la Chambre des lords), décrivant les exactions de la Compagnie dans une région de l’Inde, il se déchaîne : « Une tempête de feu enflamma tous les champs, consuma toutes les maisons, détruisit tous les temples. Les misérables habitants, fuyant leur village en flammes, furent massacrés ; d’autres, […] les pères séparés de leurs enfants, les maris de leur épouse […] furent envoyés en captivité dans un pays inconnu et hostile. »
L’attitude de Burke à l’égard de l’esclavage a évolué avec le temps. Au départ fervent défenseur de la Compagnie royale africaine qui en organisait le trafic, à partir de 1780 il commença à militer pour la réforme de ce commerce dans le sens d’un adoucissement. Tout en réprouvant l’esclavage, il craignait les effets pervers d’une émancipation brutale et ne fut jamais abolitioniste. Convaincu que l’institution subsisterait sous une forme ou une autre dans les colonies britanniques, fait observer Carroll, il considérait l’allègement de ses pires aspects comme la seule option possible : « Comme toujours chez Burke, la vision abstraite de ce qu’exige la justice ne devait pas être le seul déterminant de la politique. Confronté à ce qu’il considérait comme “un mal incurable”, il cherchait à en atténuer les effets plutôt qu’à l’éradiquer. »
Le troisième grand débat auquel Burke s’est trouvé mêlé est celui qui a suivi, en Angleterre, la Révolution française. Il eut pour conséquence son départ du parti whig, dont beaucoup de membres s’étaient exprimés en faveur de la Révolution, et est à l’origine de son livre le plus connu : Réflexions sur la Révolution de France. L’ouvrage fut publié avant l’épisode de la Terreur. Burke y dénonçait par avance les terribles violences contre les biens et les personnes auxquelles, selon lui, la Révolution ne pouvait manquer de conduire. Avec une étonnante prescience, il envisageait le surgissement, au sein du chaos engendré par l’affrontement général, d’un leader militaire déterminé à rétablir l’ordre. Son hostilité tenait aussi à des raisons philosophiques. Burke ne contestait pas par principe l’idée de l’existence de droits fondamentaux. Mais à ses yeux, observe Carroll, « un gouvernement s’engageant à respecter les droits n’était pas la même chose qu’un gouvernement faisant de la protection des droits sa raison d’être ».
Sa conception de la liberté était également différente de celle des théoriciens de la Révolution. La liberté que défendait Burke n’était pas, selon ses propres termes, « la liberté égoïste de chaque homme de régler la totalité de sa conduite en fonction de sa volonté propre ». Dans son esprit, la vraie liberté ne pouvait se réaliser que dans et par la participation à la vie sociale, une conviction qu’il partageait, d’une certaine manière, avec les révolutionnaires. Contrairement à ces derniers, toutefois, il n’identifiait pas cette liberté avec la possibilité pour le peuple de s’auto-gouverner. Et il ne la définissait pas en termes intemporels. À ses yeux, résume Carroll, les libertés ne sont pas l’expression d’un principe abstrait, mais « des privilèges et des droits […] intégrés dans un ordre social particulier qui a persisté durant des siècles ». Cette idée s’enracine dans une de ses convictions les plus profondes : la société n’est pas le produit d’un contrat entre les vivants, mais celui d’un « partenariat entre les vivants, les morts et ceux qui ne sont pas encore nés ». Cette formule, souvent citée par le philosophe britannique Roger Scruton et tous ceux que terrifie l’idée d’un recommencement indéfini de la société sur la base d’une table rase, reflète fidèlement la nature du conservatisme de Burke et la manière dont, chez lui, conservation, transmission et progrès sont indissociables.
Ross Carroll ne manque pas de souligner ses exceptionnels qualités d’orateur. On cite souvent à son sujet un propos du fameux érudit et essayiste Samuel Johnson rapporté par son biographe James Boswell : « Si quelqu’un se trouvait par hasard obligé de passer cinq minutes en compagnie de Burke sous un abri pour éviter la pluie, il se dirait : voilà un homme extraordinaire. » Johnson, qui ne partageait qu’en partie les idées de Burke, faisait ici référence à sa conversation, invariablement brillante et intarissable. Il était de fait un homme du verbe, et ses idées, plus encore que chez n’importe qui d’autre, étaient inséparables de leur expression. « Le talent littéraire de Burke, écrivait l’essayiste William Hazlitt, est [...] sa principale qualité. Son style a la familiarité de la conversation et le caractère recherché des compositions les plus élaborées. […] Il utilise les mots les plus ordinaires comme les termes les plus scientifiques, les phrases les plus longues comme les plus courtes, les tournures les plus directes comme les plus imagées. »
Mary Wollstonecraft, aussi critique que le républicain Thomas Paine au sujet des vues de Burke sur la Révolution française, l’a un jour ironiquement traité de « nouveau Cicéron », l’accusant d’user de ses dons de rhéteur pour défendre les aristocrates. Cette comparaison n’était pas de nature à déplaire à un homme qui, de longue date, considérait le grand orateur romain comme son modèle. Comme lui, Burke entendait mettre ses talents de débatteur au service des nobles causes qu’il estimait devoir défendre. Ce que nous appelons la démocratie, le gouvernement de tous par tous, ne figurait à l’évidence pas au nombre de celles-ci, et il lui est arrivé de justifier des situations que nous trouvons aujourd’hui inacceptables sur la base d’idées contestables ou erronées, par exemple au sujet du rôle possible du gouvernement en cas de famines. Mais l’une des causes pour lesquelles il s’est battu avec le plus d’opiniâtreté est la lutte contre les abus de pouvoir des gouvernements et des puissants, et les injustices qu’ils engendrent. Dans la Lettre à un noble lord dans laquelle, à la fin de sa vie, pour se défendre des attaques du duc de Bedford, il fait le bilan de sa carrière parlementaire, Burke présente les efforts qu’il a menés durant quatorze ans pour mettre fin aux abus de la Compagnie des Indes orientales comme l’entreprise dont il est le plus fier, même si c’est celle dans laquelle il a eu le moins de succès.