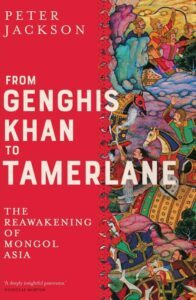Gengis Khan et Tamerlan, même combat
Publié en avril 2025. Par Books.
À eux deux, ils ont conquis puis partiellement reconquis, en l’espace de trois générations, « le plus vaste empire terrestre qui ait jamais existé ». Le grand aîné, Gengis Khan, a commencé en fédérant les clans batailleurs de la fruste tribu mongole. Issu d’un sous-clan inférieur dans une société obsédée de généalogie, il avait pourtant démarré très bas. Mais après une jeunesse plus que problématique (avec même des périodes d’esclavage), il avait peu à peu rassemblé des alliés, organisé l’armée sur des bases méritocratiques, connu quelques défaites et beaucoup de victoires. Vainqueur, il agrégeait les troupes battues et continuait d’avancer – allant jusqu’à la mer Caspienne et à la Volga, ainsi qu’en Sibérie et en Chine jusqu’à Pékin. Ses conquêtes, fondées sur la terreur mais aussi sur une certaine miséricorde envers les vaincus, servaient à permettre d’autres conquêtes. Et quand il mourut en 1227, dans des circonstances mystérieuses (peut-être lors du viol d’une reine capturée qui avait introduit une lame dans son vagin !), il laissait un État en bonne et due forme : des successeurs choisis (en assemblée) parmi ses fils, des infrastructures commerciales et routières, un système administratif centralisé et une sorte de code juridique et moral, le Yassa, très novateur économiquement, socialement, religieusement (tolérance intégrale) et même écologiquement (chasse interdite en période de reproduction). Ses conquêtes avaient par ailleurs eu l’effet bénéfique d’abattre les frontières entre les peuples domptés, donc de fluidifier les mouvements de marchandises, de technologies et d’idées. Pourtant, malgré l’instauration graduelle de la fameuse Pax Mongolica, un siècle plus tard l’empire mongol tombait déjà en pleine déréliction.
Surgit alors, vers 1370, Timour Leng (Timour le Boiteux alias Tamerlan), un Gengis Khan bis, qui allait reconquérir une bonne partie des territoires soumis par son lointain précurseur et prolonger l’empire vers la Russie, le Moyen-Orient (Damas et Bagdad) et le Pendjab. On associe volontiers ces deux conquérants, pourtant bien différents, explique le médiéviste anglais Peter Jackson avec force détails (720 pages dont 267 de notes !). Le premier était un dévot chamaniste, un nomade qui de sa vie n’avait pénétré qu’une seule fois dans une ville (Boukhara), et qui n’avait laissé aucune trace matérielle de lui, même pas une tombe. En revanche, le second, issu d’encore plus bas (c’était un voleur de bétail), était un musulman qui massacra ses coreligionnaires par dizaines de milliers. Ses conquêtes, surtout motivées par le butin, étaient assorties d’actes de cruauté extrême. Il décapite peut-être 100 000 habitants de Delhi ; en Turquie, pour respecter une promesse de ne pas verser le sang des défenseurs de la ville de Sivas, il les enterre tous vivants. Il délaissait les régions pillées, quitte à repasser quelques années plus tard. Aussi, « tandis que l’empire mongol parvint à continuer à grandir pendant deux générations après la mort de Gengis Khan, celui de Timour s’est aussitôt fragmenté après la sienne, en 1405, comme un feu de paille inconcevablement brutal et mortel », écrit Peter Gordon dans la Asian Review of Books. Si Gengis Khan « bâtissait avec des nations », Tamerlan le faisait avec des blocs de pierre, notamment à Samarcande, chef-d’œuvre qui lui survit encore. Hélas, en Occident son image reste celle d’un destructeur si cruel qu’elle a valu au terme « mongol » une connotation fort péjorative. En Asie en revanche, les deux ravageurs sont quasiment déifiés.