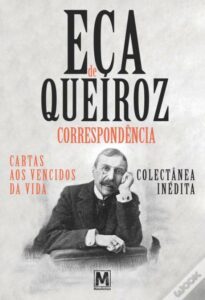Un « vaincu de la vie »
Publié en janvier 2025. Par Michel André.
Le Flaubert de la littérature portugaise appartenait au petit groupe des « Vaincus de la vie », un cénacle qui se réunissait dans les cafés de Lisbonne vers la fin des années 1880. Ses lettres révèlent une personnalité riche et tourmentée.

Vers la fin des années 1880, onze intellectuels se réunissaient régulièrement à Lisbonne, au Café Tavares et à l’Hôtel Bragança, pour des déjeuners et des discussions sur les sujets les plus variés. Le groupe s’était baptisé « Les Vaincus de la vie » en référence à l’abandon des idéaux révolutionnaires de leur jeunesse. Scientifiques, universitaires, diplomates et politiciens déçus par l’échec des tentatives de modernisation de la société portugaise et de démocratisation du système politique, ils s’étaient réfugiés dans une sorte de dilettantisme ironique et dandy. Cela ne les empêchait pas de continuer à rêver d’une renaissance possible du pays sous l’égide du monarque constitutionnel Carlos Ier. « Les Vaincus de la vie, observait un contemporain, ne constituent ni un club, ni une académie, ni un cénacle, ni un parti, ni un ordre […]. Comme tout ce qui existe naturellement, ils se sont retrouvés réunis par un phénomène d’attraction mutuelle, d’agrégation spontanée des esprits. »
Au cœur de ce groupe était le romancier Eça de Queiroz. Il figure au panthéon de la littérature portugaise aux côtés des poètes Camões et Fernando Pessoa. Il a souvent été comparé à Flaubert, Maupassant et Zola. Son chef-d’œuvre, Les Maia, est à la fois l’histoire d’une famille et un tableau désenchanté de la haute société de Lisbonne, qu’il dépeint comme décadente. À l’instar de son aîné de quelques années, le prolifique Camilo Castelo Branco, il fut également un brillant essayiste et chroniqueur.
À la suite d’une volumineuse édition de sa correspondance parue en 2008, un choix de ses lettres aux membres du groupe des « Vaincus » vient d’être publié. Parmi les plus riches et personnelles figurent celles qu’il envoya à l’homme de lettres Ramalho Ortigão, qu’il connaissait de longue date et qui fut son meilleur ami. On y suit le déroulement d’une grande partie de sa vie, prématurément interrompue par sa mort précoce à l’âge de 54 ans, en 1900.
José Maria de Eça de Queiroz est né dans un petit village du nord du Portugal. Il était un enfant illégitime. Abandonné par sa mère, il fut élevé par une nourrice, puis par ses grands-parents paternels. Durant ses années de collège dans un internat catholique très dur, il passait ses vacances chez une tante. Plus tard, après que ses parents se furent mariés et qu’il eut terminé ses études, il habita chez eux à Lisbonne et fut officiellement reconnu à l’occasion de son propre mariage. Avoir grandi en l’absence de sa mère et sans environnement affectif stable semble l’avoir durablement marqué. Dans son œuvre s’exprime une vision pessimiste des relations familiales. Inceste, adultère, trahisons, tromperies, amours sans lendemain ou vénales : l’image des rapports humains qui ressort de ses romans est sombre.
Comme son père, qui était fonctionnaire, Eça fit des études de droit à l’université de Coimbra. Il y fit la connaissance du poète Antero de Quental, un peu plus âgé que lui, personnalité non-conformiste grâce à qui il découvrit la pensée de Proudhon et qui encouragea chez lui l’attitude rebelle et les idées révolutionnaires qu’il partageait avec les étudiants de sa génération. Il participa aussi aux activités d’une troupe de théâtre universitaire. Son goût et son talent pour l’art dramatique, qui firent de lui toute sa vie un brillant causeur, s’exprimeront plus tard dans les dialogues très vivants de ses romans. Une fois diplômé, il s’installa brièvement à Évora pour y diriger un journal d’opposition dont il rédigeait lui-même une bonne partie. Une expérience éphémère du métier d’avocat dans cette ville ne lui laissa qu’une aversion profonde pour les tribunaux et les juristes.
En 1869, à l’occasion de l’inauguration du canal de Suez, il effectua un voyage de deux mois en Égypte et au Moyen-Orient en compagnie d’un aristocrate qui allait devenir plus tard son beau-frère. Son premier roman, Le Crime du Padre Amaro, lui fut largement inspiré par son séjour dans la ville de Leiria où il fut nommé sous-préfet un an plus tard.
C’est le récit des amours tragiques d’un jeune prêtre et de la fille de sa logeuse, qu’il désirait et qui tombe amoureuse de lui. L’histoire finit mal : l’enfant né de cette aventure meurt, la jeune femme aussi, et le prêtre poursuit sa carrière sans dommage à Lisbonne. Lorsqu’il fut publié cinq ans plus tard, ce roman, où s’exprime un anticléricalisme qu’Eça professa toute sa vie, fut loué pour son réalisme.
À ce moment, il venait d’entamer sa carrière consulaire. Son premier poste fut Cuba. Plusieurs des rapports envoyés à son ministre portent sur les conditions de travail épouvantables faites sur l’île aux coolies chinois venus de Macao, alors colonie portugaise. Il écrit à Ramalho Ortigão : « J’ai quitté mon atmosphère, et je vis dans l’inquiétude, dans un air qui n’est pas le mien. En outre, je suis loin de l’Europe, et vous savez à quel point nous sommes européens. Vous et moi. »
Le même état d’esprit se retrouve dans les lettres envoyées plus tard de Newcastle, où il fut ensuite nommé. Ici aussi, sa correspondance officielle, largement consacrée à une grève des mineurs, est dominée par des préoccupations sociales. Elles lui feront écrire dans les Lettres d’Angleterre : « C’est bien joli de parler de l’ordre, du respect de la propriété, du sentiment d’obéissance à la loi, etc., mais, quand des milliers d’hommes voient leurs familles sans feu dans l’âtre, sans un morceau de pain, leurs enfants mourir de misère […], il est difficile d’aller expliquer à ces malheureux les règles de l’économie politique. » De Newcastle, il écrit à Ramalho Ortigão : « Je me suis convaincu qu’un artiste ne peut travailler loin du milieu où il puise sa matière artistique : Balzac […] n’aurait pas pu écrire La Comédie humaine à Manchester, et Zola n’aurait pas réussi à faire une ligne des Rougon à Cardiff. Je ne peux dépeindre le Portugal à Newcastle. »
Ces références à de grands écrivains français ne sont pas fortuites. Eça de Queiroz, qui, après un passage par Bristol, terminera sa carrière comme consul à Paris en 1888, était fasciné par la France et la littérature française. Flaubert était pour lui le modèle absolu. En 1884, il confiait à un autre des « Vaincus de la vie », l’historien et homme politique Oliveira Martins : « Mes romans, dans le fond, sont français, comme je suis moi-même, en presque tout, un Français, à l’exception d’un fond sincère de tristesse lyrique, qui est une caractéristique portugaise, un goût dépravé pour le fado et un juste amour de la morue à l’oignon. »
Cet amour pour la France, qui s’atténua lors de l’affaire Dreyfus (il fut un dreyfusard fervent), ne l’empêchera pas de dénoncer dans un texte célèbre intitulé « L’obsession française » la dévotion servile des Portugais à l’égard de ce pays : « Nous imitons ou faisons semblant d’imiter en tout la France, depuis l’esprit de nos lois jusqu’à la forme de nos chaussures ; à un tel point que pour un œil étranger, notre civilisation, surtout à Lisbonne, a l’air d’être arrivée la veille de Bordeaux, dans des caisses par le paquebot des Messageries. »
Arrivé à la quarantaine, il éprouva le besoin de stabiliser sa vie sentimentale. À Ramalho Ortigão, il déclare en toute franchise : « J’aurais besoin d’une femme sereine, intelligente, ayant de la fortune (pas trop), au caractère ferme, derrière un caractère doux, qui m’adopterait comme on adopte un enfant ; qui paierait le gros de mes dettes, m’obligerait à me lever à des heures chrétiennes […], qui me nourrirait avec hygiène et simplicité, qui m’imposerait un travail diurne salutaire, et quand je me mettrais à demander la lune en pleurant, me la promettrait, jusqu’à ce que je n’y pense plus. »
Parce que sa femme était noble, on a suggéré qu’il s’agissait d’un mariage de convenance. Mais les lettres qu’il lui envoyait témoignent d’une réelle affection. Il y est toutefois régulièrement question d’argent. La relative fortune de sa femme ne consistait qu’en terres, et son salaire de consul ne suffisait pas pour couvrir les dépenses quotidiennes de la famille. Vivant au-dessus de ses moyens, il fut confronté tout au long de son existence à des difficultés financières. Elles le contraignirent à demander de l’aide à ses amis, parfois en termes extrêmement pressants. Il ne cessa par ailleurs de souffrir de sérieux problèmes de santé, digestifs et nerveux, auxquels il ne faisait que rarement allusion dans sa correspondance.
Il fut aussi impliqué dans des polémiques désagréables. Un de ses adversaires de toujours fut un de ses confrères nomméManuel Pinheiro Chagas, qui l’attaqua notamment au sujet des Maia, l’accusant d’avoir caricaturé sous le nom de Tomás de Alencar, un des principaux personnages, le poète Bulhão Pato. Dans une lettre à un autre des « Vaincus de la vie », Eça proteste de sa bonne foi : « Pour faire le portrait d’un homme […], il faut au moins le connaître. Connaître sa physionomie extérieure et intérieure – ses idées, ses habitudes, ses goûts, ses sentiments, ses manies, ses intérêts, tous les traits variés qui constituent un caractère. Est-ce que je connais de cette manière intime M. Bulhão Pato ? Non – ni intimement, ni superficiellement. »
Il était perfectionniste et corrigeait abondamment ses romans sur épreuves, au désespoir de ses éditeurs, dont les principaux furent des Français établis à Porto (sa correspondance avec eux est en français). Sa tendance à l’autocritique était très forte. À Ramalho Ortigão, il présentait Le Cousin Bazilio, une sorte de Madame Bovary en plus noir encore, comme « une œuvre insincère, ridicule, affectée, difforme, larmoyante ». Les Maia, lui disait-il aussi, est un roman « vague, diffus, [...] sec […], une sorte d’exercice pratique pour faire mieux plus tard ».
Après ce dernier livre, tout en s’efforçant sans succès de mettre en œuvre des projets de revue, il ne fit plus paraître que des chroniques dans la presse. Elles furent réunies et publiées après sa mort. Son abondante œuvre posthume comprend des recueils d’essais et d’articles, des contes et nouvelles considérées par certains comme ce qu’il a écrit de mieux, ainsi que plusieurs romans qu’il avait conservés à l’état de manuscrits parce qu’il n’en était pas satisfait ou qu’ils étaient inachevés. Un de ceux-ci fut complété par Ramalho Ortigão. Celui-ci, qui lui survécut quinze ans, finit par se rallier avec enthousiasme à la cause de l’intégralisme lusitanien, mouvement traditionnaliste, monarchique et antiparlementaire opposé à la fois au libéralisme et à l’autoritarisme de l’État nouveau. On peut se demander ce qu’Eça de Queiroz aurait pensé de l’évolution de son plus grand ami.