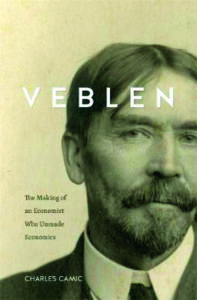Un économiste bien peu orthodoxe
Publié dans le magazine Books n° 115, septembre-octobre 2021. Par Michel André.
Né dans une famille norvégienne ayant émigré aux États-Unis au milieu du XIXe siècle, l’auteur de Théorie de la classe de loisir fait toujours figure d’iconoclaste. Critique acide de la grande bourgeoisie d’affaires américaine, Thorstein Veblen émettait de sérieux doutes sur le bien-fondé de la théorie économique « néoclassique ». Il plaidait pour ancrer sa discipline dans les réalités de l’Histoire, de la sociologie et de la psychologie.

En raison de sa personnalité excentrique, l’économiste Thorstein Veblen a longtemps souffert d’une réputation de marginal largement injustifiée.
Les auteurs d’un guide de lecture pour le grand public demandèrent un jour à l’économiste américano-canadien John Kenneth Galbraith quels étaient à son avis les trois livres les plus importants dans sa discipline. Énumérant les titres par ordre chronologique, il répondit : La Richesse des nations, d’Adam Smith, Théorie de la classe de loisir, de Thorstein Veblen, et Théorie générale de l’emploi, de l’intérêt et de la monnaie, de John Maynard Keynes. La plupart de ses confrères auraient certainement mentionné les premier et troisième livres, considérés comme fondateurs de la science économique. Très peu d’entre eux auraient fait référence à celui de Veblen1. Lors de sa parution, en 1899, cet ouvrage, qui demeure de loin son œuvre la plus connue, a été accueilli et salué, par exemple par l’écrivain William Dean Howells, non comme un traité d’économie, mais comme un livre de critique sociale de nature littéraire offrant, sur un ton satirique et polémique, un portrait cruel et drôle de la haute bourgeoisie américaine, un peu dans l’esprit des romans de Henry James et d’Edith Wharton. Veblen, il est vrai, n’a jamais conféré à ses idées la forme de théories rigoureuses susceptibles d’être testées. L’utilisation qu’il fait des données empiriques n’est ni quantitative ni systématique. Ses observations peuvent sembler impressionnistes et anecdotiques. Et les thèses qu’il défend s’appuient sur des considérations historiques, anthropologiques et philosophiques étrangères à la pensée économique sous sa forme courante.
En raison de sa personnalité excentrique, de ses propos volontiers iconoclastes et de son parcours professionnel chaotique, Veblen a de surcroît longtemps souffert d’une réputation de marginal. On sait aujourd’hui qu’elle n’est pas justifiée et résulte largement de la mise en circulation par Joseph Dorfman, auteur d’une première biographie qui a longtemps fait autorité2, d’une série d’hypothèses et d’anecdotes dépourvues de fondement, qui ont été répétées. L’image de Veblen qui a longtemps prévalu est celle d’un homme « venu de Mars », pour reprendre l’expression d’un de ses étudiants, resté toute sa vie, en raison de l’origine norvégienne de sa famille, coupé d’une société américaine envers laquelle il aurait en conséquence développé une attitude critique et hostile. Certes, comme le soulignait il y a vingt ans Stephen Edgell3, la culture nordique dans laquelle Veblen a été élevé a contribué à façonner sa vision du monde et son système de valeurs, fondés sur le goût de la connaissance utile, le sens de l’intérêt général, le culte de l’effort et le mépris pour l’argent gagné autrement que par le travail. Elle ne l’a toutefois nullement empêché de s’intégrer dans la société de son temps : contrairement à ce qui a souvent été soutenu, par exemple, il maîtrisait l’anglais depuis l’enfance. Dans l’ouvrage qu’il vient de lui consacrer, Charles Camic montre de même combien, loin d’avoir réfléchi en marge du monde savant, il était un pur produit du système universitaire.
Né en 1857 dans le Wisconsin, au sein d’une famille d’immigrants norvégiens, Thorstein Veblen a grandi dans le Minnesota. Son père était un homme entreprenant et énergique, à la fois lettré et adroit charpentier, sa mère une personne à l’esprit alerte et pleine de ressources. Bientôt, ils se trouvèrent à la tête d’une des plus riches exploitations agricoles de l’État. Sous le toit de la ferme, relève Camic, chacun « travaillait au bénéfice de la famille conçue comme une collectivité », aux antipodes du modèle individualiste anglo-saxon. Contrairement à beaucoup de pionniers, les Veblen envoyèrent leurs enfants à l’école. Plusieurs d’entre eux, dont Thorstein, poursuivirent leur éducation à la petite université voisine de Carleton. Sa formation intellectuelle s’est achevée au sein de plusieurs des premières grandes universités de recherche américaines [lire « Pourquoi les universités américaines sont les meilleures », Books n° 111, octobre 2020]. Dans un premier temps, il entreprit des études de philosophie à l’université Johns-Hopkins, qu’il termina à Yale, où il obtint un doctorat. Parce qu’il ne parvenait pas à trouver de poste d’enseignement – notamment en raison de son agnosticisme affiché, position peu courante à l’époque –, il passa ensuite sept années dans la ferme familiale, lisant voracement. En 1891, il entra à l’université Cornell pour étudier l’économie. Il y impressionna suffisamment J. Laurence Laughlin pour que celui-ci, lorsqu’il fut nommé chef du département d’économie de l’Université de Chicago, qui venait d’être créée, lui propose de le suivre. Veblen y enseigna jusqu’en 1906.
Les idées de Veblen se sont forgées sous l’influence de plusieurs grands courants de pensée très présents dans l’univers intellectuel de son temps : la philosophie et l’école historique d’économie allemandes, la pensée évolutionniste anglaise (Charles Darwin et Herbert Spencer) et le pragmatisme américain (William James, John Dewey, Charles Sanders Peirce). Veblen fut aussi très marqué par les travaux ethnologiques de Franz Boas et les œuvres du romancier et activiste socialiste Edward Bellamy4. Charles Camic souligne le rôle joué dans sa formation par deux de ses mentors, dont il combattit pourtant plus tard les théories : John Bates Clark, son professeur à Carleton, en raison de son insistance sur la nécessité de fonder l’économie sur la recherche anthropologique, et J. Laurence Laughlin, parce qu’il défendait une approche historique de l’économie et, tout en exprimant fortement ses convictions, encourageait ses étudiants à penser par eux-mêmes.
Fruit d’années de lectures et de réflexion, publié au milieu de son séjour à Chicago, Théorie de la classe de loisir contient, sous une forme déjà aboutie ou en germe, l’essentiel de la pensée économique et sociologique de Veblen. Le livre décrit et analyse la société américaine à la charnière du XIXe et du XXe siècle : un pays rural peuplé de pionniers en train de se transformer en une grande puissance industrielle et technique. L’attention de Veblen se concentre sur la classe sociale émergeant à la faveur de cette mutation : la grande bourgeoisie d’affaires et d’argent, au sommet de laquelle trônent les fameux et tout-puissants « barons voleurs » – Andrew Carnegie (acier), Jay Gould et Cornelius Vanderbilt (chemins de fer), John D. Rockefeller (pétrole), Andrew Mellon et J. P. Morgan (finance). Cette classe de nouveaux riches, en laquelle il voit l’équivalent moderne des classes parasites des sociétés anciennes, les aristocrates, les militaires et les prêtres, Veblen l’appelle « classe de loisir » ou « classe oisive », ce qui ne veut pas dire inoccupée : loin de rester sans rien faire, ses représentants sont souvent très occupés, mais à des activités explicitement déconnectées de tout souci de subsistance. Il porte un regard acéré sur leurs mœurs et leurs habitudes, témoignant d’un réel talent d’observation que Jean-François Revel n’hésitait pas à comparer à celui de Marcel Proust et d’un détachement froidement ironique qui le situe, relève Raymond Aron, « quelque part entre les romanciers de la comédie humaine et les sociologues et ethnologues qui ne se lassent pas de chercher la valeur symbolique des gestes, des paroles, des mimiques, des coutumes, des coiffures ».
Au cœur de son analyse figurent le concept de « consommation ostentatoire » et ses dérivés (« gaspillage ostentatoire », « loisir ostentatoire ») : pour bien marquer leur statut social ou donner l’illusion qu’ils jouissent d’un certain prestige, ceux qui s’adonnent à ce type de consommation s’attachent à acquérir des biens inutiles mais de prix élevé. Passée dans le vocabulaire sociologique et le langage courant, l’idée a été incorporée dans la théorie économique sous la forme de « l’effet Veblen » : dans le cas des biens de prestige achetés à des fins de distinction, la demande est une fonction croissante, et non décroissante, du prix (plus le bien est cher, plus il est convoité). Aux yeux de Veblen, une des fonctions de la consommation de biens dispendieux est de démontrer à quel point celui qui s’y livre est affranchi de la nécessité de travailler. C’est visible par exemple dans le cas du vêtement, féminin mais aussi masculin : « Pour l’essentiel, le charme des souliers vernis, du linge immaculé, du chapeau cylindrique et luisant, de la canne […] provient de la pensée qu’ils font naître : il est impossible que ce monsieur mette les mains à aucune pâte et se rende, directement ou indirectement, utile aux autres hommes. » On a contesté que ce mécanisme ait une portée générale. Le luxe « ordinaire », celui d’un bain chaud, par exemple, n’est-il pas avant tout apprécié pour lui-même et l’agrément qu’il procure ? C’est l’exemple que donnait le journaliste de Baltimore H. L. Mencken dans un texte très critique à l’égard de Veblen où il exerçait sa verve sarcastique à ses dépens, l’accusant de ne proférer que des contrevérités patentes ou des platitudes dans un langage savant, d’avancer des explications tirées par les cheveux ou absurdes (ce qui lui arrive quelquefois) et de dire en plusieurs pages « ce qui pourrait tenir sur un timbre-poste ».
On trouve dans Théorie de la classe de loisir tous les éléments de la pensée économique de Veblen telle qu’il la développera dans ses ouvrages ultérieurs, principalement dans Théorie de l’entreprise d’affaires5, également publié lorsqu’il était à Chicago. Cette pensée s’appuie sur un schéma évolutionniste qui fait se succéder quatre grandes périodes dans l’histoire de l’humanité : l’état sauvage, l’état barbare, l’état artisan et celui du machinisme, dans lequel nous vivons. Ce dernier est caractérisé par le triomphe de la technique et la dissociation de deux mondes qui étaient fusionnés à l’ère artisanale : le monde de l’industrie et celui des affaires, dont l’opposition est au cœur de sa théorie. Comme Marx, Veblen critique le fonctionnement de l’économie capitaliste, qu’il considère être au service des riches, par l’intermédiaire toutefois d’un autre mécanisme que le prélèvement de la plus-value sur le travail des prolétaires que postulait le penseur allemand : la manipulation, par les grands propriétaires, des prix et de la production à des fins de spéculation.
Cette critique est indissociable de celle que Veblen adresse à la théorie économique de son temps, qu’il accuse de reposer sur une série de préconceptions : le modèle de l’Homo œconomicus rationnel guidé par le seul souci de maximiser son bien-être, l’idée d’un marché nécessairement en équilibre affectant les ressources de manière optimale, etc. Sous le terme de « théorie néoclassique », entré à présent dans le langage économique, Veblen désignait l’intégration, dans l’économie classique d’Adam Smith et de David Ricardo, de la théorie de l’utilité marginale que venaient de formuler indépendamment les uns des autres William Jevons, Carl Menger et Léon Walras. Selon cette théorie, la satisfaction tirée de la consommation d’un bien est liée à son utilité marginale, c’est-à-dire à l’utilité ou au plaisir qu’apporte la possession d’une unité supplémentaire de ce bien. La transposition de cette idée à la production opérée par John Bates Clark, l’ancien professeur de Veblen à Carleton, conduit à la thèse que, dans le processus de production, chacun des deux facteurs, le travail et le capital, est rétribué en fonction de sa productivité marginale : le salaire de l’ouvrier est justifié, tout comme le profit du propriétaire, deux idées que Veblen ne pouvait accepter.
Sur le plan théorique, Veblen suggérait de substituer à la psychologie abstraite de l’économie néoclassique un modèle plus riche, prenant en compte ces habitudes mentales dotées d’existence sociale qu’il appelait des « institutions », et incorporant le constat que « l’homme n’est pas un paquet de désirs […] mais un ensemble cohérent de propensions et d’habitudes [produit] par l’hérédité et l’expérience, façonné par un corps de traditions, de conventions et de circonstances matérielles.». Ses recommandations en matière politique et pratique étaient plus vagues. Pour l’essentiel, elles consistaient à encourager le déplacement du pouvoir économique, du monde de la « propriété absente » et de la gestion vers celui de l’entreprise et de la production, par le truchement, envisageait-il à la fin de sa vie, de la création de « soviets d’ingénieurs », mieux à même que les financiers de prendre les bonnes décisions dans l’intérêt général.
Veblen était un professeur médiocre, qui grommelait à voix basse, ne retenait l’attention que de quelques étudiants passionnés par ses exposés et attribuait les notes de manière peu orthodoxe. Mais s’il fut obligé de quitter l’Université de Chicago, ce fut notamment pour des raisons liées à sa vie privée. Lorsqu’il étudiait à Carleton, il avait fait la connaissance d’Ellen Rolfe, la nièce du président de l’université, qu’il finit par épouser au bout de quelques années. Vive, cultivée, embrassant volontiers de nobles causes, elle était encline à la dépression et souffrait de sautes d’humeur dues à des troubles thyroïdiens. Leur mariage fut malheureux, sans doute à peine consommé et entrecoupé de séparations. Veblen a souvent été présenté comme un mari chroniquement infidèle et un coureur de jupons invétéré qui multipliait les aventures avec ses étudiantes. Les historiens ont établi le caractère fantaisiste de cette réputation, dont l’origine est à chercher dans les accusations répétées de sa femme.
À Chicago, donc, il s’éprit d’une brillante étudiante nommée Sarah Hardy, avec laquelle il avait de longues conversations. Elle se maria peu après, et leur relation conserva un caractère platonique. Il se lia aussi d’amitié avec la femme d’un de ses collègues, Laura McAdoo Triggs, accompagnant même le couple lors d’un voyage en Europe. Puis il eut une aventure en bonne et due forme avec une autre de ses étudiantes, Ann Bevans, une femme mariée, mère de deux enfants. En guise de représailles, sa femme le dénonça au président de l’université, qui, par crainte d’un scandale, lui demanda de quitter l’établissement. Il trouva refuge à l’université Stanford, en Californie, où le scénario se répéta. Ann, qui avait entre-temps divorcé, s’était installée à Berkeley, de l’autre côté de la baie de San Francisco. Ellen, que Veblen avait laissé l’accompagner sans doute pour sauver les apparences, obtint du président de Stanford qu’il l’oblige à démissionner. Après que sa femme eut consenti au divorce, Veblen épousa Ann Bevans, en compagnie de laquelle il vécut quelques années heureuses en travaillant à l’Université du Missouri, s’occupant avec plaisir de ses deux filles. Ce bonheur ne dura pas. Accablée par une dépression, Ann Bevans fut placée dans une institution psychiatrique et mourut en 1920.
Toutes les femmes qui ont joué un rôle important dans la vie de Veblen, y compris sa mère et une sœur dont il était proche, étaient des personnes intelligentes, indépendantes et dotées d’une forte personnalité. Il est difficile de ne pas mettre cela en rapport avec ce qu’il dit de l’émancipation des femmes dans Théorie de la classe de loisir : « La femme a reçu sa part de l’instinct artisan […]. Il lui faut déployer son activité vitale […]. Vivre sa vie à sa façon, participer aux opérations industrielles de la société […] : voilà ce qui entraîne la femme, et peut-être plus irrésistiblement que l’homme. »
Si Veblen a dû quitter l’Université de Chicago, c’est aussi parce que la direction craignait l’effet que ses vues très critiques sur l’université américaine pouvait produire sur les hommes d’affaires soutenant financièrement l’établissement. Dans les dernières pages de Théorie de la classe de loisir, il présentait l’université comme le temple d’une érudition inutile et de pur prestige. Quelques années plus tard, dans un essai intitulé « L’enseignement supérieur en Amérique »6 – originellement doté du sous-titre provocant « Une étude sur la dépravation totale » –, effectuant un virage à 180 degrés sur la question, il défendait la cause de la recherche désintéressée de pure curiosité, dénonçait la domination de la vision utilitariste de l’enseignement supérieur, illustrée par le poids croissant des écoles de commerce, et stigmatisait l’emprise du monde des affaires sur l’université.
Peu avant la mort d’Ann, Veblen avait déménagé à New York, où il travailla quelques années pour le magazine libéral The Dial. Se tournant vers la politique internationale, il s’intéressa notamment à la question de l’impérialisme, soulignant le danger que faisait courir à la paix mondiale la combinaison, en Allemagne et au Japon, d’une structure politique féodale archaïque et de puissantes capacités industrielles. Souffrant de problèmes de santé, il finit ses jours en Californie, songeur et désabusé, dans une cabane avec vue sur l’océan où il vivait en compagnie d’une de ses deux belles-filles. Il mourut en 1929, quelques mois avant un grand krach boursier qui ne l’aurait pas étonné, dix ans avant une guerre mondiale qu’il avait vue venir. Avant cela, il avait brûlé ses papiers et laissé des instructions dans lesquelles il demandait à être incinéré « de façon aussi expéditive et peu coûteuse que possible, sans rituel ou cérémonie d’aucune sorte […] ni pierre tombale, ni dalle, ni épitaphe, ni effigie, ni plaque, ni inscription, ni monument, […] ni notice nécrologique, ni mémorial, ni portrait ».
Veblen n’a pas eu d’héritiers intellectuels directs. On cite parfois à ce titre les économistes de l’école « institutionnaliste » John R. Commons et Wesley C. Mitchell, sceptiques comme lui au sujet de la capacité de la théorie néoclassique à rendre compte du fonctionnement du marché. Mais les questions qu’ils ont étudiées sont différentes de celles qui l’occupaient. Certains ont affirmé l’existence de similitudes entre sa pensée et celle de John Maynard Keynes, en raison de la convergence apparente de leurs vues sur l’importance de la monnaie et du crédit, ou, de manière plus convaincante, celle de Joseph Schumpeter, du fait du rôle central qu’ils attribuaient tous les deux à la technique dans le progrès économique. S’il fallait rapprocher Veblen d’autres économistes du xxe siècle, ce serait plutôt de penseurs comme Karl Polanyi ou Albert O. Hirschman, qui voyaient comme lui l’économie profondément enchâssée dans l’Histoire, la société, la psychologie et la culture. Représentants d’une même famille intellectuelle, tous trois ont exercé sur les sciences sociales une influence réelle mais marginale, de nature essentiellement diffuse.
La société contemporaine est différente de celle que Veblen a étudiée. Comme le soulignait il y a vingt ans le sociologue C. Wright Mills7, la composition des classes privilégiées et des élites dirigeantes a changé. La technocratie dont Veblen envisageait l’apparition s’est mise en place, mais, loin d’être la technocratie d’ingénieurs qu’il appelait de ses vœux, c’est celle des gestionnaires. D’un autre côté, la technologie joue aujourd’hui dans l’économie un rôle moteur encore plus manifeste qu’il y a cent ans. Le poids de la finance face au secteur productif (industrie et services) y est encore plus important, la manipulation des préférences des consommateurs par la publicité plus massive et les possibilités d’enrichissement spéculatif y sont encore plus nombreuses. Sur le plan théorique, les modèles mathématiques de plus en plus complexes de l’approche néoclassique peinent à rendre compte du fonctionnement réel de l’économie [lire l’entretien avec John Kay et Mervyn King, Books n° 114, juillet-août 2021]. Au-delà de leur intérêt pour l’histoire des idées, les vues de Veblen, débarrassées de certains aspects obsolètes, pourraient continuer à nous inspirer.
— Michel André, philosophe de formation, a travaillé sur la politique de recherche et de culture scientifique au niveau international. Né et vivant en Belgique, il a publié Le Cinquantième Parallèle. Petits essais sur les choses de l’esprit (L’Harmattan, 2008).
— Cet article a été écrit pour Books.
Notes
1. Disponible en poche chez Gallimard, « Tel », 1979. Préface de Raymond Aron.
2. Thorstein Veblen and His America, Viking, 1934.
3. Veblen in Perspective: His Life and Thought, Routledge, 2001.
4. Son célèbre roman Looking Backward est disponible en français sous le titre Cent ans après ou l’An 2000, Infolio, 2008.
5. Pierre-Guillaume de Roux, 2018.
6. The Higher Learning in America, B. W. Huebsch, 1918.
7. Dans l’ouvrage collectif Veblen’s Century, Transaction Publishers, 2001.