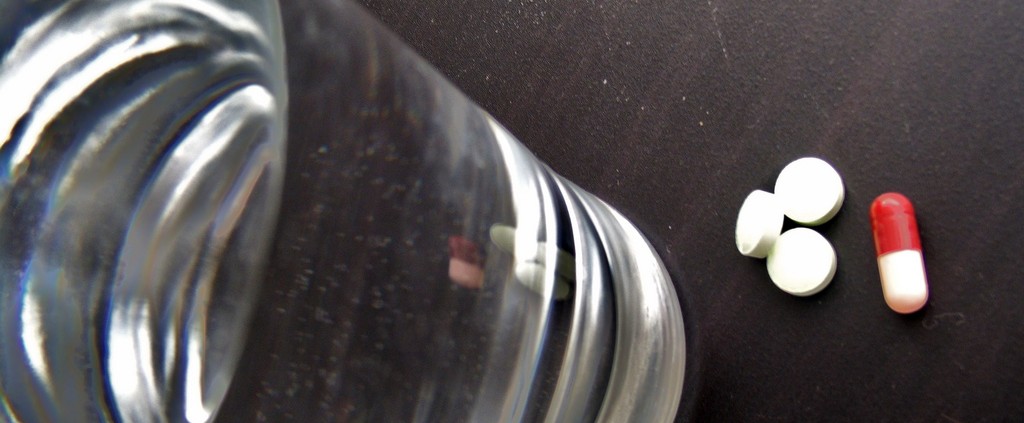Prendre des antidépresseurs nuit à la santé
Publié le 9 juin 2016. Par La rédaction de Books.
Le résultat d’une méta-analyse paru dans la revue scientifique britannique The Lancet ce jeudi, relève que la majorité des antidépresseurs est inefficace chez les enfants et adolescents. Ce n’est pas la première fois que les vertus des psychotropes sont remises en cause. Plusieurs auteurs ont déjà dénoncé les effets de l’alliance entre la psychiatrie et l’industrie pharmaceutique sur la santé des patients. Dans cet article de la New York Review of Books, traduit par Books en février 2012, Marcia Angell se plonge dans ces actes d’accusation très étayés.
Les Américains semblent confrontés à une épidémie galopante de maladies mentales. Du moins si l’on en juge par le nombre des personnes traitées pour cela. La population souffrant de troubles psychiques suffisamment sérieux pour ouvrir droit au « revenu de sécurité supplémentaire » (SSI) ou à l’assurance handicap de la Sécurité sociale (SSDI) était près de deux fois et demie plus nombreuse en 2007 (1 Américain sur 76) qu’en 1987 (1 sur 184). S’agissant des enfants, la hausse est encore plus étonnante – le chiffre a été multiplié par trente-cinq sur la même période. Les maladies mentales sont aujourd’hui la principale cause d’invalidité chez les mineurs, loin devant les handicaps physiques tels que l’infirmité motrice cérébrale ou la trisomie 21.
Menée entre 2001 et 2003 sous l’égide de l’Institut national américain de la santé mentale (NIMH), une vaste étude réalisée sur un échantillon représentatif d’adultes a abouti à un résultat surprenant. Selon les critères établis par l’American Psychiatric Association (APA), 46 % des personnes interrogées avaient souffert à un moment de leur vie d’au moins une maladie mentale entrant dans l’une de ces quatre grandes catégories : « troubles anxieux » (dont les phobies et le stress post-traumatique), « troubles de l’humeur » (dont la dépression sévère et les troubles bipolaires), « troubles du contrôle des impulsions » (divers problèmes comportementaux, y compris le trouble de déficit d’attention avec hyperactivité, le TDAH) et « troubles liés à l’utilisation de substances » (abus d’alcool et de drogues). La plupart d’entre elles relevaient de plus d’un diagnostic. Un tiers des personnes atteintes au cours de l’année précédente étaient sous traitement – contre un cinquième dans une étude similaire réalisée dix ans plus tôt. Aujourd’hui, les prescriptions médicales comprennent presque toujours des psychotropes, c’est-à-dire des substances affectant l’état mental (1). En fait, la plupart des psychiatres soignent uniquement à l’aide de médicaments, et adressent leurs patients aux psychologues ou aux travailleurs sociaux s’ils pensent qu’une psychothérapie se justifie également. Le passage progressif de la « thérapie par la parole » aux médicaments comme mode dominant de traitement coïncide avec l’émergence au cours des quatre dernières décennies de la théorie selon laquelle les maladies psychiques sont principalement causées par des déséquilibres chimiques dans le cerveau – déséquilibres pouvant être palliés par des molécules spécifiques. Cette doctrine est largement admise, par les médias et l’opinion autant que par la profession médicale, depuis la mise sur le marché du Prozac en 1987, et son lancement comme correctif d’un déficit de sérotonine. Le nombre de personnes traitées pour dépression a triplé au cours des dix années suivantes, et environ 10 % des Américains âgés de plus de 6 ans prennent actuellement des antidépresseurs (2). La hausse des prescriptions de médicaments soignant les psychoses est encore plus spectaculaire. La nouvelle génération de neuroleptiques tels que le Risperdal, le Zyprexa et le Xeroquel a remplacé les anti-cholestérol en tête des ventes de produits pharmaceutiques aux États-Unis (3).
Que se passe-t-il ? La prévalence des maladies mentales est-elle si élevée, et continue-t-elle d’augmenter ? Si ces troubles sont déterminés par la biologie et ne sont pas le résultat d’influences extérieures, une telle hausse est-elle plausible ? Ou bien savons-nous mieux reconnaître et diagnostiquer des troubles qui ont toujours existé ? Ne sommes-nous pas simplement en train d’étendre les critères de diagnostic des maladies mentales de telle sorte que presque tout le monde en ait une ? Et qu’en est-il des médicaments aujourd’hui à la base des traitements ? Sont-ils efficaces ? Si oui, ne devrions-nous pas voir décliner, et non augmenter, l’incidence de ces pathologies ?
Telles sont les questions, entre autres, que posent les auteurs de trois livres au propos fracassant : Antidépresseurs. Le grand mensonge (4), Anatomy of an Epidemic (5) et Unhinged. Trois auteurs au parcours différent : Irving Kirsch est psychologue à l’université de Hull, en Grande-Bretagne ; Robert Whitaker est journaliste, précédemment auteur d’une histoire du traitement des maladies mentales (6) ; Daniel Carlat est psychiatre dans une banlieue de Boston et tient un blog sur son métier.
Kirsch s’intéresse à la question de savoir si les antidépresseurs sont efficaces. Whitaker, dont le livre est plus virulent, s’attaque à l’ensemble des maladies mentales et se demande si les psychotropes ne créent pas davantage de problèmes qu’ils n’en résolvent. Carlat, qui écrit davantage sous le coup de la tristesse que de la colère, cherche principalement à savoir comment sa profession s’est alliée à l’industrie pharmaceutique et a été manipulée par elle. Tous trois sont remarquablement d’accord sur quelques sujets importants et leurs thèses sont solidement étayées.
1. C’est de la chimie, vous dis-je !
D’abord, aucun d’eux ne souscrit à la théorie très répandue selon laquelle la maladie mentale naît d’un déséquilibre chimique dans le cerveau. Comme le raconte Whitaker, cette thèse est apparue peu après l’introduction des psychotropes dans les années 1950. Le premier fut la chlorpromazine, lancée en 1954 comme un « tranquillisant majeur » et bientôt amplement utilisée dans les hôpitaux psychiatriques pour calmer les patients psychotiques, notamment les personnes atteintes de schizophrénie (7). La chlorpromazine fut suivie l’année suivante par le méprobamate, présenté comme un « tranquillisant mineur » pour traiter l’anxiété des malades en consultations externes. Et, en 1957, l’iproniazide arriva sur le marché comme « stimulant psychique » pour soigner la dépression.
Ainsi, en l’espace de trois petites années, des médicaments étaient devenus disponibles pour traiter les trois principales catégories de troubles psychiques tels qu’on les définissait à l’époque – psychose, anxiété et dépression. La psychiatrie s’en trouva totalement transformée. Ces produits n’avaient pourtant pas été mis au point à l’origine pour traiter les maladies mentales. Ils dérivaient de molécules conçues pour soigner des infections, dont on avait découvert seulement à la suite d’heureux hasards qu’elles modifiaient les états psychiques (8). Au début, personne n’avait la moindre idée de la façon dont elles agissaient. On constatait simplement qu’elles atténuaient les symptômes. Au cours de la décennie suivante, les chercheurs découvrirent que ces médicaments, et les psychotropes qui leur ont rapidement succédé, affectent le taux de certaines substances chimiques dans le cerveau.
Ouvrons une parenthèse pour un bref rappel, forcément simplificateur, de quelques notions de base : le cerveau contient des milliards de cellules nerveuses appelées neurones, formant des réseaux extrêmement complexes et communiquant constamment les uns avec les autres. Le neurone type possède de multiples extensions filamenteuses – la principale s’appelle l’axone, et les autres sont baptisées dendrites – par l’intermédiaire desquelles il émet et reçoit les signaux d’autres neurones. Pour que ceux-ci communiquent, cependant, le signal doit être transmis à travers le minuscule espace qui les sépare, la synapse. Pour ce faire, l’axone du neurone émetteur libère dans la synapse une substance chimique, le neurotransmetteur. Celui-ci franchit la synapse et se fixe sur les récepteurs du deuxième neurone, souvent une dendrite, activant ou inhibant par là même la cellule réceptrice. Les axones ayant de nombreux terminaux, chaque neurone a de nombreuses synapses. Puis le neurotransmetteur est soit réabsorbé par le premier neurone, soit métabolisé par des enzymes, de sorte que le statu quo ante est restauré. Il existe des variations et des exceptions à ce scénario, mais c’est la façon habituelle dont les neurones communiquent.
Avec la découverte que les psychotropes influaient sur le taux des neurotransmetteurs, on a vu surgir cette théorie : les maladies mentales sont provoquées par une anomalie dans la concentration de ces substances chimiques à l’intérieur du cerveau – anomalie qui est précisément corrigée par le médicament approprié. Ainsi, puisque la chlorpromazine s’avérait diminuer le niveau de dopamine dans le cerveau, on en a conclu que les psychoses telles que la schizophrénie sont causées par un excès de dopamine. Ou plus tard, parce que certains antidépresseurs font augmenter le taux d’un autre neurotransmetteur, la sérotonine, on postula que la dépression est due à un déficit de sérotonine. (Ces antidépresseurs, comme le Prozac ou le Seropram, sont appelés inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ou ISRS, parce qu’ils empêchent la réabsorption de la sérotonine par les neurones qui la libèrent, de sorte qu’il en reste davantage dans les synapses pour activer d’autres neurones.) Ainsi, au lieu de mettre au point un médicament pour traiter une anomalie, on a postulé une anomalie correspondant à un médicament. C’était un grand bond en matière de logique, comme le soulignent les trois auteurs. Il est parfaitement possible que des médicaments agissant sur le taux de neurotransmetteurs puissent soulager des symptômes, même si les neurotransmetteurs en question n’ont rien à voir au départ avec la maladie (il est même possible qu’ils apaisent par un mode d’action entièrement différent). Comme l’écrit Carlat, « en suivant ce raisonnement, on pourrait dire que la cause de toutes les affections douloureuses est une carence en opiacés, puisque les narcotiques prescrits contre la douleur activent les récepteurs opioïdes dans le cerveau ». On pourrait aussi expliquer que la fièvre est due à un manque d’aspirine… Mais le principal problème avec cette théorie, c’est que, après les décennies passées à essayer de la démontrer, les chercheurs restent les mains vides. En amont du traitement, le fonctionnement des neurotransmetteurs semble normal chez les personnes atteintes de maladies mentales. « Avant le début des soins, fait observer Whitaker, les patients chez qui on a diagnostiqué une schizophrénie, une dépression ou d’autres troubles psychiatriques, ne souffrent d’aucun “déséquilibre chimique” connu. Cependant, une fois qu’une personne se voit prescrire des psychotropes – lesquels, d’une manière ou d’une autre, dérèglent la mécanique habituelle du cheminement neuronal –, son cerveau commence à fonctionner… anormalement (9). »
Carlat qualifie la théorie du déséquilibre chimique de « mythe » (qu’il appelle « commode », dans la mesure où il contrarie la stigmatisation des maladies mentales), et Kirsch, dont le livre traite essentiellement de la dépression, résume ainsi : « Il semble aujourd’hui hors de doute que la description de cette pathologie comme un déséquilibre chimique dans le cerveau est simplement fausse. » Je reviendrai plus loin sur la raison pour laquelle cette thèse persiste malgré l’absence de preuves.
2. Les antidépresseurs sont-ils des placebos ?
Les médicaments sont-ils efficaces ? Toute théorie mise à part, c’est la question qui importe. Dans son livre concis et tout à fait captivant, Kirsch décrit les recherches qu’il a menées pendant quinze ans pour répondre à cette interrogation à propos des antidépresseurs. Quand il a commencé ses travaux en 1995, il s’est principalement intéressé aux effets des placebos. Pour les étudier, il a passé en revue avec un collègue trente-huit essais cliniques publiés qui comparaient divers traitements avec des substances neutres, ou confrontaient psychothérapie et absence de soins. La plupart des expériences de ce type durent de six à huit semaines, pendant lesquelles l’état des patients tend à s’améliorer quelque peu, même sans aucun traitement. Mais Kirsch a découvert que les placebos étaient trois fois plus efficaces que l’absence de traitement. Ce résultat ne l’a pas particulièrement surpris. Il l’a été, en revanche, de constater que les antidépresseurs n’étaient que très légèrement plus performants que les substances neutres. À en juger par les échelles utilisées pour mesurer la dépression, un placebo était à 75 % aussi efficace qu’une molécule active. Kirsch a alors décidé de répéter son étude en examinant un ensemble de données plus complet et standardisé.
Le matériau utilisé provenait de la Food and Drug Administration (FDA), et non de la littérature publiée (10). Quand ils sollicitent une autorisation de mise sur le marché (AMM) de la FDA pour un nouveau médicament, les laboratoires pharmaceutiques doivent soumettre à l’agence tous les essais cliniques qu’ils ont financés (11). Ils sont généralement menés en double aveugle et contre placebo. En d’autres termes, les patients participant au test se voient administrer au hasard soit un médicament, soit un leurre, et ni eux ni les médecins ne savent ce qui leur a été donné. Les patients sont seulement informés qu’ils recevront soit une molécule active, soit un placebo, et ils sont également avertis des effets secondaires possibles. Si deux essais montrent que le médicament est plus efficace qu’une substance neutre, il est généralement homologué. Mais les labos peuvent financer autant d’expériences qu’ils veulent, dont la plupart peuvent se révéler négatives. Deux tests positifs suffisent pour justifier une AMM. Notons au passage que les résultats des essais d’un même médicament peuvent différer pour de nombreuses raisons, notamment la façon dont le test a été conçu et mené, sa taille et les types de patients étudiés.
Pour des raisons évidentes, les laboratoires veillent à ce que leurs études positives soient publiées dans des revues médicales et portées à la connaissance des médecins, alors que les expériences négatives croupissent dans les archives de la FDA, qui considère qu’elles relèvent de la propriété privée et sont donc confidentielles. Cette pratique fausse beaucoup la littérature spécialisée, l’enseignement de la médecine et les décisions en matière de traitements.
Kirsch et ses collègues ont invoqué le Freedom of Information Act [la loi qui régit l’accès aux documents administratifs], pour obtenir les comptes rendus de la FDA concernant tous les essais cliniques réalisés contre placebo, positifs ou négatifs, soumis pour l’AMM initiale des six antidépresseurs les plus utilisés homologués entre 1987 et 1999 – le Prozac, le Déroxat, le Zoloft, le Seropram, le Serzone [non commercialisé en France] et l’Effexor. Cet ensemble de données était plus fiable que celui utilisé dans son étude précédente, non seulement parce qu’il comprenait des expériences négatives, mais aussi parce que la FDA a défini des critères de qualité uniformes pour les essais qu’elle est amenée à examiner, et que seule une partie des recherches publiées évoquées dans la première étude de Kirsch avait été soumise à la FDA.
Au total, l’auteur a pu disposer de quarante-deux essais. La plupart étaient négatifs. Surtout, les placebos étaient à 83 % aussi efficaces que les médicaments, selon les critères définis par l’échelle de Hamilton (HAM-D), questionnaire mesurant la sévérité des symptômes de la dépression, très utilisé dans le milieu médical. La différence moyenne entre les molécules actives et les substances neutres n’était que de 1,8 point sur l’HAM-D, différence significative du point de vue statistique mais non du point de vue clinique. Les résultats étaient quasi identiques pour les six médicaments : tout aussi médiocres. Cependant, dans la mesure où les essais positifs avaient reçu une large publicité, alors que les expériences négatives avaient été dissimulées, l’opinion et la profession en sont venues à croire que ces produits sont extrêmement efficaces.
Kirsch a également été frappé par une autre découverte inattendue. Sa première étude et les travaux d’autres chercheurs avaient révélé que même des traitements non considérés comme des antidépresseurs – l’hormone thyroïdienne de synthèse, les opiacés, les sédatifs, les stimulants et certains remèdes à base de plantes – étaient aussi efficaces qu’eux pour atténuer les symptômes. « Quand ils sont administrés en tant qu’antidépresseurs, écrit Kirsch, les médicaments qui font augmenter, baisser, ou n’ont pas d’effet sur la sérotonine soulagent tous de la dépression à peu près au même degré. » Ce que tous ces produits « efficaces » avaient en commun ? Le fait de provoquer des effets secondaires dont les patients testés avaient été prévenus. Il est important que les essais cliniques, en particulier ceux concernant des troubles subjectifs comme la dépression, continuent à être menés en double aveugle. Cela empêche le cobaye et ses médecins d’imaginer des améliorations inexistantes, ce qui a plus de chances de se produire s’ils pensent que l’agent administré est une molécule active et non un placebo. Après avoir découvert que presque tous les médicaments produisant des effets secondaires sont légèrement plus efficaces dans le traitement de la dépression qu’un placebo inerte, Kirsch a émis l’hypothèse que la présence de ces effets permet aux individus de deviner qu’un traitement actif leur est administré, ce qui les rend plus enclins à signaler une amélioration (cette hypothèse est corroborée par des entretiens avec des patients et des médecins). Les antidépresseurs semblent plus efficaces dans le traitement des dépressions sévères que dans les autres cas, suggère-t-il, parce que les patients atteints de symptômes graves reçoivent généralement des doses plus élevées et ressentent donc davantage d’effets secondaires.
Enquêtant plus avant, Kirsch a ensuite examiné certains essais ayant employé des placebos « actifs » au lieu de placebos inertes. Le premier type de substance produisant des effets secondaires. C’est le cas de l’atropine, médicament qui bloque sélectivement l’action de certaines fibres nerveuses. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un antidépresseur, l’atropine provoque, entre autres, un dessèchement notable de la bouche. Lors d’essais l’utilisant, aucune différence entre l’antidépresseur et le placebo actif n’a pu être observée. Chacun ressentait des effets, et chacun signalait le même degré d’amélioration. Kirsch rapporte un certain nombre d’autres bizarreries, notamment l’absence de courbe dose-réaction. Autrement dit, des quantités plus fortes ne sont pas plus efficaces, ce qui est très improbable pour des médicaments véritablement actifs (12). « Tout ceci mis bout à bout, écrit Kirsch, nous amène à la conclusion que la différence relativement faible entre médicaments et placebos pourrait ne pas correspondre du tout à un effet médicamenteux. Il s’agirait plutôt d’un effet placebo amélioré, produit par le fait que certains patients ont percé à jour le test en double aveugle, ayant fini par deviner s’ils avaient reçu un médicament ou un placebo. Si tel est le cas, il n’y a strictement aucun effet véritable lié à un antidépresseur. Plutôt que de comparer placebos et médicaments, nous avons comparé des placebos “normaux” avec des placebos “renforcés”. »
C’est une conclusion déroutante, qui va totalement à l’encontre de la théorie communément acceptée par les médecins, mais Kirsch y parvient d’une manière prudente et logique. Les psychiatres qui prescrivent des antidépresseurs (la plupart d’entre eux) et les patients qui les prennent pourraient faire valoir qu’ils savent de par leur expérience qu’ils sont efficaces. Mais les observations individuelles, on le sait, ne sont pas un moyen sûr d’évaluer un traitement. Elles sont sujettes à de multiples déformations. Elles peuvent suggérer des hypothèses à étudier, mais non les démontrer. C’est pourquoi la mise au point au milieu du siècle dernier de l’essai clinique en double aveugle, sur un échantillon aléatoire et contre placebo, a représenté un tel progrès de la science médicale. Les histoires à propos des sangsues, du laetrile contre le cancer, de mégadoses de vitamines C ou de tant de remèdes de bonne femme n’ont pas résisté à des tests sérieux. Kirsch est un avocat inlassable de la méthode scientifique, et il apporte une objectivité bienvenue à un domaine souvent influencé par des constats empiriques, des émotions ou, comme nous le verrons, des intérêts personnels
3. Les psychotropes sont-ils nocifs ?
Le champ d’étude du livre de Whitaker est plus large et son propos est plus polémique. L’auteur ne se penche pas seulement sur la dépression, mais sur l’ensemble des maladies mentales. Alors que Kirsch conclut que les antidépresseurs ne sont probablement pas plus efficaces que les placebos, Whitaker estime que les antidépresseurs, et la plupart des psychotropes avec eux, sont non seulement inopérants mais nocifs. Il fait le lien entre l’épidémie de troubles psychiques et l’envolée des prescriptions : « Au cours des deux dernières décennies, période durant laquelle la prescription de médicaments psychiatriques a explosé, le nombre d’adultes et d’enfants handicapés par une maladie mentale a augmenté à une vitesse hallucinante. Nous en arrivons donc à une question évidente, bien qu’elle soit à sa manière hérétique : notre paradigme thérapeutique fondé sur l’utilisation de médicaments peut-il, de quelque façon imprévue, alimenter ce fléau de l’époque moderne ? »
De plus, avance Whitaker, l’histoire naturelle des troubles psychiques a changé. Alors que des maladies telles que la schizophrénie et la dépression étaient autrefois le plus souvent spontanément résolutives ou intermittentes, chaque épisode ne durant généralement guère plus de six mois et étant entrecoupé de longues phases de normalité, ces troubles sont aujourd’hui chroniques et durent la vie entière (13). Cette évolution pourrait, selon lui, être due au fait que les médicaments, même quand ils soulagent les symptômes à court terme, causent des dommages psychiques de long terme, qui perdurent même après que la maladie sous-jacente a été naturellement soignée.
Les preuves qu’il mobilise à l’appui de sa théorie sont de qualité variable. L’étude de l’histoire naturelle de n’importe quelle maladie sur un demi-siècle, au cours duquel le contexte aura profondément changé, est plus difficile qu’il ne veut l’admettre. Il est plus ardu encore de comparer sur le long terme les résultats obtenus avec des patients soignés et des patients non soignés, dans la mesure où les traitements ont plus de chances d’être prescrits à des personnes présentant au départ des troubles plus sévères. Néanmoins, les arguments de Whitaker donnent à réfléchir. Si les psychotropes nuisent, comme il le prétend, quel est le mécanisme à l’œuvre ? La réponse réside selon lui dans leur action sur les neurotransmetteurs. On sait que les psychotropes perturbent leur fonctionnement, même si ce n’est pas au départ la cause de la maladie. Whitaker décrit une chaîne d’effets. Quand, par exemple, un antidépresseur ISRS comme le Seropram fait augmenter le taux de sérotonine dans les synapses, il provoque des changements compensateurs par un processus de feedback (rétroaction) négatif. En réaction au taux élevé de sérotonine, les neurones présynaptiques qui la sécrètent en libèrent de moins grandes quantités et les neurones postsynaptiques y deviennent moins sensibles. Car le cerveau s’efforce d’annuler les effets du médicament. Il en va de même pour les produits qui bloquent les neurotransmetteurs, en sens inverse. Par exemple, les médicaments antipsychotiques arrêtent la dopamine, mais les neurones présynaptiques compensent en en libérant de plus grandes quantités, et les neurones postsynaptiques l’absorbent plus avidement. (Cette explication est nécessairement simplifiée à l’excès, dans la mesure où de nombreux psychotropes agissent sur plusieurs neurotransmetteurs à la fois.)
Une consommation de longue durée aboutit, selon les termes de Steve Hyman, ancien directeur du NIMH et, jusqu’à une date récente, doyen de l’université Harvard, à « des altérations substantielles et durables du fonctionnement neuronal (14) ». Le cerveau, écrit Hyman (cité par Whitaker), commence à fonctionner « qualitativement aussi bien que quantitativement » d’une manière « différente de l’état normal ». Au bout de plusieurs semaines, les efforts compensateurs du cerveau commencent à échouer, et des effets secondaires reflétant le mécanisme d’action des médicaments se manifestent. Par exemple, les ISRS peuvent entraîner des épisodes maniaques, à cause d’un excès de sérotonine. Les antipsychotiques provoquent quant à eux des troubles proches de la maladie de Parkinson, du fait du déficit de dopamine qu’ils induisent (également observé dans cette pathologie). Au moment de leur apparition, les effets secondaires sont souvent traités à l’aide d’autres médicaments, et de nombreux patients se retrouvent avec un véritable cocktail de psychotropes, prescrits pour un cocktail de diagnostics. Les épisodes de manie provoqués par les antidépresseurs pourraient déboucher sur un nouveau diagnostic de « trouble bipolaire » et induire une prescription comprenant un « stabilisateur d’humeur », tel que le Depakote (un anticonvulsivant), et, en prime, l’un des derniers antipsychotiques. C’est sans fin. Certains malades peuvent prendre jusqu’à six médicaments par jour (15). Une chercheuse respectée, Nancy Andreasen, a publié avec son équipe une étude prouvant que la prise d’antipsychotiques est associée à un rétrécissement du cerveau, et que cet effet est directement lié à la dose et à la durée du traitement (16). Comme elle l’a expliqué au New York Times, « le cortex préfrontal ne reçoit plus les stimuli dont il a besoin et est mis hors d’état de fonctionner par les médicaments. Cela réduit les symptômes psychotiques. Cela entraîne aussi la lente atrophie du cortex préfrontal ».
Arrêter les médicaments est extrêmement difficile, selon Whitaker, car les mécanismes compensateurs ne rencontrent alors plus de résistance. Quand un patient cesse de prendre du Seropram, le taux de sérotonine chute brusquement, parce que les neurones présynaptiques n’en libèrent plus en quantités normales et les neurones postsynaptiques n’ont plus assez de récepteurs pour la capter. De même, lorsqu’on arrête un antipsychotique, il arrive que les taux de dopamine montent en flèche. Les symptômes produits par l’arrêt des psychotropes sont souvent compliqués par des rechutes de la maladie originelle, ce qui peut inciter les psychiatres à rétablir le traitement médicamenteux, peut-être à de plus fortes doses.
À la différence de Kirsch, qui perd rarement son calme, Whitaker est scandalisé par ce qu’il considère comme une épidémie iatrogénique (introduite involontairement par les médecins) de dysfonctionnements du cerveau, en particulier celui engendré par l’usage massif des nouveaux antipsychotiques « atypiques » tels que le Zyprexa, qui provoque de sérieux effets secondaires. Il invite à cette « expérience de pensée express » : « Imaginez qu’apparaisse soudain dans notre société un virus faisant dormir les gens douze ou quatorze heures par jour. Ceux qui sont infectés se déplacent un peu plus lentement et semblent détachés émotionnellement. Beaucoup prennent énormément de poids – 10, 20, 30, voire 50 kilos. Souvent, le taux de sucre dans le sang monte en flèche, ainsi que le taux de cholestérol. Nombre d’entre eux – enfants et adolescents ne sont pas épargnés – deviennent diabétiques assez rapidement… Le gouvernement fédéral accorde des centaines de millions de dollars aux scientifiques des meilleures universités pour comprendre comment agit ce virus, et les chercheurs finissent par conclure que, s’il cause un dysfonctionnement aussi général, c’est parce qu’il bloque une multitude de récepteurs de neurotransmetteurs dans le cerveau – dopaminergiques, sérotonergiques, muscariniques, et histaminergiques. Tous ces cheminements neuronaux du cerveau sont compromis. De plus, des études d’imagerie montrent que, sur une période de plusieurs années, le virus rétrécit le cortex cérébral, et ce rétrécissement est lié à un déclin cognitif. La population terrifiée réclame un remède. Aujourd’hui, une telle maladie a dans la réalité touché des millions d’enfants et d’adultes américains. J’ai simplement décrit les effets de l’antipsychotique du laboratoire Eli Lilly le plus vendu, le Zyprexa. »
4. La prise de pouvoir de la psychiatrie
Si les psychotropes sont inutiles, comme le pense Kirsch à propos des antidépresseurs, ou pire qu’inutiles, pourquoi sont-ils si fréquemment prescrits par les psychiatres et considérés par la population et la profession comme des sortes de remèdes miracles ? Pourquoi le courant contre lequel luttent Kirsch, Whitaker et, comme nous allons le voir maintenant, Carlat est-il si puissant ?
L’un des maîtres à penser de la psychiatrie moderne était Leon Eisenberg, professeur à l’université Johns Hopkins, puis à la Harvard Medical School. Il fut l’un des premiers à étudier les effets des stimulants sur le déficit d’attention chez les enfants. En 1986, il écrivait que la psychiatrie, naguère « sans cervelle », était désormais « sans esprit ». Il voulait dire qu’avant l’introduction des psychotropes, la profession n’accordait guère d’intérêt aux neurotransmetteurs, ni à aucun autre aspect du cerveau. Elle souscrivait plutôt à la thèse freudienne selon laquelle les maladies mentales trouvent leur racine dans des conflits inconscients, dont l’origine remonte généralement à l’enfance, et qui affectent l’esprit comme s’il était séparé du cerveau. Depuis l’introduction des psychotropes dans les années 1950, c’est cet organe qui focalise l’attention (évolution qui s’est fortement accélérée dans les années 1980). Les psychiatres ont alors commencé à se considérer comme des psychopharmacologues et ils se sont de moins en moins intéressés aux récits de vie de leurs patients. Leur principal souci était désormais d’éliminer ou de réduire des symptômes en traitant les personnes souffrantes avec des médicaments susceptibles d’altérer le fonctionnement du cerveau. Après avoir été l’un des premiers avocats de ce modèle biologique, Eisenberg est devenu sur le tard un farouche détracteur de ce qu’il voit comme un usage inconsidéré des psychotropes, entraîné dans une large mesure par les manœuvres de l’industrie pharmaceutique (17).
Après la mise sur le marché des premiers médicaments, la profession a connu une brève période d’optimisme mais, à la fin des années 1960, celui-ci laissa place à un sentiment d’insécurité. Les graves effets secondaires des produits devinrent tangibles, et un mouvement antipsychiatrique se développa, comme en témoignent les écrits de Thomas Szasz (18) ou le film Vol au-dessus d’un nid de coucou. La concurrence des psychologues et des travailleurs sociaux pour la prise en charge des patients allait aussi croissant. En outre, la psychiatrie était en proie à des divisions internes : certains avaient adopté le nouveau modèle biologique, d’autres restaient attachés au schéma freudien, et une minorité voyait dans les maladies mentales une réaction globalement sensée à un monde insensé. Par ailleurs, les psychiatres étaient tenus pour les parents pauvres de la médecine ; même avec leurs nouveaux médicaments, on les jugeait moins scientifiques que les autres, et leurs revenus étaient généralement plus faibles.
Mais, à la fin des années 1970, la profession contre-attaqua – violemment. Comme Robert Whitaker le raconte, le directeur médical de l’American Psychiatric Association (APA), Melvin Sabshin, déclara en 1977 qu’un « effort vigoureux en vue d’une remédicalisation de la psychiatrie devait être fortement encouragé ». Passant aux actes, il lança une campagne tous azimuts de relations publiques.
La profession bénéficiait d’une arme puissante qui faisait défaut à ses concurrents. Les psychiatres étant tenus d’avoir un diplôme de médecin, ils détiennent l’autorité légale pour faire des ordonnances. En adoptant pleinement le modèle biologique des maladies mentales et le recours aux médicaments, la psychiatrie pouvait à la fois reléguer les autres thérapeutes dans une position subalterne et s’affirmer comme une discipline scientifique, au même titre que le reste de la profession médicale. Surtout, en accordant une place primordiale au traitement médicamenteux, la spécialité devint l’enfant chéri de l’industrie pharmaceutique, qui rendit bientôt sa gratitude tangible.
Ces efforts pour améliorer le statut de la psychiatrie furent entrepris délibérément. L’APA travaillait alors à la troisième édition du DSM, qui fournit des critères de diagnostic pour l’ensemble des troubles mentaux (19). Le président de l’APA avait nommé Robert Spitzer, professeur de psychiatrie très estimé de l’université Columbia, à la tête du comité supervisant le projet. Publiées en 1952 et 1968, les deux premières éditions reflétaient la conception freudienne de la maladie mentale et étaient peu connues en dehors de la profession. Spitzer entreprit de faire du DSM-III quelque chose d’assez différent. Il promit que ce serait une « apologie du modèle médical appliqué aux problèmes psychiatriques ». Et Jack Weinberg, président de l’APA en 1977, déclara que l’ouvrage « mettrait les choses au clair pour quiconque douterait que l’on puisse considérer la psychiatrie comme une spécialité de la médecine ».
Quand il fut publié en 1980, le DSM-III de Spitzer contenait 265 diagnostics (83 de plus que la précédente édition), et son usage devint quasi universel ; il était utilisé non seulement par les psychiatres, mais aussi par les compagnies d’assurance, les hôpitaux, les tribunaux, les prisons, les écoles, les chercheurs, l’administration et le reste de la profession médicale. Son objectif principal était de donner une cohérence (le terme le plus couramment employé était « fiabilité ») à la pratique, autrement dit faire en sorte que des psychiatres examinant le même patient fassent le même diagnostic. Pour cela, chaque pathologie était définie par une liste de symptômes, avec des seuils numériques. Par exemple, le fait de présenter au moins cinq signes (sur neuf) vous valait un diagnostic d’épisode dépressif majeur à l’intérieur de la catégorie plus large des « troubles de l’humeur ». Mais il existait un autre objectif : justifier l’utilisation de psychotropes. Présidente de l’APA en 2010, Carol Bernstein, l’a de fait reconnu récemment : « Dans les années 1970, écrit-elle, il était devenu nécessaire de faciliter l’accord sur le diagnostic entre cliniciens, chercheurs et autorités régulatrices, étant donné qu’il fallait faire accepter aux patients les traitements pharmacologiques récemment apparus (20). »
Le DSM-III était quasi certainement plus « fiable » que les premières versions, mais fiabilité ne signifie pas validité. Comme je l’ai souligné, elle est synonyme de cohérence, alors que la validité renvoie à l’exactitude et à la justesse. Si presque tous les médecins s’accordaient à voir dans les taches de rousseur un signe de cancer, le diagnostic serait « fiable », mais il ne serait pas valide. Le problème, c’est que toutes les éditions du DSM ne font que refléter les thèses de leurs auteurs ; et au premier chef celles de Spitzer, considéré à juste titre comme « l’un des psychiatres les plus influents du xxe siècle », dans le cas du DSM-III. De son propre aveu, il « demandait à tous les collègues avec qui il se sentait en accord » de siéger avec lui au sein du comité de rédaction de quinze membres – lesquels devaient parfois se plaindre du fait qu’il les convoquait trop rarement, et qu’il dirigeait les travaux d’une manière peu méthodique, mais très autoritaire. Spitzer déclara dans une interview en 1989 : « Je parvenais à mes fins en faisant mon baratin à l’assistance, et d’autres trucs du même genre… » Dans un article de 1984 intitulé « Les inconvénients du DSM-III l’emportent sur ses avantages », George Vaillant, professeur de psychiatrie à la Harvard Medical School, écrivit que le manuel représentait « une série de choix hardis fondés sur l’intuition, le goût, les préjugés et l’espoir », ce qui me paraît être une description juste de l’ouvrage.
Non seulement le manuel est devenu la bible de la psychiatrie, mais, comme la vraie Bible, il repose pour une bonne part sur ce qui s’apparente à une révélation. Mis à part une annexe bibliographique, il ne cite pas d’études scientifiques à l’appui de ses conclusions. Une omission étonnante car, dans toutes les publications médicales, les affirmations sont censées être corroborées par des articles cités en référence. Il peut être d’un grand intérêt qu’un groupe d’experts se réunisse et fasse part de ses hypothèses, mais, à moins que celles-ci ne soient confortées par des sources, elles ne justifient pas l’extraordinaire déférence manifestée à l’endroit de cet ouvrage. Le DSM-III a été supplanté par le DSM-III-R en 1987, le DSM-IV en 1994, et la version actuelle, le DSM-IV-TR (texte révisé) en 2000, qui contient 365 diagnostics (21). « À chaque nouvelle édition, écrit Daniel Carlat dans son livre, le nombre de diagnostics a été multiplié et le manuel est devenu plus gros et plus cher. Chacun est devenu un bestseller pour l’APA, et le DSM est aujourd’hui l’une des principales sources de revenus pour l’organisation. » Le DSM-IV s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires.
5. Le jeu de l’industrie pharmaceutique
La psychiatrie devenant une spécialité faisant un usage intensif des médicaments, l’industrie pharmaceutique fut prompte à voir l’avantage qu’elle aurait à conclure une alliance avec la profession. Les laboratoires commencèrent à prodiguer attentions et largesses aux psychiatres, tant individuellement que collectivement. Ils couvrirent les praticiens de cadeaux et d’échantillons gratuits, les recrutèrent comme consultants et porte-parole, les invitèrent au restaurant, financèrent leur participation à des congrès et leur fournirent du matériel « pédagogique ». Quand le Minnesota et le Vermont appliquèrent les sunshine laws [lois relatives à la transparence des documents administratifs], qui obligeaient les labos à signaler les sommes qu’ils versaient aux médecins, on s’aperçut que les psychiatres percevaient plus d’argent que les autres spécialistes. L’industrie pharmaceutique sponsorise également les congrès de l’APA et autres rencontres professionnelles. Environ un cinquième du financement de l’APA provient aujourd’hui des laboratoires (22).
Ces derniers sont particulièrement soucieux de s’attirer les faveurs des psychiatres enseignant dans les grands centres universitaires. Appelés « leaders d’opinion clés » (KOL) par l’industrie, il s’agit de personnes qui, à travers leurs écrits et leur enseignement, pèseront sur la manière dont les maladies mentales seront diagnostiquées et traitées. Ces « leaders » publient aussi l’essentiel des recherches cliniques sur les médicaments et décident en grande partie du contenu du DSM. En un sens, ils constituent la meilleure force de vente dont puisse disposer l’industrie, et valent qu’on ne lésine pas à leur égard. Sur les 170 contributeurs de la version actuelle du DSM, presque tous peuvent être décrits comme des KOL ; 95 d’entre eux entretenaient des liens financiers avec des labos, notamment tous les contributeurs des sections consacrées aux troubles de l’humeur et à la schizophrénie.
L’industrie pharmaceutique soutient bien d’autres spécialistes et associations professionnelles, mais Carlat demande pourquoi « les psychiatres arrivent systématiquement en tête des spécialités quand il s’agit de soutirer de l’argent aux labos ». Sa réponse : « Nos diagnostics sont subjectifs et extensibles, et nous avons peu de motifs rationnels de choisir un traitement plutôt qu’un autre. » À la différence des maladies relevant de la plupart des autres branches de la médecine, il n’existe pas de signes objectifs ou de tests permettant de reconnaître telle ou telle pathologie mentale – ni données de laboratoire, ni imagerie par résonance magnétique – et les limites entre le normal et l’anormal sont souvent floues. Cela permet l’extension des frontières des diagnostics, voire la création de nouvelles pathologies selon des modalités qui seraient impossibles, disons, dans un domaine comme la cardiologie. Et les labos ont tout intérêt à inciter les psychiatres à agir précisément de cette façon.
En plus de l’argent dépensé directement pour la profession, les firmes aident massivement de nombreux groupes de défense des droits des patients, ainsi que des organismes d’information et de formation. Au cours du seul premier trimestre 2009, constate Whitaker, Eli Lilly a donné 551 000 dollars à la NAMI, la principale organisation américaine de soutien aux malades mentaux, 465 000 dollars à une association pour les patients atteints de TDAH (déficit d’attention et hyperactivité) et 69 250 dollars à la Fondation américaine pour la prévention du suicide. Il ne s’agit que d’un seul laboratoire et sur trois mois seulement ; on imagine ce que serait le montant annuel si l’on additionnait les subsides versés par toutes les firmes. Les associations en question ont pour but de sensibiliser l’opinion publique aux troubles psychiatriques, mais leur action a aussi pour effet de promouvoir l’utilisation de psychotropes et d’inciter les assureurs à les prendre en charge. Whitaker résume comme suit le développement de l’influence de l’industrie pharmaceutique après la publication du DSM-III : « En bref, un influent quatuor a vu le jour dans les années 1980 dans le but exprès d’informer le public que les maladies mentales sont des maladies du cerveau. Les compagnies pharmaceutiques fournissaient les moyens financiers. L’APA et les psychiatres des grandes universités de médecine conféraient une légitimité intellectuelle à l’entreprise. Le NIMH lui donnait l’estampille officielle du gouvernement, et la NAMI une autorité morale. »
Comme la plupart des autres psychiatres, Carlat traite ses patients uniquement avec des médicaments, non au moyen de la thérapie par la parole, et il confie très franchement les avantages que cela présente. S’il voit trois patients par heure pour de la psychopharmacologie, a-t-il calculé, il obtient des assureurs environ 180 dollars de l’heure. En comparaison, la « thérapie par la parole » l’obligerait à ne recevoir qu’un seul patient par heure, ce pour quoi les assureurs lui verseraient moins de 100 dollars (23).
Carlat ne pense pas que la psychopharmacologie soit particulièrement compliquée, et encore moins exacte, bien que l’opinion soit incitée à le croire : « Les patients considèrent souvent les psychiatres comme des experts en neurotransmetteurs, qui peuvent choisir précisément la bonne prescription pour le déséquilibre chimique en jeu, quel qu’il soit. Cette trop bonne opinion de nos capacités a été encouragée par les labos, par nous autres psychiatres, et par l’espoir de guérison bien compréhensible des malades. »
Son travail consiste à poser aux patients une série de questions sur leurs symptômes pour voir s’ils correspondent à l’un ou l’autre des troubles répertoriés dans le DSM. Cet exercice, écrit-il, donne « l’illusion que nous comprenons nos malades alors que nous nous bornons à leur accoler des étiquettes (24) ». Souvent, les patients satisfont aux critères pour plus d’un diagnostic, parce que les symptômes se recouvrent partiellement. Par exemple, la difficulté de concentration est un critère pour plusieurs troubles. L’un des clients de Carlat s’est retrouvé avec sept diagnostics différents. « Nous ciblons des symptômes spécifiques avec les traitements, et ajoutons par-dessus d’autres médicaments pour les effets secondaires. » Un patient type, dit-il, pourra prendre du Seropram pour la dépression, du Lexomil pour les crises d’angoisse, du Stilnox pour l’insomnie, du Modiodal pour la fatigue (effet secondaire du Seropram) et du Viagra pour l’impuissance (autre effet secondaire du Seropram).
Quant aux prescriptions elles-mêmes, Carlat écrit qu’« il n’existe qu’une poignée de catégories génériques de psychotropes », à l’intérieur desquelles les médicaments ne sont pas très différents les uns des autres. Il ne croit pas qu’il y ait vraiment matière à choisir entre eux. « Nos décisions de prescription sont remarquablement subjectives, voire aléatoires. Votre psy sera peut-être d’humeur à vous prescrire du Seroplex ce matin, parce qu’une accorte visiteuse médicale du labo fabriquant le Seroplex viendra de sortir de son cabinet ». Et de conclure : « Telle est la psychopharmacologie moderne. Uniquement guidés par les symptômes, nous essayons différents médicaments, sans réelle compréhension de ce que nous tentons de guérir, ni de la façon dont les substances fonctionnent. Je m’étonne en permanence que nous soyons aussi efficaces avec un si grand nombre de patients. » Si Carlat pense que les psychotropes sont parfois efficaces, il se fonde pour le dire sur le seul apport de témoignages. Ce qu’il désapprouve, c’est leur surutilisation et la « frénésie de diagnostics psychiatriques » dont il parle. Pour reprendre ses termes, « si vous demandez à n’importe quel psychiatre clinicien, moi y compris, si les antidépresseurs sont efficaces chez ses patients, vous entendrez un “oui” dépourvu d’ambiguïté. Nous voyons tout le temps des gens aller mieux ». Mais il poursuit en faisant l’hypothèse, comme Irving Kirsch, qu’ils réagissent à l’activation d’un effet placebo. Si les psychotropes n’ont pas toutes les vertus qu’on leur prête – et les données disponibles confirment qu’on peut en douter –, qu’en est-il des diagnostics eux-mêmes ? Alors qu’ils sont toujours plus nombreux à chaque nouvelle édition du DSM, que pouvons-nous en tirer ?
En 1999, l’APA commença à travailler à la cinquième révision du DSM, dont la parution est prévue pour 2013. Le comité de rédaction (qui compte maintenant vingt-sept membres) est dirigé par David Kupfer, professeur de psychiatrie à l’université de Pittsburg, assisté de Darrel Regier de l’APA. Comme pour les éditions antérieures, le comité est conseillé par de nombreux groupes de travail, qui comptent actuellement quelque 140 membres, et correspondent aux principales catégories de diagnostics. Les délibérations et propositions en cours ont d’ores et déjà été largement dévoilées sur le site Web de l’APA (25) et dans les médias, et il apparaît que la constellation des troubles mentaux, déjà très vaste, va encore s’étendre.
En particulier, les limites des diagnostics seront élargies pour inclure les signes avant-coureurs de troubles, tel le « syndrome de risque de psychose » et le « léger déficit cognitif », annonçant peut-être une maladie d’Alzheimer. Le terme « spectre » est utilisé pour dilater les catégories, par exemple : « spectre des désordres obsessionnels-compulsifs », « troubles du spectre schizophrénique » et « troubles du spectre autistique ». Et l’on voit apparaître des propositions pour des entrées entièrement nouvelles, telles que « trouble d’hypersexualité », « syndrome des jambes sans repos », « boulimie compulsive (26) ». Même Allen Frances, qui présida le comité de rédaction du DSM-IV, porte un regard très critique sur la multiplication des diagnostics dans le DSM-5. Dans le numéro du 26 juin 2009 du Psychiatric Times, il écrivait que l’ouvrage serait « une aubaine pour l’industrie pharmaceutique, mais à un coût très élevé pour les nouveaux patients “faux positifs” qui se trouveront pris dans le filet extrêmement large » de ce nouveau manuel. Comme pour appuyer ce jugement, Kupfer et Regier écrivent dans un article récent : « Dans les consultations de médecine générale, entre 30 et 50 % environ des patients présentent des troubles psychiques identifiables ou des symptômes de maladie mentale prononcés, qui ont des conséquences négatives importantes s’ils ne sont pas traités (27). » Il semble bien qu’il sera de plus en plus difficile d’être normal.
À la fin de cet article de Kupfer et Regier figure une notule de « divulgation de renseignements financiers » en petits caractères où l’on peut lire notamment : « Avant d’être nommé président du comité de rédaction du DSM-5, le Dr Kupfer signale avoir siégé dans les conseils consultatifs d’Eli Lilly & Co, Forest Pharmaceuticals Inc, Solvay/Wyeth Pharmaceuticals et Johnson & Johnson ; et avoir été consultant pour Servier et Lundbeck. » Regier a la haute main sur toutes les bourses de recherche parrainées par l’industrie accordées à l’APA. Le DSM-5 est la première édition qui établisse des règles visant à limiter les conflits d’intérêt financiers chez les membres du comité de rédaction ou des groupes de travail. Selon ces règles, une fois nommées (en 2006-2008), les recrues n’ont pas pu recevoir plus de 10 000 dollars par an de la part de laboratoires, ou détenir plus de 50 000 dollars en actions de ces sociétés. Le site Web informe sur les liens que les membres ont entretenus avec les firmes pendant les trois années qui ont précédé leur nomination. Sur le site de l’APA, 56 % des participants aux groupes de travail révèlent avoir des intérêts significatifs dans le secteur.
L’industrie pharmaceutique incite à prescrire des psychotropes même pour des catégories de patients chez qui les médicaments ne se sont révélés ni sûrs, ni efficaces. L’augmentation étonnante des diagnostics et des traitements de maladies mentales chez les enfants, parfois âgés d’à peine 2 ans, devrait être le principal sujet d’inquiétude pour les Américains. Ces gamins sont parfois soignés avec des médicaments qui n’ont jamais reçu d’autorisation de mise sur le marché pour cette tranche d’âge et présentent de graves effets secondaires. La prévalence apparente du « trouble bipolaire juvénile » a été multipliée par quarante-cinq entre 1993 et 2004, et celle de l’« autisme » est passée de 1 enfant sur 500 à 1 enfant sur 90 sur la même période. 10 % des garçons de 10 ans prennent aujourd’hui chaque jour des stimulants pour « déficit d’attention avec hyperactivité » (TDAH) (28). Et 500 000 enfants sont sous neuroleptiques.
Il semble exister des modes en matière de diagnostics psychiatriques chez l’enfant, un trouble laissant la place au suivant. Au début, c’est le diagnostic de TDAH, qui se caractérise en général par l’hyperactivité, l’inattention et l’impulsivité chez les gosses en âge scolaire, qui a augmenté le plus rapidement. Mais, au milieu des années 1990, deux psychiatres très influents du Massachusetts General Hospital ont émis l’hypothèse que de nombreux enfants atteints de TDAH souffraient en fait de troubles bipolaires, et que ces derniers pouvaient être décelés dès leur plus jeune âge. Ils considéraient que les épisodes maniaques caractéristiques du trouble bipolaire pouvaient se manifester chez les petits par de l’irritabilité. Ces thèses ont donné lieu à un flot de diagnostics de troubles bipolaires juvéniles. Finalement, cette vogue a été suivie d’une sorte de retour de bâton, et le DSM-5 propose désormais de remplacer partiellement ce diagnostic par un autre, tout nouveau, appelé « trouble de dérèglement de l’humeur avec dysphorie » ou TDD, dans lequel Allen Frances voit un « nouveau monstre ».
On serait bien en peine de trouver un bambin de 2 ans qui ne soit pas parfois irritable, un enfant de CE2 qui ne soit pas parfois inattentif, ou une collégienne qui ne soit pas angoissée. (Imaginez les effets que la prise d’un médicament provoquant l’obésité pourra avoir sur cette jeune fille.) Le fait que de tels enfants soient catalogués comme souffrant de troubles mentaux et traités avec des médicaments sur ordonnance dépend beaucoup de leur milieu social et des contraintes auxquels sont confrontés leurs parents. À l’heure où les familles à bas revenus rencontrent des difficultés économiques croissantes, beaucoup découvrent qu’une demande de versement du Revenu de sécurité complémentaire (SSI) pour incapacité mentale est la seule manière qu’elles ont de survivre. Cette prestation est plus généreuse que l’aide sociale et assure pratiquement que la famille aura également droit au Medicaid (29). Selon David Autor, professeur d’économie au MIT, « c’est devenu le nouveau système de protection sociale ». Les hôpitaux et les services de sécurité sociale de chaque État sont eux-mêmes incités à encourager les familles non assurées à solliciter le SSI, dans la mesure où les établissements se feront payer en retour et où les États économiseront de l’argent en transférant certaines dépenses sur le gouvernement fédéral.
Un nombre croissant d’entreprises à but lucratif se spécialisent dans l’aide aux familles pauvres désireuses de monter un dossier pour l’obtention du SSI. Mais pour y avoir droit, les postulants (y compris les mineurs pour lesquels des adultes font une demande) doivent presque toujours prendre des psychotropes. Selon un reportage du New York Times, une étude de la Rutgers University a révélé que les enfants issus de familles à bas revenus courent quatre fois plus le risque d’être sous psychotropes que ceux des foyers bénéficiant d’assurances privées.
En décembre 2006, une fillette de 4 ans, Rebecca Riley, est morte dans une petite ville de la région de Boston d’une association de Clonidine et de Depakote, qui lui avaient été prescrits avec du Xeroquel pour « traiter » un « TDAH » et un « trouble bipolaire » – diagnostics posés quand elle avait 2 ans. L’AMM de la Clonidine vise l’hypertension, celle du Depakote l’épilepsie et les crises de manie aiguë associées au trouble bipolaire, celle du Xeroquel la schizophrénie et la manie aiguë. Aucun des trois n’a été autorisé pour traiter le TDAH ou pour un usage de longue durée dans le cas de troubles bipolaires, et aucun ne l’a été pour des petits de l’âge de Rebecca. Deux autres enfants de la famille (plus âgés) s’étaient vu signifier le même diagnostic et prenaient chacun trois psychotropes. Les parents bénéficiaient du SSI pour eux-mêmes et pour les deux aînés, et venaient de faire une demande pour Rebecca quand elle est décédée. Le revenu du foyer provenant du SSI se montait à 30 000 dollars par an.
Le fait que ces médicaments n’auraient jamais dû être prescrits à Rebecca est la question cruciale. La FDA n’autorise la mise sur le marché d’un médicament que pour des usages spécifiques, et la loi interdit aux laboratoires de les commercialiser à toute autre fin. Néanmoins, les médecins sont autorisés à prescrire des produits pour toute raison de leur choix ; inciter les praticiens à prescrire des molécules hors AMM, au mépris de la loi, est l’une des actions les plus lucratives que puissent mener les firmes. Au cours des quatre dernières années seulement, cinq laboratoires ont été poursuivis au niveau fédéral pour avoir promu illégalement l’usage de psychotropes hors AMM. AstraZeneca a commercialisé du Xeroquel hors AMM pour des enfants et des personnes âgées (autre population vulnérable, à qui l’on administre souvent des antipsychotiques dans les maisons de retraite médicalisées) ; Pfizer a été l’objet de poursuites similaires pour le Geodon (un antipsychotique non disponible en France) ; Eli Lilly pour le Zyprexa (idem) ; Bristol-Myers Squibb pour l’Abilify (autre antipsychotique) ; et Forest Labs pour le Seropram (un antidépresseur). Bien qu’ils aient eu à verser des centaines de millions de dollars en frais de justice, les firmes ont probablement bien tiré leur épingle du jeu. À l’origine, cette liberté laissée aux médecins devait leur permettre de traiter des patients sur la base de rapports scientifiques préliminaires, sans être obligés d’attendre la décision de l’administration. Mais ce raisonnement judicieux est devenu un outil commercial. En raison de la nature subjective du diagnostic psychiatrique, de la facilité avec laquelle les frontières des pathologies peuvent être élargies, de la gravité des effets secondaires des psychotropes, et de l’influence envahissante de leurs fabricants, je pense qu’il devrait être interdit aux médecins de prescrire des médicaments hors AMM, tout comme il est interdit aux labos de les commercialiser (30).
6. Pour conclure
Les livres de Kirsch, Whitaker et Carlat sont de puissants réquisitoires contre la façon dont la psychiatrie est pratiquée de nos jours. Ils nous renseignent sur la « frénésie » de diagnostic, le suremploi des médicaments – avec parfois des effets secondaires dévastateurs – et la fréquence des conflits d’intérêt. Les détracteurs de ces livres pourront faire valoir, comme Nancy Andreasen le sous-entend dans son article sur la perte de tissus cérébraux du fait de traitements antipsychotiques de longue durée, que les effets secondaires sont le prix à payer pour soulager les tourments provoqués par les maladies mentales. Si nous étions sûrs que les bénéfices des psychotropes l’emportent sur leurs inconvénients, ce serait un argument fort, car il ne fait aucun doute que de nombreuses personnes souffrent gravement de troubles psychiques. Mais, comme Kirsch, Whitaker et Carlat le démontrent de façon convaincante, cette perspective est probablement illusoire.
À tout le moins, nous devons cesser de penser que les psychotropes constituent le meilleur, voire l’unique, moyen de traiter les maladies mentales ou la détresse émotionnelle. La psychothérapie et l’exercice physique se sont révélés aussi efficaces que les médicaments contre la dépression, et leurs effets sont de plus longue durée, mais aucune industrie n’assure, hélas ! la promotion de ces alternatives, et les Américains ont fini par croire que les pilules doivent être plus efficaces. De plus amples recherches sont nécessaires pour étudier d’autres solutions et leurs résultats devraient être intégrés à l’enseignement de la médecine.
Nous avons, en particulier, besoin de repenser le traitement des enfants. Ici, le problème tient souvent aux difficultés des familles plongées dans un contexte difficile. Des mesures visant à améliorer cet environnement – comme un tutorat personnalisé permettant d’aider les parents à faire face, ou des centres pour les enfants après l’école – devraient être étudiées et comparées avec les traitements médicamenteux. Sur le long terme, de telles alternatives seraient probablement moins coûteuses. Notre dépendance aux psychotropes, pour à peu près tous les désagréments de la vie, nous pousse à ignorer les autres options. Au regard des risques et de la discutable efficacité sur le long terme des médicaments, nous devons faire mieux. Surtout, nous devrions nous rappeler le précepte médical consacré par le temps : Primum non nocere (« D’abord, ne point nuire »).
L’article de Marcia Angell et la discussion qui s’est ensuivie sont parus dans trois numéros de la New York Review of Books (23 juin, 14 juillet et 18 août 2011). La traduction est de Philippe Babo.
Notes
1| En France, un peu plus de 10% des ordonnances incluent une prescription de psychotropes (enquête Cnam, 2004).
2| En France le chiffre était de 5% en 2003.
3| En France, aucun des dix médicaments les plus vendus (en valeur) n’est un psychotrope. Cependant, ils se situent au deuxième rang derrière les antalgiques pour le nombre d’unités vendues (rapport parlementaire sur « le bon usage des médicaments psychotropes », juin 2006).
4| Music and Entertainment Books, 2010 (The Emperor’s New Drugs, « Les nouveaux médicaments de l’empereur », Bodley Head, 2009). Lire « Antidépresseurs : le mensonge des labos », Books, n° 12, mars-avril 2010, p. 44.
5| Anatomy of an Epidemic. Magic Bullets, Psychiatric Drugs and the Astonishing Rise of Mental Illness in America (« Anatomie d’une épidémie. Les remèdes miracles, les médicaments psychiatriques et la surprenante envolée de la maladie mentale en Amérique »), Broadway, 2011.
6| Mad in America. Bad Science, Bad Medicine and the Enduring Mistreatment of the Mentally Ill (« Être fou en Amérique. Mauvaise science, mauvaise médecine et la persistance du mauvais traitement des malades mentaux »), Basic Books, 2001.
7| Les effets de la chlorpromazine, en particulier sur les psychoses aiguës et chroniques, ont été découverts en France en 1952 dans le service du professeur Jean Delay, à l’hôpital Sainte-Anne (Paris). Pierre Deniker, assistant du professeur Delay, a joué un rôle majeur dans cette découverte.
8| L’idée que la découverte des neuroleptiques est due au hasard est contestable. Lire le témoignage de Pierre Deniker recueilli par Bernard Granger en 1987 et publié tout récemment par la revue Psychiatrie Sciences humaines Neurosciences (PSN), vol. 9/2011, novembre 2011, p. 181-189 (« Monsieur, ce coup-ci, ça fait quelque chose?! »).
9| Cette affirmation est contestable. De nombreuses études témoignent de dérèglements cérébraux chez des sujets n’ayant pas encore pris de médicaments. C’est le cas chez des jeunes à haut risque de schizophrénie (voir par exemple International Review of Psychiatry, vol. 19/4, août 2007, p. 371-381) et chez des personnes ayant connu un premier épisode dépressif majeur (voir par exemple Biological Psychiatry, vol. 70/4, août 2011, p. 334-342).
10| La FDA est l’agence chargée de réglementer et de surveiller le marché de l’alimentation et celui des médicaments.
11| C’est le cas aussi en France, mais l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (Afssaps) ne délivre que 20% environ des AMM. Les 80?% restants sont délivrées par l’Agence européenne du médicament (EMA), à Londres. Laquelle se fie largement aux autorisations données par la FDA américaine.
12| L’argument est contestable, car lorsque les récepteurs sur lesquels agissent les antidépresseurs sont saturés, l’augmentation des doses ne sert à rien.
13| L’idée que la schizophrénie et la dépression étaient autrefois « le plus souvent spontanément résolutifs ou épisodiques » est contestable. La schizophrénie est une maladie chronique. Il y a toujours eu des formes chroniques de la dépression.
14| The American Journal of Psychiatry, vol. 153/12, 1996, p. 151-162.
15| En France, cela peut se produire pour des pathologies particulièrement complexes et difficiles à équilibrer.
16| Biological Psychiatry, vol. 70/7, octobre 2011, p. 672-679.
17| Voir son article testament, publié après sa mort, Acta Psychiatrica Scandinavica, vol. 122/2, août 2010, p. 89-170.
18| Le Mythe de la maladie mentale, Payot, 1975.
19| DSM : Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (en français : Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, Masson).
20| Psychiatric News, 4 mars 2011.
21| DSM-IV-TR. Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Texte révisé, Masson, 2e édition 2003. Il y a aussi le Mini DSM-IV-TR. Critères diagnostiques, Masson 2010 et le DSM-IV-TR. Cas cliniques, Masson 2008.
22| Il n’y a pas d’équivalent de l’APA en France mais les pratiques sont les mêmes (lire à ce sujet notre entretien avec le Pr Philippe Even, « En France, cela se passe comme aux États-Unis », Books, n° 4, avril 2009, p. 20).
23| En France, un psychiatre ou un psychothérapeute consacre typiquement une demi-heure à trois quarts d’heure à un patient. La « thérapie par la parole » est en grande partie assurée par des professionnels non médecins et dont les actes ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale et les mutuelles.
24| Aux États-Unis, les assureurs remboursent au vu du diagnostic indiqué par le médecin, alors qu’en France le médecin n’indique pas son diagnostic, le remboursement se faisant « à l’acte ».
25| www.DSM5.org.
26| À propos du syndrome des jambes sans repos, Wikipédia, dont nombre d’articles sont manipulés par l’industrie pharmaceutique, écrit que cette « maladie […] touche environ 8,5?% de la population française ».
27| Journal of the American Medical Association (JAMA), 19 mai 2010.
28| Le stimulant le plus couramment administré est la Ritaline, produite par Novartis.
29| Les critères d’éligibilité au Medicaid varient beaucoup d’un État américain à un autre.
30| Plusieurs psychiatres américains de haut niveau ont été condamnés pour avoir prescrit des psychotropes hors AMM, notamment à des enfants.